« J’aime mêler savoir scientifique et savoir expérimental, et je pense que c’est là une de mes forces que de pouvoir concilier les deux facettes, de pouvoir parler de maladie de manière subjective et objective. Ce double regard, je l’intègre totalement dans la vision que j’ai de mon rôle de chercheur, de scientifique. Je ne suis pas un malade qui se trouve avoir fait des études scientifiques, je suis un scientifique qui se trouve avoir eu une maladie », écrit Mickaël Worms-Ehrminger dans son livre Vivre avec un trouble de santé mentale : Les mots pour le dire, les outils pour s’en sortir, paru en avril 2023 aux éditions Marabout. Il y mêle à son propre vécu des morceaux de témoignages recueillis dans son podcast Les Maux Bleus qui contribue à la déstigmatisation des troubles psychiques, afin de tisser avec expertise, rigueur, et humanité ce livre-ressource incarné, accessible, et réconfortant sur les enjeux de santé mentale aujourd’hui en France. « C’est justement le fait d’aider qui m’a moi-même aidé », explique maintenant Mickaël Worms-Ehrminger à Madmoizelle qui a voulu en savoir plus.
Interview de Mickaël Worms-Ehrminger, auteur de Vivre avec un trouble de santé mentale
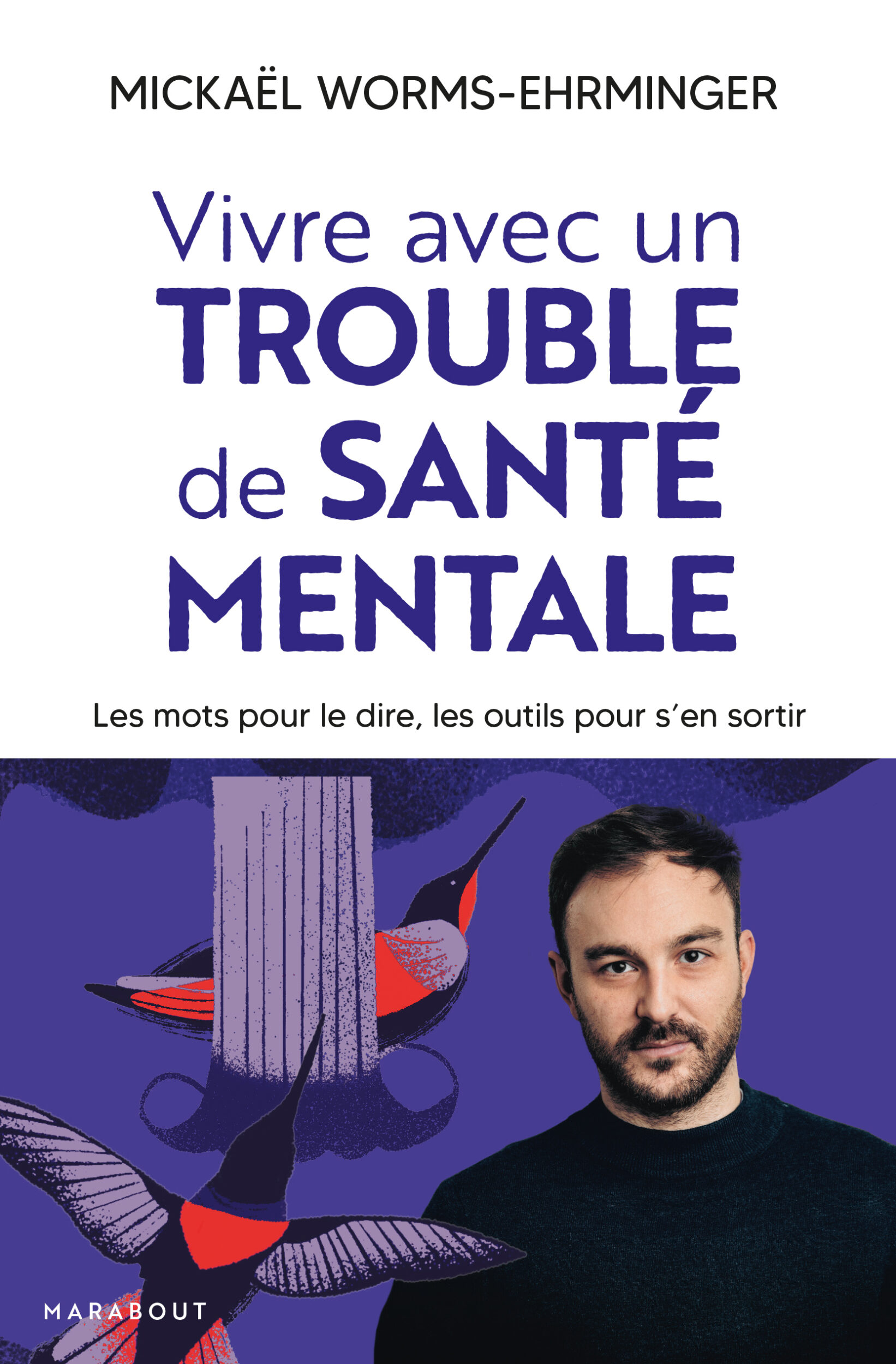
Vivre avec un trouble de santé mentale, de Mickaël Worms-Ehrminger (éditions Marabout)
Quand et comment est né le projet d’adapter ton podcast en livre ?
De nos jours en France, le podcast reste encore un medium de niche, écouté principalement par des jeunes urbains, et surtout de jeunes urbaines. Aussi, dans le podcast, nous recueillons essentiellement des témoignages, donc des récits de vie subjectifs qui montrent le vécu des témoins et ce qui leur parait important de noter pour aider les auditrices et auditeurs.
Avec le livre, j’ai souhaité élargir le public aux personnes qui ne sont pas encore friandes de podcasts, mais aussi pour remettre en perspective des concepts souvent évoqués dans les témoignages mais qui peuvent demeurer flous hors de la communauté santé mentale.
Au final, il ne s’agit pas tant d’une adaptation du podcast que d’un complément pour pouvoir avoir tous les éléments de compréhension nécessaires à l’appropriation de ces récits précieux que nous avons la chance d’accueillir.
Tu utilises ton parcours de personne ayant des troubles psychiques, ainsi que les témoignages de personnes passées par Les Maux Bleus pour illustrer, incarner, les faits scientifiques que tu présentes dans ce livre. En quoi ce double regard aide-t-il à mieux vulgariser, sensibiliser tout en restant rigoureux ?
En effet, je suis un partisan de l’exemple. Les sujets scientifiques abordés de manière théorique ne passionnent pas les foules, on le sait. Les concepts peuvent être flous, les débats théoriques pas forcément tranchés, ajoutant une complexité qui n’est pas forcément accessible aux non-spécialistes. La littérature scientifique est difficile d’accès, autant linguistiquement que financièrement.
J’ai donné des cours à des lycéens sur le thème des neurosciences, et ce qui les aidait le plus à comprendre et à s’approprier le contenu étaient les exemples : on a toutes et tous dans notre entourage une personne qui souffre de la maladie d’Alzheimer, un grand-père atteint de la maladie de Parkinson, un proche souffrant de dépression ou d’anxiété. L’illustration est un puissant vecteur de vulgarisation et de médiation et l’incarnation par un témoin fait de chair et d’os permet de donner une réalité accessible à des choses qui peuvent paraitre obscures.
Écrire tes troubles (Gilles de la Tourette, TOC, dépression, anxiété sociale, TCA) a-t-il opéré une forme de mise à nu différente que de le faire en podcast pour toi ?
Oui, l’exercice d’écriture est très différent de celui de la prise de parole. La seconde est spontanée (je ne prépare jamais d’éléments de langage écrits) donc on parle de ce qui nous semble le plus important à cet instant T où on s’exprime. L’écriture consiste à figer la parole, à la structurer, à donner des éléments plus structurés. Ça a été une mise à nu dans le sens où cet exercice est plus proche du travail qu’on peut faire en psychothérapie. Je dis souvent que l’écriture de mon témoignage a été une sorte de « thérapie bis » en ce que cet exercice m’a aidé dans ma propre thérapie avec ma psychiatre-psychothérapeute.
Pourquoi le grand public a-t-il encore tant tendance à fantasmer, voire romantiser, certains troubles, y compris les plus communs, comme la dépression, par exemple ?
Dans les sondages où l’on demande aux personnes de dire les mots qui leur passent par la tête quand on parle de santé mentale ou de maladie psychique, on retrouve systématiquement des pathologies relativement rares ou des termes péjoratifs : schizophrénie, troubles bipolaires, folie, dangerosité, incurable… Il y a des représentations ancrées dans la société qui veulent que les troubles psychiques soient caricaturés, notamment par des représentations imagées ou sensationnalistes dans les médias audiovisuels, parce que la maladie mentale ne se voit pas. Or, pour en parler à l’image, il faut qu’on ait des éléments graphiques, donc on véhicule dans l’imaginaire collectif l’idée que ces personnes avec des cas extrêmes et souvent en impasse thérapeutique sont représentatifs des personnes avec un trouble psychique.
Mais, la quasi-totalité des personnes avec un trouble psychique ne se reconnaissent pas à l’œil, ce sont juste des personnes comme les autres. Il y a un manque d’information des plus jeunes sur les sujets de santé et en particulier sur la psychiatrie, qui reste une spécialité honteuse et taboue. La confusion autour des médicaments psychotropes par exemple n’est finalement pas spécifique à la maladie mentale : nous comptons parmi les champions du nombre de consultations médicales débouchant sur une ordonnance de médicament (deux fois plus qu’aux Pays-Bas, par exemple) mais aussi parmi les plus gros prescripteurs et consommateurs d’antibiotiques quand ils ne sont pas nécessaires (infection virale, qui la plupart du temps disparait seule au bout de quelques jours sans traitement particulier). Et pourtant, « les antibiotiques, c’est pas automatique » a près de 20 ans !
C’est très difficile d’atteindre le grand public avec des sujets de santé, car le domaine reste très polarisé et sujet à controverse dans les discours en raison de son caractère nécessairement politique.
« La stigmatisation prend souvent source dans l’ignorance de la maladie mentale par des personnes peu sensibilisées », écris-tu. En quoi cette ignorance peut-elle aussi favoriser une forme d’autostigmatisation des personnes malades ?
Oui, le concept de stigmatisation, qui n’est pas forcément bien connu en dehors des groupes stigmatisés, consiste à « marquer au fer rouge » un groupe de personnes qu’on juge différentes de « la normale » communément acceptée dans l’imaginaire collectif. Les personnes avec un trouble mental étant considérées comme dangereuses, fainéantes, improductives, voire simulatrices pour attirer l’attention (le fameux renvoi encore fréquent à l’hystérie, concept éculé qui ne veut plus rien dire).
Or, on sait grâce aux travaux en psychologie sociale qu’il y a une sorte de résignation à l’opinion majoritaire. Après tout, si les 3/4 de la société pensent que je suis un fou furieux… ils ont peut-être raison de m’exclure. Finalement, on peut finir par se résoudre à accepter négativement ce stigmate, y croire réellement, en se pliant au poids de la majorité, qu’on est un fou furieux et qu’on n’a pas sa place dans la société.
L’autostigmatisation est une énorme source de souffrance, un frein à la recherche de soin, et conduit très souvent à un isolement, qui, lui-même, accentue les troubles existants, voire peut en « activer » d’autres.
En plus de la maladie mentale, on peut aussi subir une forme de douleur sociale pouvant aggraver la souffrance psychique. Dans le livre, tu proposes contre cela qu’on fasse de l’éducation à la santé mentale et aux handicaps dans les écoles dès le plus jeune âge. Comment cela pourrait-il se matérialiser selon toi ?
C’est la question que je me pose depuis longtemps, et sur laquelle je travaille aujourd’hui comme chercheur. Les manières de communiquer sur la santé sont délicates à choisir, car chaque groupe a des spécificités, tout le monde n’est pas réceptif au même format (podcast, livre, vidéos, rencontre de visu, …), des personnes n’éprouveront jamais d’intérêt pour le sujet, les informations contradictoires trouvées sur internet peuvent mettre à mal l’appropriation des connaissances scientifiques actuelles et finalement démotiver les personnes à se renseigner sur le sujet.
D’autant plus qu’une croyance est extrêmement difficile à modifier une fois qu’elle est ancrée, et elle s’ancre souvent très rapidement : on le voit, les articles de presse relayant une fausse information continueront à être beaucoup plus partagés que le communiqué de démenti qui suivra.
Quand on a accepté un fait (comme la fausse dangerosité des personnes avec un trouble mental), cela demande un gros effort de revenir en arrière, effort qu’on juge souvent inutile. La recherche nous éclaire sur les meilleures pratiques, mais cela prend du temps de les rendre opérationnel et les mettre en œuvre, puis surtout évaluer leur efficacité pour pouvoir proposer des versions améliorées au fil du temps.
En revanche, on sait que l’apprentissage des compétences psychosociales (s’affirmer, dire non, prendre des décisions réfléchies, entretenir des relations saines, identifier ses émotions…) à l’école fonctionne plutôt bien, par exemple pour prévenir l’entrée dans les conduites addictives. À suivre, donc…
Qu’est-ce que la désertification médicale et psychologique révèle du manque de politisation des enjeux de santé, dont mentale ? A-t-on trop tendance à traiter les troubles psychiques comme des maladies mentales personnelles, et pas assez comme un enjeu de santé publique ?
Oui, malheureusement, même au niveau politique, la maladie mentale peine à se faire une place pour être considérée comme une vraie maladie, qui engendre des souffrances et qui n’est pas une « fragilité personnelle ». On le sait aujourd’hui, de nombreux facteurs contribuent à la genèse de troubles mentaux : vulnérabilité génétique, modes et milieu de vie, traumatismes et/ou violences dans l’enfance, inaccessibilité des soins, etc. On appelle cela le modèle biopsychosocial. Mais on reste bloqué en France sur un modèle purement biomédical : la maladie mentale doit se soigner avec des médicaments uniquement, sinon on laisse tomber.
Or, toute la littérature montre que l’approche nécessaire est d’abord la psychothérapie et ensuite des médicaments si la thérapie ne suffit pas ou si le trouble est très handicapant et a des traitements indiqués pour sa gestion.
La composante thérapeutique est totalement négligée : par exemple, pour les dépressions légères à modérée, on va voir son médecin traitant (remboursé, contrairement aux thérapies avec un psychologue) qui par manque de temps ou de connaissance, prescrira le plus souvent des antidépresseurs (ou des anxiolytiques, inadaptés et mal prescrits). C’est une aberration de ne proposer que cela en premier recours : les dépressions légères à modérées se traitent par une psychothérapie, et les antidépresseurs ne sont pas indiqués dans ces cas la plupart du temps, car ils n’ont montré d’effet majeur que dans les dépressions sévères !
Nous avons une très mauvaise vision de la santé publique en France, voire une incapacité à même la définir parmi les décideurs, et les politiques mises en place en pâtissent car elles ne sont pas du tout adaptées ni suivies.
Nous n’avons tiré aucune leçon de la pandémie, la prévention n’a pas sa place en France : le SRAS-Cov2 est le troisième coronavirus à se diffuser depuis l’an 2000, et les agences de renseignements qui travaillent sur les risques possibles à venir alertaient déjà sur le risque d’une pandémie d’un prochain coronavirus venu d’Asie ! Et ce, plusieurs années déjà avant l’apparition de la COVID !
Faute de finances et de connaissances pour savoir vers quelles ressources fiables se tourner, beaucoup de personnes s’autodiagnostiquent sur Internet, notamment sur TikTok. Qu’en penses-tu ? En quoi cela peut-il être dangereux ?
D’un certain côté, je ne pourrais pas balayer l’utilité possible d’un autodiagnostic quand les professionnels ne veulent pas entendre la souffrance. Cela dit, l’autodiagnostic ne doit rester qu’une supposition en suspens dans l’attente de consulter un professionnel qualifié pour le confirmer ou l’infirmer. Or, il a tendance aujourd’hui à servir de marqueur identitaire, sans réellement aller en chercher la réalité.
Plusieurs études ont été menées sur les contenus de santé mentale relayées sur TikTok, et elles sont terrifiantes. Selon les sujets, entre les trois-quarts et la totalité des contenus sont trompeurs, voire carrément mensongers. Des conseils dangereux sont mis en avant par des personnes sans qualification, pouvant mener à de graves dégâts, voire le décès par suicide.
On voit parfois sur d’autres réseaux, comme X-Twitter, des personnes écrire « selon TikTok, j’ai un TDAH » ou encore « à chaque fois que je vais sur TikTok, j’ai envie de courir chez un psychiatre, parce que soit je suis autiste, soit j’ai un TDAH ou un TDI ». Il faut garder à l’esprit qu’un diagnostic, a fortiori un autodiagnostic, n’est qu’une porte d’entrée dans le soin et en aucun cas une manière de s’identifier : en faisant cela, on accentue la stigmatisation et la partition de la société entre les « gens normaux » et les « malades mentaux ».
Qu’est-ce que la pair-aidance en matière de santé mentale, et en quoi peut-elle donner de l’espoir à des personnes malades ?
La pair-aidance est un concept qui se développe depuis peu en France, et malheureusement difficile en raison du peu d’intérêt des politiques et de certaines réticences de médecins voulant garder une position d’autorité sur la prise en charge, sans jamais se remettre en question et accepter que le savoir expérientiel a une réelle valeur.
La pair-aidance consiste, en complément de la prise en charge médicale et psychologique, à faire accompagner les patients par des personnes qui ont le même trouble qu’elle et qui se sont rétablies. C’est une forme de soutien et de message d’espoir pour les personnes qui se pensent condamnées à la souffrance et le rejet à vie. Le pair-aidant peut donner son expérience de prise en charge et être une illustration réelle qu’il est (quasiment, je ne vais pas mentir) toujours possible de se rétablir et d’aller mieux, et même d’aller bien ! Le pair-aidant se retrouve également renforcé car il donne un sens à son parcours et retrouve le plaisir de pouvoir aider autrui, ce qui contribue encore plus à son rétablissement.
Dans ton livre, tu notes que le podcast Les Maux Bleus est écouté par 75% de femmes. Comment expliques-tu que les hommes, pourtant autant à risque que les femmes, refusent tant de parler de santé mentale, y compris à un professionnel, ce qui peut aggraver la sévérité de leurs troubles ?
En effet, la maladie mentale n’épargne personne. Dans les représentations historiques et culturelles qui persistent malgré tout à de nombreux endroits, l’homme est un être fort, supérieur, qui ne doit montrer aucun signe de ce qui pourrait être considéré comme une faiblesse. La maladie mentale doit donc être tue, et la souffrance masculine est souvent sujette au déni même de la personne qui en souffre.
Quand les femmes sont plus promptes à aller consulter ou à se confier à des proches, les hommes « s’autosoignent » souvent avec une bouteille ou une cigarette, voire des comportements à risque. Ce qui fait que les hommes, quand ils acceptent d’être pris en charge, quand la douleur est devenue tellement insupportable qu’ils finissent par se rendre à l’évidence d’un besoin d’aide professionnelle, le pronostic est moins favorable, parce que les troubles sont plus installés et plus avancés dans leur sévérité.
Il y a d’ailleurs ce paradoxe de genre sur le suicide : on compte beaucoup plus de tentatives de suicide parmi les femmes, et beaucoup plus de décès par suicide parmi les hommes ! Cela s’explique par le fait que les hommes préfèrent souvent taire leur souffrance le plus longtemps possible, ne voyant comme ultime alternative la mort pour soulager la douleur : et là, aussi, l’homme se doit de donner une image de « force », en utilisant notamment des moyens létaux et méthodes plus violentes que les femmes.
À lire aussi : Les personnes transgenres sont plus à risque de tentatives de suicide, reconfirme une nouvelle étude au Danemark
Dans beaucoup de couples hétéros, les femmes servent parfois de psy de fortune aux hommes. Quels peuvent en être les effets néfastes pour les deux membres du couple ?
Se confier à un proche est un premier pas qui peut mener vers une prise en charge. Cela dit, ce n’est pas le rôle de sa conjointe ou son conjoint d’assumer la charge de la souffrance, tout simplement parce qu’il ou elle n’est pas qualifié·e pour la recueillir de manière neutre et bienveillante, et parce qu’elle est engagée dans une relation sentimentale et émotionnelle qui ne permet pas de faire avancer la situation. Dites à un proche que vous avez des idées suicidaires, et vous verrez sa réaction. Aussi, la personne qui écoute peut ne pas être prête ou armée pour faire face à ce qu’elle entend ; elle doit respecter ses propres limites, au risque d’y laisser sa propre santé mentale. Une aide professionnelle est nécessaire : quand on veut une belle coupe, on va chez un coiffeur diplômé, pas chez la cousine boulangère. En revanche, on peut demander à la cousine l’adresse de son coiffeur !
Quels conseils donnerais-tu aux hommes pour qu’ils prennent (mieux) en charge leur santé mentale (outre voir un psy et écouter Les Maux Bleus, évidemment) ?
Question très compliquée ! Elle rejoint celle de la sensibilisation à l’école. L’identité de genre, l’orientation sexuelle, la catégorie socio-professionnelle, l’histoire personnelle, l’entourage sont autant de facteurs (liste non-exhaustive, bien entendu) qui peuvent moduler l’acceptation d’un tel message. À part une approche systématisée avec des bilans de santé décennaux par exemple en intégrant cette composante psychique, ou un entretien avec la médecine du travail, l’intégration dans les consultations généralistes de quelques questions sur ce sujet, peuvent confronter les hommes à ce sujet auxquels ils ne pensent pas forcément. Les conseils doivent donc être adaptés selon le groupe d’homme, par exemple avec des campagnes d’affichage dans les toilettes masculines, dans les vestiaires de sport, par l’intervention de personnalités masculines influentes, etc.
À lire aussi : La robe du rappeur Kid Cudi en hommage à Kurt Cobain parle autant de masculinités que de santé mentale
Les personnes queers sont surexposés aux troubles de santé mentale et conduites à risque. Comment l’expliques-tu ? Qu’est-ce que cela révèle des LGBTIphobies ?
La stigmatisation en raison d’un trouble de santé mentale peut se cumuler avec celle de l’origine, de la religion, de l’apparence, de l’identité de genre, de l’orientation sexuelle ou la manière d’être au monde. C’est pourquoi une approche intersectionnelle est plus que nécessaire.
Les personnes queers font très souvent, quasiment toujours en fait, l’expérience toute leur vie de violences verbales, physiques, de ce qu’on appelle aussi des micro-agressions (par exemple des propos maladroits mais blessants, pas forcément à dessein). On peut finir par vivre dans la crainte de ce qui pourrait encore nous arriver au quotidien comme vécu blessant. Cela fragilise l’estime de soi et peut modifier l’image qu’on a de soi. Cela peut aussi conduire à un repli sur soi, jamais positif.
Ces traumatismes à répétition sont de nature à provoquer des troubles de santé mentale, et c’est pourquoi les groupes considérés comme minoritaires, à l’instar des personnes queers, sont plus sujettes à ces troubles. N’oublions pas d’ailleurs aussi que l’homosexualité n’est plus dans la liste « officielles » des maladies mentales depuis très récemment et que dans de nombreux pays, les identités considérées localement comme « inacceptables » ou « anormales » sont sévèrement réprimées, parfois jusqu’à la condamnation à mort…
« Le sentiment d’avoir le pouvoir sur son destin est un facteur d’amélioration de la qualité de vie, des symptômes, mais aussi du fonctionnement psychosocial », écris-tu. En quoi tenir le podcast et rédiger ce livre t’a aidé, toi personnellement ? Et quels sont tes prochains projets dans cette continuité ?
Cela m’a permis de reprendre le contrôle sur ma vie, de retrouver un sens à ce que je faisais, dans une période où j’allais moi-même extrêmement mal. J’avais envie d’apaiser mes souffrances, mais la prise en charge m’était financièrement inaccessible. J’envisageais sérieusement de m’enlever la vie pour faire taire cette souffrance. Mais un ami m’a sauvé en quelques mots par SMS. J’ai eu envie de donner une utilité à cette expérience terrible, car je sais que beaucoup de personnes traversent des périodes extrêmement difficiles et qu’il est difficile de trouver de l’aide. Et c’est justement le fait d’aider qui m’a moi-même aidé, j’avais retrouvé une « utilité ».
Dans la continuité, je continue l’enseignement en santé, j’accompagne des institutions sur le sujet de la santé mentale, et je continue mon travail de chercheur, avec comme objectif principal d’améliorer la communication sur la santé mentale pour tenter de changer les attitudes et comportements.
Vivre avec un trouble de santé mentale, de Mickaël Worms-Ehrminger (éditions Marabout)
Vous avez des pensées suicidaires et ressentez le besoin d’en parler ? Des associations peuvent vous venir en aide.
- SOS Suicide Phénix Ecoute
- Fil Santés Jeunes
- Ligne Azur (information et soutien pour les victimes d’homophobie)
- France dépression (ligne d’écoute, de soutien et d’information pour les personnes dépressives ou atteintes de troubles bipolaires)
Et si le film que vous alliez voir ce soir était une bouse ? Chaque semaine, Kalindi Ramphul vous offre son avis sur LE film à voir (ou pas) dans l’émission Le seul avis qui compte.




































Les Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaire sur cet article.