Ce n’est plus un bruissement, mais une lame de fond. Peut-être même le début d’une nouvelle révolution qu’est en train de vivre le cinéma français. En 2017, quand a éclaté l’affaire Weinstein, notre pays a eu bien du mal à prendre le train du bouleversement qui se mettait en branle, encore attaché à la figure sacrée du réalisateur, de l’acteur. Et du mal à comprendre que les femmes qui dénoncent – souvent au prix de leur carrière – le faisaient dans un souci de justice et de réparation, non par soif de vengeance.
Mais ce mur d’impunité dont a longtemps joui le cinéma français commence lentement à se craqueler. Il y a évidemment eu Adèle Haenel, qui s’est levée et s’est cassée en 2020 lorsque Roman Polanski a reçu le César du meilleur réalisateur. Et toutes celles qui ont parlé après elles dans les affaires Luc Besson, Nicolas Bedos, Philippe Garrel, Philippe Caubère, Frédéric Beigbeder, Richard Berry… Ces dernières mois, d’autres noms se sont ajoutés à cette longue liste d’auteurs présumés de violences sexuelles : celui de Gérard Depardieu, accusé par plusieurs femmes, dont la comédienne Charlotte Arnould, de viol. Et ceux des cinéastes Benoît Jacquot et Jacques Doillon, mis en cause par Judith Godrèche, Isild Le Besco ou encore Anna Mouglalis. Et plus récemment, Nils Tavernier, Philippe Lioret ou encore ce réalisateur croate, Dalibor Matanic, qui a avoué avoir agressé sexuellement près de 200 femmes.
Le monde du cinéma est-il enfin prêt à faire son introspection et à écouter les femmes qui dénoncent les violences qu’il abrite ? Et à leur laisser enfin la place qu’elles méritent, devant et derrière la caméra, ainsi que sur les plateaux de tournage ? À l’occasion de la 49e cérémonie des César, nous avions posé la question à Sophie Lainé-Diodovic. Directrice de casting et administratrice du Collectif 50/50, elle en appelle à une prise de conscience de tout le milieu du cinéma.
Madmoizelle. Avez-vous le sentiment, au Collectif et personnellement, que le milieu du cinéma a évolué sur la question des violences sexistes et sexuelles depuis #MeToo ?
Sophie Lainé-Diodovic. C’est la société, plus que le cinéma qui a évolué. Le cinéma essaie de rattraper cette évolution. Mais il est plus lent qu’elle. Comme souvent, la société va plus vite que les institutions.
Aux États-Unis, #MeToo a commencé avec l’affaire Weinstein et cela a été beaucoup plus rapide qu’en France…
Oui, aussi parce qu’ils ont eu un « gros poisson » avec Weinstein. Il y avait tellement de plaintes qu’ils n’ont pas eu le choix.
En France, le problème est que souvent la parole se libère mais que les plaintes ne suivent pas toujours. Comme il faut toujours que la justice s’empare de ces affaires, elles ne font pas assez de bruit ou en tout cas, elles sont éteintes par la présomption d’innocence. À chaque fois c’est la même chose, on nous dit « les femmes parlent mais il n’y pas de plaintes, et il faut respecter la présomption d’innocence…»
Les institutions agissent toujours en fonction des condamnations et on sait en France qu’elles sont très peu nombreuses, voire nulles. En fait, je n’en connais aucune. La récente affaire Depardieu aura au moins servi à créer de la cohésion dans nos métiers. Il y a d’ailleurs un rapprochement à faire entre Gérard Depardieu et Harvey Weinstein car ce sont deux figures de cinéma extrêmement puissantes.
Les actrices qui parlent sont celles qui acceptent de sacrifier leur carrière.
Sophie Lainé-Diodovic
Les États-Unis ont une longueur d’avance sur la France, d’abord parce que l’histoire du féminisme y est beaucoup plus ancienne et radicale. Aux États-Unis, il y a de puissants lobbies quand en France, on a l’impression de n’être que de petites associations. Le Collectif 50/50 est le premier à avoir un poids, à se faire entendre. On a obtenu des avancées concernant la parité que je ne pensais pas pouvoir exister. Mais les réflexions se font au CNC, au ministère de la Culture, aux César… On prend en compte ce sujet tout en restant très frileux. Il y a un état de conscience qui est enfin là, mais l’action qu’elle doit entraîner derrière est beaucoup plus lente à arriver. Et je pense que c’est un symptôme très franco-français.
Les résistances viennent-elles seulement des institutions dans le monde du cinéma ? Depuis la prise de parole de Judith Godrèche, on a entendu des actrices prendre sa défense comme Anouk Grinberg ou Anna Mouglalis, mais très peu d’acteurs…
Celles qui parlent sont soit des actrices qui ne sont pas connues du public et sont donc invisibles. Soit elles sont connues, mais ont compris que si ça les empêchait de travailler, ce n’était plus leur sujet. Elles ont presque accepté de sacrifier leur carrière. Cela montre à quel point elles ont intégré que parler les empêchera de travailler.
Cette peur est peut-être fictive, mais elle est suffisamment présente dans la tête des gens. Même moi, quand je parle aux journalistes, j’ai peur de trop parler, de trop m’exposer, pourtant je ne suis que directrice de casting, je fais un métier de l’ombre. J’ai peur que ça m’empêche de travailler avec certains réalisateurs, certaines boîtes de production… On a l’impression que les acteurs connus sont puissants, mais ils ont peur de perdre cette puissance en parlant. Je pense aussi que ce sujet n’est pas acquis dans nos métiers. Ça touche à notre culture de cinéma, de création. Dans le cinéma, que la violence soit morale ou physique, on a l’impression qu’elle peut faire partie de l’artiste, qui aurait « sa part d’ombre ». Que c’est ce qui le rend génial et créatif. Ça a été valorisé pendant des décennies.
Cependant, les sociétés de production aussi prennent des mesures. Je pense qu’elles ont peur que les films ne soient plus faits, ne soient plus vus, ou bien d’embaucher des personnes accusées. Elles ont peur que leurs films soient morts avant de naître. C’est aussi par ce biais qu’ils prennent ce sujet au sérieux, c’est pour cela qu’il y a des formations, des initiatives de prises.
C’est le cas notamment de Samuel Theis, qui a été accusé de viol par un technicien et qui a dû réaliser son film à distance. Comment jugez-vous ce dispositif ?
Ça n’avait jamais été fait, donc c’est un signe assez positif de voir qu’une productrice a considéré la chose. Avant, on faisait en sorte d’éteindre le feu en espérant qu’on passe vite à autre chose. Elle n’a pas essayé de mettre les choses sous le tapis et les équipes l’ont aussi empêché de le faire.
Quant au protocole d’éloignement, c’est une mesure en attendant de pouvoir faire mieux puisqu’encore une fois, une accusation n’a pas de valeur aux yeux de la justice. La productrice était coincée dans ce qu’elle peut faire en tant qu’employeuse. Vis-à-vis des assurances, il faut une plainte et une lettre au procureur pour permettre qu’on arrête le film et pour gérer le tournage. C’est aussi une histoire d’argent : si on n’aide pas les entreprises à gérer les crises, ils ne peuvent pas le faire.
Qu’en est-il des référents harcèlement ? Est-ce que leur formation et leur travail sur les plateaux fonctionnent ?
Ce dont j’ai l’impression, c’est qu’on a fait des choses en théorie mais pas en pratique. On a sensibilisé les employeurs et employeuses mais ensuite, à part des mails, que se passe-t-il ? Même quand elles (ce sont souvent des femmes qui le font) font la formation de trois jours, on les empêche de mener à bien leur travail parce que c’est considéré comme une perte de temps et d’argent. Les tournages sont des temps très courts, il y a de moins en moins d’argent. La plupart du temps, les référents harcèlement sont des personnes de l’équipe et le moindre petit souci demande, pour le régler, qu’on prenne du temps sur le temps de travail. Or, ce n’est pas toujours accordé, notamment lorsqu’on signale du harcèlement moral.
Ce qui est compliqué aussi, c’est que le cinéma est une entreprise, mais les employeurs oublient que ce sont des chefs d’entreprise. Ils oublient que leurs responsabilités sont énormes. Si les employeurs n’imposent pas cette rigueur à leurs équipes, dans un discours clair et ferme, forcément, ça empêche la parole. Ils doivent s’engager à cela, mais heureusement, je sens que ça bouge.
Des victimes potentielles de violences ou de harcèlement vous contactent-elles ?
Nous sommes un collectif, pas la police ou la justice. On fait du lobbying pour rappeler aux gens leurs responsabilités et qu’ils doivent se former, connaître le code du travail, le code pénal. On est là pour rappeler des informations, fournir des outils. C’est parfois compliqué car les gens attendent de nous des choses qu’on ne peut pas faire. Par exemple, nous ne sommes pas une cellule d’écoute. À part fournir aux personnes les outils et les orienter vers les personnes compétentes pour les aider, on ne peut pas faire grand chose.
Quand on a des appels, évidemment on les écoute. Parfois, certaines personnes nous appellent juste parce qu’elles ont besoin d’une écoute bienveillante. On leur demande alors ce qu’elles souhaitent faire, et on les redirige vers les bonnes personnes, mais c’est tout ce que l’on peut faire.
Les coordinateurs d’intimité ont-ils aussi un rôle à jouer pour le bien-être sur les plateaux de tournage ?
Pour moi, le coordinateur d’intimité joue un rôle indispensable. Je le compare au coordinateur de cascade. Quand on emploie des cascadeurs, on emploie aussi des coordinateurs pour garantir qu’ils ne se blessent pas. Ce qui est marrant, c’est qu’on ne demande jamais à un réalisateur s’il veut un coordinateur de cascades, il n’a pas le choix. Alors que pour un coordinateur d’intimité, oui. Les productions devraient l’imposer lorsqu’il y a des scènes d’intimité ou de violences, conjugales ou sexuelles. Il y a déjà eu des violences sexistes et sexuelles dans des scènes d’intimité, c’est ce dont parle notamment Judith Godrèche dans son témoignage sur Jacques Doillon. Or, il faut rappeler que l’employeur a l’obligation d’assurer la sécurité de ses équipes, c’est dans le Code du Travail.
Peut-être plus qu’une autre, l’année 2023 a rendu évident le travail brillant des réalisatrices, qui ont signé des films excellents comme Anatomie d’une chute, Simple comme Sylvain, Le Ravissement, L’été dernier… Est-ce le signe d’une concrétisation du travail du Collectif ?
On est fières et on s’est rendues compte que les femmes réalisatrices brillent à l’international. C’est le cas de Justine Triet, mais aussi de Julia Ducournau. À l’international, le cinéma français est représenté par des femmes. Donc elles devraient être mieux représentées en France. On est ravies qu’elles aient accès à plus de financements pour leurs films, qu’elles soient considérées au même endroit que les hommes, même si on n’en est pas encore à la parité. Oui, elles sont plus nombreuses, plus visibles qu’avant. Mais les chiffres ne sont pas encore suffisants.
Aussi, quand ça avance d’un côté, on rappelle que ça n’avance pas dans d’autres. Par exemple, on avance sur cette question des réalisatrices, mais on pose les autres questions : qu’en est-il des techniciennes ? Des rôles de femmes ? La parité doit être partout, pas seulement chez les réalisatrices.
Cette année dans les nominations aux César, il y a plus de femmes que d’hommes nommées dans la catégorie « Meilleur·e réalisateur·ice ». Mais ce n’est pas le cas dans les autres catégories…
C’est pour cela qu’au Collectif, nous sommes aussi là pour rappeler que ce n’est pas parce qu’il y a un progrès dans une catégorie que le progrès est partout. C’est évidemment super qu’il y ait trois femmes sur les cinq nommé·es, mais il n’y a pas qu’une seule catégorie aux César. C’est aussi pour cette raison qu’on a critiqué le manque de diversité aux révélations. Sur les 32 révélations pré-nommé·es, il y avait quand même douze comédiens et comédiennes qui représentaient la diversité. Et au final, on finit avec dix nommé.es blanc.hes.
On a parfois l’impression que les gens qui votent ne regardent pas les films. L’inclusion, la parité, la diversité, c’est aussi parmi les votants qu’elle doit se refléter. C’est aussi pour cela qu’on a communiqué auprès des gens du métier pour les inciter à postuler pour être votants à l’Académie. Parce que si les votants restent majoritairement des hommes blancs, c’est sûr que les résultats vont refléter ce choix. C’est aussi pour cette raison qu’on a créé la Bible 50/50, pour répondre à la justification « mais on ne connaît pas de femme technicienne ou de technicien racisé ». Les gens peuvent s’y inscrire pour montrer aux employeurs ou aux réalisateurs qu’ils existent, que c’est juste qu’ils font toujours appel aux mêmes personnes. Comme on fait toujours appel aux mêmes acteurs connus, on fait aussi appel aux mêmes techniciens connus – des hommes blancs la plupart du temps – et le milieu du cinéma ne s’ouvre pas, ne se renouvelle jamais. Il est temps que ça change.
Et si le film que vous alliez voir ce soir était une bouse ? Chaque semaine, Kalindi Ramphul vous offre son avis sur LE film à voir (ou pas) dans l’émission Le seul avis qui compte.








![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/05/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-05-22t164945311-768x432.jpg?resize=300,350&key=638f1da8)


![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-28t150710132-768x432.jpg?resize=300,350&key=0dbf06ef)

![[Image de une] Horizontale (26) [Image de une] Horizontale (26)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/image-de-une-horizontale-26-768x432.jpg?resize=300,350&key=3f4065eb)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-15t163147788-768x432.jpg?resize=300,350&key=c0e2a724)
![[Image de une] Horizontale (24) [Image de une] Horizontale (24)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/image-de-une-horizontale-24-768x432.jpg?resize=300,350&key=bd0cfdc3)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-16t173042478-768x432.jpg?resize=300,350&key=e6ae1102)









![Copie de [Image de une] Horizontale (84) Copie de [Image de une] Horizontale (84)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/12/copie-de-image-de-une-horizontale-84-768x432.jpg?resize=300,350&key=30319f9e)



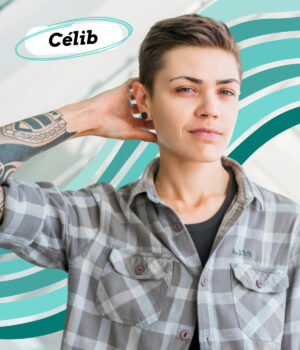







Les Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaire sur cet article.