Le viol conjugal, ça reste un tabou. Le viol est déjà tabou en lui-même. On n’en parle pas, ou si peu, en baissant la voix… Pourtant, des femmes (et des hommes) violé-e-s, on en croise tous les jours.
Je suis toujours choquée d’entendre autant de « Tu sais, moi aussi… » quand je raconte mon histoire, quand je casse la barrière de « la victime digne », celle qui se fait oublier. Moi aussi, ça m’est arrivé. Moi aussi, j’ai un-e ami-e, ou plusieurs, qui ont vécu ça.
Mais le viol conjugal gagne des sommets en la matière. Il est invisible, et il reste nié par beaucoup. Pour exemple, Bruno Gollnisch (du FN, vous savez le premier parti de France aux dernières élections ? ), qui a cru bon de déclarer en 2011 :
« Quand je faisais mon droit, il n’y avait pas de viol entre époux. On en était resté à la sagesse traditionnelle selon laquelle le mariage comportait en principe, comme l’avait déclaré un sociologue, une exclusivité donnée par chaque époux à l’autre sur son corps.
(…) il est beaucoup plus grave (et plus lourdement condamné) pour un homme de « violer » sa femme dans le lit conjugal où elle est entrée volontairement que de violer la femme d’un autre, inconnue agressée dans un parking ou un chemin sombre. On croit rêver… »
Je ne prendrai pas la peine de démontrer point par point l’absurdité et la violence de ce commentaire, parfait produit de la culture du viol.
Mais en tant que victime de violence, et en tant qu’amie de victimes de violences, je me dis que plus je serai silencieuse, plus certains s’octroieront le droit de faire ce genre de déclaration. Le genre qui dit aux victimes qu’elles sont deux fois coupables : coupables d’avoir été là au mauvais moment, et coupables de se plaindre.
Qu’elles souffrent en silence ; leurs douleurs n’existent pas, leurs intégrités n’existent plus. Qu’elles crèvent en silence : elles ne sont pas complètement humaines, puisqu’on peut nier leurs paroles, leurs volontés et leurs corps.

Et pour ma part, j’aimerais qu’on arrête deux minutes de nous insulter ainsi. C’est bien trop facile : on ne nous voit jamais. Facile de cracher sur une masse anonyme, facile même de laisser entendre qu’il y a pas de victimes finalement.
Je vais enlever mon masque, et je vais vous raconter comment j’ai vécu la survie à un viol conjugal. En anglais, pour désigner une victime de viol, on utilise le terme de « survivor ». Ça valorise la force qu’a eu la victime pour continuer à vivre, plutôt que de souligner le fait qu’elle a subi quelque chose. Et ça mérite d’être souligné, parce que c’est ça le plus important : nous avons survécu.
Nous avons gagné.
Une relation toxique
Je vais contextualiser le plus simplement possible : je suis restée deux ans avec mon violeur. Notre première fois, ma première fois, a été un viol : j’ai dit non, et il m’a forcée. Mais je n’ai pas été en mesure de l’identifier ainsi à l’époque. J’ai cru que c’était ça, la norme. Contraindre.
Nous avons eu par la suite des relations régulières. Je n’ai plus dit « Non ». Mais étant donné que notre relation était basée sur l’idée que je devrais de toute façon céder, que je le veuille réellement ou non, je ne suis pas sûre qu’on puisse parler de relations consenties. Même si j’en avais envie, souvent. Même si j’y ai pris du plaisir, parfois. Parce que c’était bien le problème : que j’aie mal ou je prenne du plaisir, que j’en aie envie ou non et que je sois d’accord ou non, c’était au final anecdotique.
L’ensemble de notre relation était très toxique, mais j’étais aveugle : il y avait des bons moments, et c’est tout ce que je voyais. Je le sentais très attaché à moi, très possessif, et j’ai cru que c’était ça l’amour. Que ça pouvait tout justifier.
Mais en deux ans, j’ai commencé à me rapprocher des milieux féministes (via madmoiZelle, d’ailleurs), et à réfléchir à la notion de viol et de consentement. Par ailleurs notre relation a décliné, et les bons moments se sont fait rares.
Est arrivé le moment où je n’avais plus du tout envie de lui. Je ne voulais pas, ou plus, « faire d’efforts ». Qu’il me touche me dégoûtait. Et j’ai dit non, à nouveau, comme la première fois.
Je ne raconterai pas l’acte en lui-même, parce que c’est juste un fait sordide, et que vous pouvez très bien l’imaginer sans mon aide.
Je serais tentée de me justifier. De dire que j’ai vraiment essayé de m’opposer, que j’ai insisté, que je l’ai repoussé… mais ça n’a servi à rien, et je suis finalement restée figée, à regarder le plafond, avec l’impression d’être une poupée de chiffons. Une poupée glacée, sans sensations ni émotions.
Mais au final, s’il y a bien une morale dans cette histoire, c’est celle ça : j’ai dit non, et ça aurait dû être suffisant. Je n’ai pas à me justifier. Je n’ai pas été faible, j’ai fait de mon mieux. Mon mieux n’était juste pas suffisant dans cette situation.
Cette fois a été la fois de trop. Ce n’était pas le premier viol, finalement, mais c’est le premier que j’ai vécu comme tel.

Tout de suite après, il y a eu le déni pur et simple.
Je crois que je serais devenue folle sans. Mon esprit s’est automatiquement débranché, et a rejeté en bloc les souvenirs, pour n’en laisser que quelques images désincarnées.
Il y avait juste quelques mots qui tournait dans ma tête : plus jamais. Plus jamais ça.
Mon violeur est parti au matin, comme d’habitude. Je l’ai appelé quelques jours après, et je lui ai dit que je le quittais. Je sentais confusément qu’il fallait à n’importe quel prix que j’empêche cet événement de se reproduire une fois de plus. J’y aurais laissé ma santé mentale, sinon ma vie.
J’ai donc sorti cet homme de ma vie. Puis j’ai tout mis dans un coin, et j’ai décidé que j’allais continuer de vivre, coûte que coûte. Ce n’était pas du courage, c’était juste la conscience que si je m’arrêtais pour reprendre mon souffle, je ne serais pas forcément capable de repartir ensuite.
Je voulais toujours vivre. Alors j’ai continué à sortir, à étudier, à danser, à lire et à rire – plus que jamais, même avec cette impression tenace d’être morte à l’intérieur, un goût de cendres dans la bouche.
La prise de conscience
Mais les souvenirs sont vite revenus.
La première fois que j’ai couché avec un autre homme, quinze jours après avoir quitté mon violeur, ça a été une grande révélation Alors c’était ça le sexe. Ce n’était pas la peur, le malaise. On pouvait choisir. On pouvait être respectée. L’autre n’est pas obligé de vous faire plier, l’autre peut très bien entendre votre « non ».
J’ai réalisé tout ça, sans mettre de mots, juste des sensations. J’ai fait une crise d’angoisse entre ses bras. Et c’est lui qui a formulé le problème : « Tu sais, j’ai eu une amie, elle faisait des crises d’angoisses parfois après le sexe. Elle avait été violée ».
J’ai eu un gros débat avec moi-même : était-ce un viol ?
J’avais toujours cette idée qu’une victime de viol se faisait forcément passer à tabac, qu’elle avait lutté de toutes ces forces. J’étais bien moins à plaindre que les personnes terrorisées, celles qui ont attendu que ça passe en tremblant pour leurs vies.
Ça n’était pas mon cas. Mes viols étaient sans réelle violence physique. Ils étaient enrobés de tendresse et de douceur. Mais on peut agresser quelqu’un en lui chuchotant des mots doux en même temps : ça n’a rien d’incompatible. C’est de la manipulation psychologique : on perturbe suffisamment quelqu’un pour qu’il ne fasse plus la part des choses entre ce qui est normal et ce qui ne l’est pas, pour qu’il associe naturellement viol et amour.
Et c’est pour ça que je lui en veux le plus, c’est ça qui est le plus terrible, à mes yeux, dans le viol conjugal – faire croire qu’on peut agresser les gens par amour, qu’un viol est une preuve d’affection. Six mois après l’avoir quitté, j’ai toujours peur quand on me touche avec tendresse. Je me demande ce que ça cache. Je me demande quand et à quel point l’homme avec qui je suis me le fera payer.
La survie
Suite à cela, il a fallu faire face à cette réalité : j’avais été violée.
Il y a d’abord eu la réaction physique. Mon esprit s’était arrêté de tourner et mon corps entier s’est révolté. C’était comme avoir de la fièvre, c’était comme délirer et sentir son corps se déliter.

Ça a été des semaines noires : difficile de gérer au jour le jour une carcasse qui se laisse mourir. Impossible de manger normalement, rien ne passait. Impossible de dormir puisque mon cerveau tournait à vide, incapable de lâcher prise. Je regardais le plafond toutes les nuits, je sombrais dans des léthargies de deux heures, et je me levais, épuisée.
J’ai regardé mon corps se détériorer, et je crois que c’était comme une maladie : il faut d’abord souffrir un bon coup avant d’aller mieux. J’ai regardé mon corps fondre, les os de mes côtes et de mes hanches se dessiner avec de plus en plus de netteté. Ce n’était plus le même corps que celui qui avait subi le viol. J’avais, d’une certaine façon, réussi à faire disparaître l’ancien.
Ça a aussi été une période de violentes crises d’angoisses. Mon corps hurlait, mon esprit expiait… trop de terreur pour une seule personne. Et ça a été une période où je me suis auto-mutilée. Faire souffrir mon corps était, à mes yeux, le meilleur moyen de me prouver qu’il m’appartenait toujours.
Je pouvais « choisir » la souffrance, et non plus la subir par le biais d’autrui. Et puis quelques égratignures face à toute cette douleur… c’était dérisoire. C’était aussi l’expression d’une honte. Je me « marquais » comme on signale un objet cassé.
J’ai également couché avec pas mal de gens à cette période. Certaines fois ont été sans désir, si ce n’est celui de me prouver que c’était mon corps, et que je le partageais avec le premier venu si ça me chantait.
Mais il y a eu des belles rencontres, de très belles fois. Cette période de sexe effréné m’a permis de découvrir le plaisir, le partage, le respect et l’écoute, et je pense sincèrement que c’est ce qui m’a sauvée.
La perception du viol (conjugal) par la société
J’en ai parlé autour de moi, très peu au début, et un peu plus par la suite.
Certains amies n’ont pas eu envie de l’entendre. Elles ont été là, elles ont essayé de me changer les idées, elles m’ont fait rire et elle m’ont entourée d’énormément d’amour. Mais le sujet du viol en lui-même a été soigneusement évité, ou remis en cause. L’idée que je m’étais laissée faire, que j’avais fait preuve de faiblesse en n’étant pas capable de me défendre davantage est revenue dans plusieurs bouches.
Et j’ai dû me battre pour qu’elles comprennent, parce que la plupart ont entendu mes mots mais n’ont pas identifié les actes comme étant un viol. Les euphémismes ont fait surface : elles disaient « il a dérapé », « il a forcé » ou « il a abusé ».
Les euphémismes, c’était un bon moyen d’ignorer l’éléphant dans la pièce, parce que c’était trop effrayant pour elles comme pour moi de regarder ces horreurs en face. Je peux difficilement leur en vouloir : je crois qu’elles n’étaient tout simplement pas aptes à gérer ce genre d’informations, et qu’elles ont essayé de faire au mieux, prises entre leurs propres angoisses et dénis, et ma douleur.
J’ai vu une différence de réaction entre les filles et les garçons. Les trois garçons auxquels j’en ai parlé ont fait preuve de beaucoup plus de recul, de sobriété. Ils m’ont crue sans rien remettre en cause. Je crois que c’est parce que ça restait un domaine inconnu pour eux.
Les filles ont été plus dures, et c’était terrible d’une certaine façon. Je crois que pour elles, le risque de viol était tout naturellement inhérent à notre statut de femmes, qu’à partir du moment où on sort, ou on voit des mecs, on se met en jeu. Les filles ont été plus brusques dans leurs mots : c’était arrivé mais ce n’était pas si grave, ça arrivait et il ne fallait pas s’y arrêter…
Mais ce genre de raisonnement, c’est faire l’autruche ; c’est nier le fait qu’un viol n’est pas un acte ordinaire. C’est abominable, et ça ne devrait pas arriver.
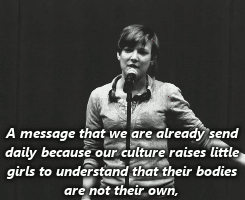
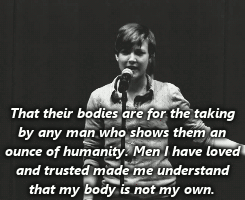
Notre culture éduque les petites filles pour qu’elles comprennent que leurs corps ne leur appartiennent pas, que leurs corps sont à la disposition de n’importe quel homme leur montrant une once d’humanité. Des hommes que j’ai aimés et en lesquels j’avais confiance m’ont fait comprendre que mon corps ne m’appartient pas.
Un autre fait intéressant à noter, c’est que je me suis toujours consolée avec des livres et des chansons. Mais cette fois-ci les livres et les chansons n’ont rien pu pour moi. Parce que le viol, son introspection et le point de vue des victimes, ce sont de grands invisibles. Il faut croire que les victimes se débrouillent seules pour s’en remettre : il n’y a pas de mentor, pas de représentations, de possibilité d’identification ou de comparaison.
Le seul texte que j’ai trouvé vraiment pertinent sur le sujet a été King Kong théorie de Virginie Despentes. Il a été fondateur pour moi. Quelqu’un mettait des mots, enfin. Enfin je n’étais plus seule. Et ce sont des mots qui valorisent nos forces, qui analysent les mécanismes sociaux menant au viol, des mots qui racontent ce qu’on ressent quand on doit vivre avec ça. Des mots en colère. Comme c’est libérateur, d’être en colère !
Je me suis aussi rapprochée des milieux féministes sur Tumblr et sur les blogs. Mon côté Hermione est ressortie à ce moment-là. Il fallait absolument que je comprenne ce viol. Il fallait que j’analyse, que je décortique et que je comprenne les rouages psychologiques qui amènent ce geste. Il fallait que j’inscrive cet événement dans un contexte sociologique global.
Je peux dire que les réseaux féministes m’ont énormément aidée. Ils m’ont proposé beaucoup de réflexions et d’analyses sur le sujet. Ils m’ont permis de comprendre que oui, c’était bien un viol, que j’avais le droit d’en souffrir. Que c’était lui le monstre, pas moi. Ils m’ont permis de comprendre tout les ressorts qui permettaient à ce genre de chose d’arriver : la culture du viol, la victime digne, le slut-shaming, le victim-blaming…
J’y ai trouvé beaucoup de soutien finalement, beaucoup de bienveillance. Des gens qui veulent une société meilleure, mais qui n’oublient jamais qu’il y a des vrais être humains derrière tout ça, des gens qui souffrent pour de bon.
Vers la reconstruction
Maintenant, ça fait six mois que je l’ai quitté. Il y a des jours noirs, des jours où j’y pense tout le temps, des flash-backs et une angoisse diffuse, oppressante, comme de l’eau dans mes poumons.
Je n’arrive toujours pas à effacer cette idée tenace que j’ai dû le mériter, que c’est ma faute. Je n’ai pas encore fini de me laver de la honte et du sentiment du culpabilité. Je fais toujours des cauchemars, et j’ai toujours peur, beaucoup trop souvent. J’ai des réactions que je ne comprends pas et je me sens rarement en paix, en sécurité.
Moi qui ai toujours été légère, à tomber amoureuse au bout de deux jours, à faire confiance à tout le monde, je suis devenue beaucoup plus distante, froide et méfiante. Et ce n’est pas moi, cette personne.
J’ose espérer que je retrouverai cette facilité à aimer et à compatir, parce que c’était ce qu’il y avait de meilleur en moi. J’ose espérer qu’il a réussi à me prendre mon corps, mais pas mon intégrité, pas mon esprit.
Ce qui est compliqué également, c’est que cette expérience coupe des autres. J’ai parfois l’impression d’évoluer dans une autre réalité. Il y a tellement d’horreurs dans ma tête, mais les autres ne le savent pas, et je ne peux pas leur dire. Pendant qu’ils parlent de la météo, de la dernière soirée ou d’un épisode de série, moi j’ai mes souvenirs qui prennent toute la place. La violence, ça isole terriblement. Il y a plein de choses que j’aimais avant, et qui me semblent maintenant un peu creuses.
Je suis pas guérie, mais je continue à avancer. J’ai des millions de projets d’avenirs : des pays où voyager, des projets professionnels, des festivals où danser, des films à voir, des livres à lire et des gens à aimer. Je suis entourée de belles personnes. Et je suis vivante. Plus que tout le reste, c’est ça l’important.
Il aurait pu me briser pour de bon, comme un gamin casse son jouet. Mais je suis vivante, en bonne santé physique et mentale, et c’est un putain de miracle. J’y pense chaque jour. Chaque jour est un jour gagné. Et le plus beau, c’est que je me suis relevée toute seule, j’ai été la maîtresse de mon destin. J’ai décidé.
« L’important n’est pas ce qu’on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu’on a fait de nous. » écrivait Sartre. Je suis en vie, et j’entends profiter de chaque jour, parce que chaque jour est miraculeux, et je suis la créatrice de mon propre miracle.
Je ne blâme certainement pas celles qui n’ont pas supporté le choc, celles qui ne peuvent plus vivre, au sens propre ou au figuré. Ce ne sont pas elles qui sont faibles, c’est cette société qui est malade. Et je pense à elles, très fort, où qu’elles soient et qui qu’elles soient. Je sais qu’il y a eu des pertes, et je pleure cette horreur, je pleure les pertes silencieuses.
J’ai compris que je récupérerais jamais ce qu’il m’a volé. Mais je peux vivre avec cette perte-là. C’est juste un deuil à faire. Je sais que je finirai par y arriver. Parce que tout guérit, mais une fracture ouverte met forcément plus de temps à guérir qu’une ecchymose.
Simplement, j’aurais aimé ne jamais avoir à me remettre d’un truc pareil.
Il faut que ça change
J’aimerais que cette mauvaise expérience serve. Si elle peut réveiller quelques consciences engourdies, elle aura eu le mérite de ne pas être inutile.
Le viol conjugal touche une victime de viol sur deux. Il serait temps qu’on en parle. Il serait temps que les représentations évoluent. Par exemple, que les séries télé cessent de nous montrer une relation abusive comme une belle histoire d’amour (coucou Game of Thrones et la relation entre Drogo et Daenerys).
Réfléchir au viol conjugal, c’est réfléchir à la notion de consentement. Et c’est rappeler que le consentement, c’est quelque chose de sobre, de volontaire, permanent et non forcé. Tout le reste, c’est du viol.
Je n’en peux plus d’entendre des « Mais c’est pas un viol s’ils sont ensemble ! ». À chaque fois, on me balance en pleine figure que ce que mon ex a fait, c’était normal. Et je ne veux plus entendre qu’un viol, quel que soit le contexte, c’est normal.
Mon violeur ne sait pas qu’il est un violeur. Ou plutôt, je pense qu’il ne veut pas le savoir. Parce que les violeurs s’arrangent très bien avec leurs consciences : ce n’était pas un viol, juste une fille dont on est venu à bout des résistances. Mon violeur estime sans doute qu’il a agi par amour, parce qu’il confond désir personnel et amour. Parce que la société lui a enseigné que les femmes sont passives, et que leurs « non » ne sont pas des vrais « non ».
Si un soir votre copine ne veut pas et que vous insistez encore et encore, que vous lui faites du chantage, que vous avez recours à la manipulation émotionnelle ou à la violence physique, c’est du viol. Si d’une façon ou d’une autre vous ne lui donnez pas le droit de refuser, ce n’est pas du sexe. C’est du viol.
Vous êtes un violeur. Et maintenant, vous le savez, vous n’avez plus d’excuse. N’écoutez pas cette société qui vous dit que c’est plus grave d’être frustré que de violer. Je vous en prie, ne violez pas, ne violez plus.
Pour aller plus loin (attention, certains textes peuvent être choquants) :
- Repères statistiques : les agressions sexuelles et les viols en France.
- Le texte révoltant de Bruno Gollnusch
- King Kong théorie de Virginie Despentes
- Sur le concept de « victime digne » : Comment être une bonne victime de viol
- Un recueil de textes sur le viol comme arme de la domination patriarcale : « Je ne suis pas un égoût séminal »
- Je ne veux plus être un violeur
- Qu’avez vous fait pour vous assurer du consentement ? Le guide du consentement
- Qui sont les violeurs ?
- Comment j’ai pris conscience de la culture du viol
Pour témoigner sur Madmoizelle, écrivez-nous à :
[email protected]
On a hâte de vous lire !

































Les Commentaires
Cela fait plus d'un an que mon ancien compagnon, avec qui j'étais depuis presque 7 ans a rompu et que j'ai tout quitté pour partir le plus loin possible de lui ...
J'étais amoureuse, c'était ma toute première relation de couple, mais je souffrais tellement ... Tant sur le plan physique que sur le plan psychologique.
Il faisait du chantage affectif, c'était un pervers narcissique, il m'a détruite, un trou béant à l'intérieur de ma poitrine que j'avais réussi à oublier mais qui est de nouveau présent chaque soir, chaque nuit, chaque moment où je laisse mon cerveau dériver. Il a su me rendre dépendante de lui, malgré la souffrance, et je crois que s'il n'avait pas décidé de rompre, j'y serais encore ...
Je vois une psychologue depuis bientôt 4 mois, et cela fait seulement une semaine que j'arrive à lui parler de cet aspect de la relation. Parce que je n'arrive pas à en parler, j'ai peur d'en parler, peur de ne pas être comprise, peur d'être jugée, peur de changer le regard des personnes qui m'entourent... Peur de les blesser.
Là, tout de suite, face à mon écran, c'est plus facile, mais demain, face à mes amis, ma soeur, ma famille ? Comment leur dire toute la violence que j'ai subie, comment leur dire que j'ai laissé faire pendant plus de 6 ans ? Comment leur dire que je n'ai pas été assez forte ?
C'est vraiment difficile, je suis perdue, totalement perdue ... Je continue malgré tout à faire des efforts, avancer, j'inspire, j'expire, je souris, je met un pied devant l'autre, je fais des projets ... Mais c'est vide à l'intérieur, un trou noir qui me comprime la poitrine en permanence ...
Comment avez vous fait ? Comment en parler autour de soi ? Comment trouver le courage de le dire ?