— Publié initialement le 11 juillet 2014 *Certains passages peuvent être un peu choquants.
Je suis un adulte surdoué : je me suis découverte comme telle à 29 ans. Eh oui, on parle tout le temps d’enfants surdoués, comme si cette caractéristique était rapidement visible. Mais parfois il arrive que ça ne soit pas décelé pendant l’enfance ; du coup on erre en chemin, on se cherche… C’est ce qui m’est arrivé, dès mes plus tendres années.
Il y a longtemps que j’ai envie d’écrire mon « histoire », bien que je sois encore jeune pour me lancer dans une autobiographie. Cependant, avec mon parcours, il y a des jours où j’ai l’impression d’avoir le double de mon âge. J’ai voulu témoigner un nombre de fois incalculable, sauf qu’il me manquait la clé de l’histoire, de mon histoire.
J’ai commencé à me demander sérieusement si j’étais surdouée à 16 ans, suite à un Ça se discute du regretté (selon moi) Jean-Luc Delarue — je vous vois venir avec votre scepticisme, mais pour moi c’était bien le seul à parler de psychologie en prime time, ce qui ne se fait d’ailleurs plus.
Dans son émission sur les surdoués, la psychologue qui intervenait a donné des caractéristiques qui ont particulièrement résonné en moi. Mais comment pouvais-je oser penser que j’étais surdouée alors que j’avais le profil parfait de la « loser » ?
Pour comprendre un peu mieux le contexte, faisons un petit retour en arrière.
Je suis surdoué, mais j’étais un enfant « normal »
D’après ma mère, j’ai commencé à parler très tôt, avec des phrases construites et des mots d’adultes dès mes 2 ans. À cette même époque, ma grande sœur, elle, allait à l’école et je demandais à y aller aussi. J’ai donc fait ma première petite section à cet âge : jusque-là tout se passait bien.
Je garde un excellent souvenir du peu dont je me souviens de cette époque de ma scolarité. J’étais sociable, j’avais beaucoup d’amis, j’étais joyeuse… bref, la petite fille modèle quoi.
En moyenne section, on a proposé à mes parents de me faire sauter une classe vu ma « précocité ». Ma mère s’y est opposée, car en dépit de mes capacités scolaires, j’avais un comportement de bébé, très « bisous-câlins » que je réclamais aux maîtresses et aux « dames de service » (qu’on appellerait ATSEM aujourd’hui).
À lire aussi : Témoignage : j’ai été une enfant surdouée
J’ai donc continué mon cursus de façon classique, toujours avec de bons résultats et un très bon comportement à l’école.
Ensuite est arrivée l’entrée à l’école primaire qui a malheureusement rimé avec le divorce de mes parents entre le CP et le CE1. Je me revois pleurer en classe pour des raisons idiotes, par exemple quand je ne comprenais pas l’exercice demandé : mon hypersensibilité se déclarait.
On a mis ça sous le coup des circonstances familiales, ce qui semblait logique. Je restais malgré tout une très bonne élève, toujours dans le « peloton de tête » avec quasiment 19 de moyenne. Ça a été comme ça jusqu’en quatrième.
Jusque-là, tel un caméléon, je réussissais à me sociabiliser afin de rester dans le moule. Ce qui était alors un mode de protection inconscient m’a beaucoup aidée. Ça ne m’empêchait pas cependant de me sentir différente, pas complètement comme les autres, sans pouvoir vraiment cerner le problème.
Être surdoué : l’invasion de l’angoisse
Pendant l’été 1997, j’ai fait ma toute première colonie de vacances. J’avais 13 ans, j’étais la plus jeune. Les plus vieux avaient 17 ans, ce qui justement me plaisait car je m’ennuyais avec les gens de mon âge ; on me disait d’ailleurs que j’étais très mature.
À l’adolescence, jai découvert mes premières crises d’angoisses.
Sauf que je suis rentrée de cette colo complètement transformée : la méthode caméléon ne fonctionnait plus, je n’avais pas réussi à l’appliquer lors de ce séjour, et je n’y arriverais plus vraiment complètement par la suite.
J’ai découvert mes premières crises d’angoisses : génial comme début d’adolescence ! Je déprimais, je me renfermais sur moi-même et perdais mes amis. Je me suis retrouvée isolée, beaucoup trop différente et tellement en décalage avec les autres. J’ai alors subi du harcèlement scolaire lors de mes années de quatrième et de troisième, ce qui reste une expérience traumatisante.
Progressivement, les angoisses se sont multipliées et ça a commencé à être un sacré bazar dans ma tête. Maintenant je sais les expliquer, et j’ai mis des mots sur les symptômes : en fait je me suis mise à penser tout le temps (mais vraiment, je ne sais pas ce que c’est que d’avoir le cerveau tranquille), ce qu’on appelle l’hyperactivité cérébrale.
J’ai commencé à tout analyser, TOUT, même des banalités : c’est l’hyperactivité émotionnelle et l’hypersensibilité. J’étais sensible à tout, tout le temps.
J’ai également développé une très forte intuition et beaucoup d’empathie : je prenais ainsi l’émotion de l’autre, je la ressentais même s’il ne parlait pas. Et je vivais cette émotion de façon très vive.
Le sentiment d’injustice était également très fort ; j’avais un grand sens des valeurs, de la loyauté — ce qui complique les amitiés, car depuis je ne supporte pas les amitiés « superficielles », j’ai besoin de sentir qu’on fait attention à moi comme je fais attention aux autres.
Et à force d’être dans l’hyper pour tout, j’avais parfois l’esprit confus, un vrai casse-tête ; certains jours il était hyper fatiguant de ne pas avoir de bouton OFF sur ma tête. Avec tout cela, le sentiment de décalage était très fort.
Découvrir qu’on est surdoué… À la recherche d’explications
À 13 ans, suite à ma demande, et avec l’appui de ma mère, j’ai commencé à voir un psychiatre. À 29 ans, je n’ai pas peur de dire que j’ai vu près de dix psy différents, toujours de mon propre chef ; j’avais besoin de savoir ce qui clochait chez moi.
Cette recherche n’a pas été de tout repos ; être surdouée vous demande de vous adapter en permanence — tant vous vous sentez en décalage — et mobilise beaucoup d’énergie. Cela épuise vos ressources. Et quand on ne sait pas ce qu’on a, on commence à se demander si ce décalage avec le monde et ce fourmillement permanent de pensées ne veulent pas dire qu’on est fou.
Ma famille ayant un terrain dépressif lourd, les médecins n’ont pas cherché plus loin et m’ont donné mes premiers antidépresseurs à 17 ans, l’année du bac.
À lire aussi : Comment choisir son ou sa psy ?
Ça m’a ruiné la mémoire, et j’ai raté mon bac de trente points. J’ai donc redoublé ma terminale, un énorme échec pour moi qui avait été une si bonne élève. Pour ma deuxième terminale, tout allait au plus mal ; à la maison, comme au lycée et avec mon copain. J’ai eu une mononucléose carabinée qui a duré presque six mois, et mon copain m’a trompée avec ma meilleure amie.
J’avançais en essayant de ne rien ressentir.
À presque 18 ans, j’en avais déjà marre d’être mal depuis si longtemps ; cela faisait cinq ans que je subissais crise d’angoisse sur crise d’angoisse. Il m’était impossible de passer une soirée d’ado « normale » : cela se finissait par des spasmes, des tremblements et de l’hyperventilation — de quoi en effrayer plus d’un !
De toute façon, cet environnement de fiesta imprégné d’alcool et d’autres substances ne m’intéressait pas (même si j’avais envie de faire comme tous les autres) : je recherchais l’authenticité, que je ne trouvais pas.
Le jour où mon petit copain m’a appris qu’il m’avait trompée avec ma meilleure amie de l’époque, mon monde s’est donc écroulé. C’était trop. J’ai vidé d’un coup les boîtes des cachets que je prenais à l’époque (antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères…).
Puis j’ai pensé à ma mère et appelé le Samu — j’avais par chance un téléphone dans ma chambre. Je peux le dire : sans elle, je ne serais plus là. S’en est ensuivi un séjour de quelques jours aux urgences, puis une semaine dans une maison de repos spécialisée.
Malgré tout ça, cette année-là j’ai obtenu mon bac sans aller aux rattrapages. Personne n’y croyait, excepté ma mère et une CPE géniale qui m’a aidée à obtenir un tiers-temps pour mon exam. Je suis sortie de tout ça sans avoir beaucoup de goût pour la vie. J’avançais en essayant de ne rien ressentir, cela faisait trop mal.
Découvrir qu’on est surdoué : le premier (mauvais) diagnostic
Je me suis lancée dans un BTS tourisme en alternance. J’ai ainsi été guide-interprète pendant deux ans. Le métier me plaisait énormément. Cependant l’ambiance dans l’entreprise n’était pas terrible, ma chef étant à la limite du harcèlement moral, et dans mon école on ne croyait guère plus en moi et mes capacités… Je n’avais pas vraiment réussi à remonter la pente.
J’ai refait une deuxième tentative de suicide, cette fois-ci un appel au secours. J’avais besoin qu’on entende mon mal-être, qu’on m’aide à me guérir, à trouver ce mal qui me rongeait. Malgré mes deux mois d’arrêt de travail et mon deuxième séjour en maison de repos, j’ai obtenu mon BTS avec presque 14 de moyenne alors que j’avais très peu travaillé.
Mon petit copain de l’époque était en études d’infirmier, et lors d’un de ses cours, un psychiatre spécialiste de la bipolarité est intervenu. Mon copain trouvait que les symptômes me correspondaient, et il a donc organisé une rencontre avec ce psychiatre — un de plus !
À lire aussi : J’ai testé pour vous… les études pour devenir infirmière #1
Je n’étais plus à ça près et j’avais besoin de savoir ce que j’avais ; l’ignorance dans laquelle je vivais me tuait à petit feu.
Un psy était persuadé que j’étais bipolaire.
Après m’avoir fait faire des tests, le psychiatre n’était pas sûr que j’étais bipolaire, mais il m’a tout de même prescrit le traitement contre cette maladie (Trileptal), en me disant de le tester pendant 6 mois pour voir si cela changeait quelque chose dans mon comportement.
Je l’ai vu régulièrement pendant cette période et, prise de doute sur cette maladie récemment révélée, je lui demandais clairement si je n’étais pas plutôt surdouée. Il m’a juste répondu que j’étais une personne « singulière » — ce qui ne m’a pas franchement éclairée.
Six mois plus tard, ce psy a quitté son cabinet sans préavis. Il me fut donc impossible de faire un vrai bilan. Mais je gardais cette étiquette de bipolaire, rassurée de pouvoir mettre un mot sur ce que j’avais.
Je suis retournée dans ma ville natale, et y ai consulté un autre psychiatre, qui lui était persuadé que j’étais bipolaire. Il continuait donc à me donner le traitement pour cette maladie. C’était le psy le plus incompétent que j’avais jamais vu : il s’endormait pendant les séances (oui, vous avez bien lu !). J’ai vite arrêté de le voir.
Être surdoué : accepter sa « particularité »
Ceci étant, j’essayais encore et toujours de trouver des solutions. L’un de mes oncles était en congé pour invalidité à cause de sa schizophrénie. Ma mère étant très proche de son frère, elle lui parlait régulièrement de mon cas. Mon oncle a fini par me suggérer de faire un dossier de travailleur handicapé. En effet, c’en était au point où je n’arrivais plus à travailler.
J’avais été prise pour être réceptionniste dans un hôtel. J’en vomissais le matin, impossible d’y aller… J’étais complètement paumée et me sentais vraiment handicapée. Comment allais-je faire si je ne pouvais pas travailler à cause de mes problèmes ?
J’ai fait mon dossier auprès des Maisons Départementales des Personnes Handicapées, et j’ai obtenu ce statut. Cela peut peut-être sembler paradoxal, mais ça a a été un grand soulagement pour moi. J’avais plus qu’un motif pour mon mal-être permanent.
Grâce à ce statut, j’ai trouvé un poste dans la fonction publique territoriale qui embauche les travailleurs handicapés par voie contractuelle — un mal pour un bien. Ils sont ensuite titularisés. Je suis donc devenue assistante. Je m’y ennuyais pas mal, mais j’avais tant besoin d’un peu de stabilité !
À cette période, j’avais 25 ans et je sortais d’une longue période de chômage et de réorientation. J’ai décidé de rencontrer une association de bipolaires pour rencontrer des gens a priori comme moi.
En échangeant avec ces personnes, ça a été comme une révélation : certes j’avais des hauts et des bas, mais pas comme les personnes bipolaires, pas aussi brutalement et pas de façon aussi marquée. J‘ai compris que je n’étais pas bipolaire. Par contre, je perdais mon étiquette… J’étais encore plus perdue.
Cette année-là, j’ai rencontré l’homme avec lequel je vais me marier cet été, et grâce à une amie à lui j’ai rencontré une psychologue — quelle belle rencontre que cet homme, décidément ! Maintenant je fais bien la distinction entre les méthodes du psychologue et du psychiatre, et je pense que j’aurais dû aller voir un psychologue dès le début.
Cette année-là, j’ai à la fois rencontré une psychologue et mon futur mari.
Pour rappel, le psychiatre est un médecin (donc remboursé) qui établit un diagnostic médical et trouve le traitement adéquat : il ne suit pas de cours de psychologie. Le psychologue, lui, est diplômé d’un master de psychologie. Ce n’est pas un médecin : il n’est donc pas remboursé.
La séance dure deux fois plus longtemps qu’avec un psychiatre (une heure au lieu d’une demi-heure), et il est plus dans l’écoute et le conseil que la pose de diagnostic. Le psychiatre cherche en effet une pathologie précise.
Cette psychologue, exceptionnelle, m’a fait faire un travail sur moi en deux ans comme jamais je ne l’avais fait en plus de dix ans de suivi avec des psychiatres.

Elle calmait mes crises d’angoisses et répondait à toutes mes questions (auxquelles les psychiatres ne répondaient pas) : je voyais le bout du tunnel. Elle m’a aussi dit que je n’étais pas bipolaire, et encore moins handicapée.
J’ai alors arrêté mon traitement de moi-même, progressivement, et, en effet, il n’y avait pas d’effets sur mon humeur. Ma vie était plus stable, et, ayant un vrai suivi, j’allais mieux. Je m’ennuyais toujours au boulot, mais je m’en contentais : j’avais assez galéré, je ne voulais pas faire la fine bouche.
Cependant cette psy formidable avait quelques soucis de santé, et à la suite d’une opération elle est décédée. Cette annonce m’a complètement dévastée ; je me sentais abandonnée par la vie, et cette dame exceptionnelle me manquait tellement !
Il m’avait fallu plus de dix ans pour en trouver une comme elle qui m’a sauvée, qui m’a appris à vivre avec mes bagages, aussi lourds soient-ils, et à gérer mes crises d’angoisses qui étaient à leur apogée jusqu’à ce qu’elle me soigne.
J’avais toujours besoin de « guérir », car ce n’était pas encore ça — les surdoués sont en quête du bonheur absolu, je le comprends aujourd’hui. J’ai donc consulté une autre psychologue, mais ça ne passait pas du tout. Au bout de plusieurs mois de recherche, j’ai trouvé le psychologue qui me suit toujours aujourd’hui, avec lequel je fais un excellent travail thérapeutique.
La découverte, par hasard : je suis surdouée
Avant de le rencontrer, un livre dans une librairie m’avait interpellée : c’était Trop intelligent pour être heureux — l’adulte surdoué de Jeanne Siaud-Facchin. C’était comme si j’avais écrit les phrases de ce livre : tout résonnait en moi, absolument TOUT. Cela a conforté ce que l’émission de Delarue m’avait fait suspecter. C’était peut-être donc ça ; j’étais trop intelligente pour être heureuse.
Cela expliquait mon hypersensibilité, ma capacité à ressentir l’émotion des gens (qui est parfois si handicapante) ; cela expliquait pourquoi je pensais tout le temps, sans arrêt, si vite.
Cela expliquait pourquoi je m’étais toujours sentie en décalage avec les autres, pourquoi je comprenais tout au quart de tour sans être capable d’expliquer pourquoi (mes pensées vont trop vite, tout se bouscule), ou encore pourquoi je m’ennuie vite…
À lire aussi : Celui qui… a vaincu l’ennui
À un moment du livre l’auteur dit d’aller faire un test de QI avant de poursuivre la lecture. Il m’a fallu quatre ans pour sauter le pas.
Mon psy ne m’y a pas particulièrement encouragée ; il m’a seulement dit qu’en le faisant, je serais fixée sur cette question qui me taraudait depuis tant d’années. Il m’a donné les coordonnées d’une psychologue qui faisait passer les tests de QI, mais je ne l’ai pas appelée. J’ai complètement refoulé l’idée d’aller passer le test.
Mais quelques temps plus tard, j’ai vu le livre dans son cabinet. Je me suis alors dit qu’il serait capable de comprendre le sujet si je passais un test ; je me suis sentie à l’aise pour parler avec lui des résultats, et de ce qu’il faudrait faire avec tout ça.
J’ai donc passé un test de QI en octobre 2013 et oui, je suis surdouée. Je ne suis pas dépressive, ni bipolaire, ni folle (comme je l’ai longtemps pensé) ; je suis surdouée.
À 29 ans, j’ai ENFIN la réponse à cette question que je me suis posée pendant près de treize ans… J’ai passé le test il y a six mois et je digère encore l’information. Car peu importe que je sois surdouée ou non, j’aurais préférée être dans la norme ; ce n’est pas facile de ne pas l’être, et encore moins quand on l’apprend sur le tard.
À lire aussi : J’ai testé pour vous… être intellectuellement précoce
Surtout qu’à mon âge, on peut se demander « À quoi bon faire ça ? Ça va changer quoi ? ». Mais pour moi cela change tout ; ça a éclairé mon chemin, répondu à des tas de questions sur ma façon de fonctionner, et cela m’a fait comprendre que je ne suis pas anormale. J’ai « juste » un « fonctionnement intellectuel atypique ».
J’ai beaucoup pleuré à l’annonce des résultats, j’avais du mal à intégrer le diagnostic. Mais je me suis vite rendue à l’évidence, surtout qu’en revoyant des scènes du passé tout concorde, tout devient logique à la lumière de ce diagnostic. Quel soulagement !
Je ne suis pas dépressive, ni bipolaire, ni folle : je suis surdouée.
Bien sûr cela pose de nouvelles questions : en effet comment se fait-il que le nombre de psy que j’ai consultés ainsi que mes parents ou encore mes professeurs n’aient rien vu ? Je pense qu’en ce qui concerne l’école, c’est que la stratégie du caméléon a été terriblement efficace — je l’utilise d’ailleurs encore aujourd’hui, même si je travaille très dur pour que cela ne soit plus nécessaire.
Mes parents, quant à eux, étaient trop préoccupés par leurs propres problèmes pour voir ça — ils ont fait tour à tour des dépressions, très régulièrement.
En ce qui concerne les psy, j’ai compris grâce au livre, et j’avoue que ça me fait froid dans le dos. J’ai inconsciemment saboté mes séances en voulant tester les psy que j’ai vus pour savoir s’ils arriveraient à trouver ce que j’avais — même si je n’en étais pas du tout consciente, c’est tout le paradoxe de la chose.
Je me suis adaptée aux techniques des différents psy pour qu’ils tombent dans le panneau, et mis à part les deux derniers, ils sont tous tombés dedans (et certains étaient peut-être aussi incompétents).
Normalement lors d’une séance, on lâche ses inhibitions : le but est de pouvoir dire ce qu’on veut et être nous-mêmes. Moi je testais les psy en ne montrant pas tout de moi, et donc en ne dévoilant pas certains symptômes, pour les forcer à chercher, à trouver ce qui m’arrivait — ce qui m’aurait prouvé qu’ils étaient compétents.
J’ai du mal à l’expliquer, comme ce n’était pas du tout conscient. Mais je les testais parce que je ne leur faisais pas confiance, et si le médecin ne voyait pas mon « manège », je refusais son aide, je n’entrais pas dans le travail thérapeutique. J’ai saboté les séances parce que je ne m’ouvrais pas, et ne permettais donc pas aux psy de faire leur travail.
Libérée
Je ne trouve pas les mots pour exprimer à quel point je suis soulagée de savoir ce que j’ai ; ça m’aide à reprendre confiance en moi, à réaliser que j’ai de vraies capacités, et que c’est normal de m’ennuyer dans mon travail actuel. Je suis toujours assistante ; je ne dénigre pas ce métier, bien au contraire, mais dans mon cas, ne faire presque que de l’exécutif est très mauvais.
Je ne sollicite pas assez mes capacités, et du coup je perds beaucoup d’énergie à faire en sorte de ne pas m’ennuyer, et j’ai beaucoup trop le temps de penser. Mon job est loin d’être fatiguant en soi, mais pourtant ça me fatigue énormément psychiquement.
Je n’ai jamais été aussi heureuse dans ma vie.
Avant de faire le test de QI, je revenais régulièrement sur le sujet avec mon psy et au fur et à mesure, j’en suis arrivée à la conclusion que je voulais reprendre mes études pour faire le métier que j’ai toujours voulu faire : psychologue. La vie et ses petites ironies, n’est-ce pas ? Pourtant c’est bien le métier que je voulais faire dès mes 12 ans.
Je me suis donc inscrite en première année de fac de psycho par correspondance, je recommence tout à zéro. C’est prenant, surtout que je bosse à plein temps, que je me marie cet été, que je suis en thérapie, que je dessine et que je fais du sport.
Mais peu importe l’âge que j’ai ou le temps que ça me prend ; ça me plaît et je veux vraiment tenir cette promesse faite à la petite fille en moi qui savait tout ça. Je ne vais pas renoncer. Je n’ai jamais été aussi heureuse dans ma vie, je me sens femme et épanouie.
Et je suis fière de moi aussi, de tout le chemin que j’ai parcouru, fière de ne pas avoir baissé les bras, car putain, ça valait le coup de se battre.
On pensait qu’Einstein était fou… jusqu’à ce qu’il commence à tout déchirer !
Je vois la vie qui m’attend et elle me plait, même si des fois je me sens en décalage — maintenant je sais que c’est normal. Je n’ai jamais été aussi confiante en l’avenir, et je suis convaincue qu’il est important de savoir qui on est pour savoir où l’on va.
Alors, si vous avez le moindre doute là-dessus, peu importe votre âge, allez faire un test ; ça ne change rien mais au fond, ça change tout !
Pour témoigner sur Madmoizelle, écrivez-nous à :
jaifaitca@madmoizelle.com
On a hâte de vous lire !
Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos podcasts. Toutes nos séries, à écouter d’urgence ici.



























![Copie de [Image de une] Horizontale (84) Copie de [Image de une] Horizontale (84)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/12/copie-de-image-de-une-horizontale-84-768x432.jpg?resize=300,350&key=30319f9e)


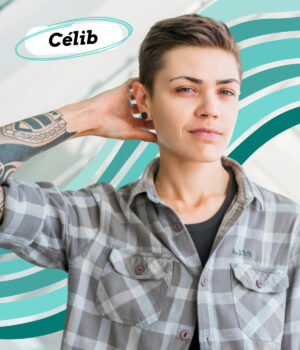




![[Image de une] Horizontale (27) [Image de une] Horizontale (27)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/image-de-une-horizontale-27-768x432.jpg?resize=300,350&key=19a71e0d)
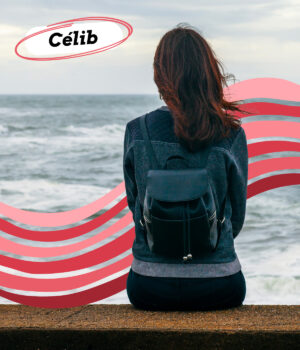
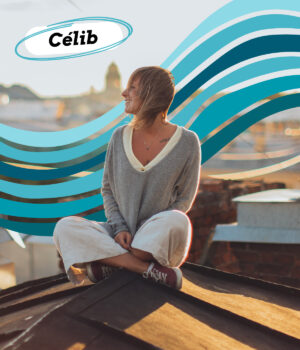



Les Commentaires
"COMME beaucoup de sureficient je (je n'aime pas dire surdouée, je ne me sens pas intelligente),
j'ai eu un parcours scolaire chaotique où c'était in extremis mon seul jardin secret la bibliothèque ou la dame du cdi me voyez chaque semaine ramener une pile livre lu la semaine précédente"
aillettes: