Il y a des matins où rien, absolument aucun indice ni aucune prémonition, ne peut annoncer qu’un cataclysme surviendra quelques heures plus tard.
Ce matin de juillet 2010, rien n’avait en tout cas mis la puce à l’oreille de mon intuition.
Une matinée comme les autres
Le réveil avait sonné trop tôt pour le moi(s) paresseux de juillet.
À 8h tranchante, la sonnerie infernale — que je voulais changer chaque jour sans jamais bien sûr prendre le temps de le faire — retentit, me plongeant immédiatement dans une humeur de merde, comme 78% des matins.
À 8h, j’écrasai le buzzer, en poussant le même râle qu’après une nuit à ne dormir que 3h, comme 50% du temps.
Ma mère rentra dans ma chambre sans frapper, histoire d’assombrir encore mon état, pour me sommer (toutefois avec douceur) de me lever immédiatement « si tu veux être à l’heure à la gare, chaton. »
À 9h, j’avais le ventre plein, mes écouteurs vissés aux oreilles, et une main aux ongles écaillés sur la poignée de ma valise.
J’étais prête à rejoindre ma Bretagne adorée pour passer comme chaque été une grosse semaine dans la maison en pierres de mon amie d’enfance.
Paris en pleine chaleur
Mon humeur s’était adoucie et ma mère, jamais découragée par mes attitudes matinales, avait décidé de m’accompagner à la gare.
Dans le bus 92 qui relie la Porte de Champerret à la gare Montparnasse, il n’y avait pas un chat.
Ma mère et moi pouvions nous installer tranquillement au centre du véhicule, dans le sens de la marche.
Je déteste l’odeur des sièges de bus. Ils sentent le chaud et les acariens.
En écoutant l’album Grace, que j’ai poncé pendant 2 ans sans jamais m’en lasser, je pris le temps de détailler ma mère.
Comme à chaque trajet en bus ou en métro, elle avait le nez plongé dans Le Pariscope — ce petit guide culturel parisien qui n’existe plus aujourd’hui — un stylo à la main, pour encercler les titres des pièces de théâtre qu’elle irait voir cette semaine-là.
Elle était méthodique, travaillait avec rapidité, pour optimiser au mieux son trajet. L’attention qu’elle portait à l’agenda des spectacles était rigoureuse.
Ma mère vivait sa passion sans rien demander à personne et écumait souvent les théâtres seule, mon père méprisant de manière globale tout ce qui touche à la culture, un peu par esprit de contradiction, beaucoup par désintérêt.
La regarder froncer ses sourcils sous sa frange immortelle me fit marrer, surtout parce que j’imaginais mon daron perché sur son vélo de course gravir son énième col de la journée dans le sud de la France, à l’exact même instant.
Mes parents étaient l’incarnation de l’expression un peu téléphonée « les opposés s’attirent ».
Enfin, à l’époque.
Au départ d’un train pour la Bretagne
Dehors, tout semblait fonctionner au ralenti comme le veut la tradition des mois caniculaires. Les rues étaient vides mais les terrasses bondées.
Je regrettais de n’avoir pas fait d’effort vestimentaire ce jour-là, pour ressembler un peu plus à ces nanas aux robes fleuries qui avaient l’air si bien dans leur peau, à fumer des clopes en terrasse.
Moi, j’avais piqué à mon grand-père une chemise molle et délavée, associée à un short en denim brut sans aucun charme.
Le choix du confort primait rarement sur mes envies de mode, mais pour un trajet en train, l’exception était de mise.
Tous les Parisiens absents des rues avaient l’air de s’être donné rendez-vous à la gare Montparnasse. Les valises couraient partout et les hommes roulaient jusqu’à leurs trains, affolés par le retard et la chaleur.
Devant la voiture 17, la mienne, c’était la guerre à celui qui passerait devant les autre.
Ma mère fuma quelques lattes de ma cigarette avant d’ironiser : « Ne clope pas trop en Bretagne hein ! »
Dans le train, premier constat chiant as fuck : j’étais en carré. Je suis TOUJOURS EN CARRÉ PUTAIN, à croire que l’univers en a décidé ainsi.
Un wagon-bar déterminant
En face de moi, un couple de personnes âgées portait des vêtements assortis.
Elle arborait un chandail lilas (par 30°C) tandis que lui transpirait dans un tailleur mauve étriqué, qui avait sans doute le même âge que leur amour.
Les deux se goinfraient de barquettes à la fraise.
Je me souviens les avoir observés pendant une bonne partie du trajet se fourrer l’un l’autre des biscuits dans la bouche, en gloussant et me postillonnant au visage.
J’étais mi-agacée par cette pluie de confiture, mi-éblouie par leur complicité évidente.
Une heure après notre départ, j’avais sympathisé avec Diana et Léon, et profité à mon tour des barquettes à la fraise.
La gorge asséchée par les gâteaux Lu, je marchai jusqu’au wagon bar de la voiture 15.
Comme d’habitude, la queue était si longue qu’il était difficile, à son bout, de distinguer le comptoir, et tous les voyageurs y allaient de leur commentaire sur le prix exorbitant des consommations.
Moi, je crevais de chaud, de faim et de soif. Une soif déjà étanchée par le prix de la 1664 qui équivalait au budget total de mes deux semaines de vacances en Bretagne.
Et j’exagère à peine.
Mon croque-monsieur tout mou, ma bière à 5000€ et moi-mêmes trouvâmes un petit coin de table où nous poser.
Dehors, les champs avaient remplacé les buildings tagués des abords de la gare Montparnasse et les bovins avaient remplacé les robes à fleurs.
J’étais heureuse d’être en vacances.
Mais ma sensation de paix fut parasitée par une intuition inconnue.
Ma rencontre avec X
Les yeux comme deux radars, j’écumai les alentours de mon coin de table tout crade et tombai sur le regard d’un type à la drôle d’allure.
Dégingandé, il était à moitié assis sur sa table, une fesse dessus, une fesse tombant de sorte à avoir une jambe par terre, et affichait un sourire tellement désinvolte que je le plaçai immédiatement dans la catégorie : énorme connard.
Une catégorie où reposent désormais tout un festival de trous du cul croisés au fil des années.
Il me regarda dans les yeux avec une assurance qui me fit soudain éprouver la plus grande des fascinations pour mon croque-monsieur.
À l’époque, j’avais 17 ans, et je n’avais pas franchement été le centre d’attention des mecs au lycée. Ni à l’extérieur non plus d’ailleurs.
Un regard masculin était déjà difficile à soutenir, alors celui d’un homme plus vieux d’une dizaine d’années…
Gênée comme rarement derrière ma table, je fis tomber mon tiramisu — seul reliquat de ma fortune — et éructai. J’avais vraiment la pire vie.
Il ne suffit que de deux pas au grand homme à chapeau rayé pour me présenter son aide :
« Je peux t’aider ? Ça a pas l’air facile la vie, hein ? »
Une phrase à la fois amusée et moqueuse qui me fit piquer un fard. Je bredouillai un truc incompréhensible qu’il eut l’air de trouver adorable :
« J’ai pas l’impression d’avoir demandé à qui que ce soit son avis sur ma maladresse ».
On soulignera ici la grande maturité de cette réplique, doublée d’une sympathie au top.
Il rit de bon cœur devant mon malaise, et déballa une blague abominablement nulle :
« Si tu es maladroite, mets-toi à gauche. Je m’appelle X au fait. Tu es toujours aussi aimable ? »
Ensuite, c’est le VIDE ABSOLU.
Le pressentiment du changement
Je ne me rappelle d’aucune bribe d’une conversation qui dura pourtant plus de deux heures.
Je me souviens seulement que l’homme à chapeau allait toutes les 10 minutes fumer dans les toilettes du wagon, et revenait avec une odeur de tabac que j’assimilai alors instantanément à de la virilité.
Et viril, X l’était, dans son apparence, sa hauteur, ses réflexions, son mépris pour tout et tous.
Aussi viril qu’on puisse l’être dans l’esprit d’une ado impressionnable, dirigée par l’envie d’enfin vivre au lieu de vivoter.
Parce que si je n’avais pas eu, ce matin-là, la moindre prémonition, ces deux heures au bar du train avaient changé la donne. Je sentais que j’allais faire n’importe quoi, et que j’allais le faire longtemps.
Il était là, le précipice que j’avais fantasmé toute mon adolescence. Il était juste sous mes yeux.
Je savais, je SAVAIS que j’allais vivre quelque chose avec X, et que ça ratatinerait à tout jamais l’ado que je n’avais de toute façon jamais aimé être.
Et c’était tant mieux. Je voulais éviscérer l’enfant en moi une bonne fois pour toute. Et même le torturer un peu avant de lui sortir les boyaux.
Être une « môme », je détestais ça.
Pour moi, ça signifiait être le pantin des profs, des parents, des bibliothécaires, des directeurs d’école, des vendeuses dans les magasins, des amis de nos parents, des parents de nos amis. Bref, de tous les adultes.
Je voulais mettre un terme prématuré à cette condition, en essayant un truc fou : vivre une aventure avec un homme plus âgé au point de sans doute vraiment déplaire à mon père. Et à tous les autres adultes.
Aujourd’hui, 10 ans plus tard, je pense que déjà, dans ce train, je savais j’allais faire n’importe quoi.
Il y avait ce petit quelque chose dans le regard de X, dans ses grandes mains qui ne fendaient jusque-là que le vent, et son mépris infini qui ne faisaient pas de doute : il était nocif, et sans doute un peu malade.
Aujourd’hui, on appellerait X un pervers narcissique.
Un homme qui ment, qui use de la violence psychologique, verbale et physique avant de se répandre en excuses, en compliments et en promesses.
Un homme qui t’isole des autres, jusqu’à ce que tu sois seule et méconnaissable, seulement capable de colère et d’une aussi grande violence que la sienne.
J’ai su dès cette première rencontre, dans ce train censé me mener au plaisir, que j’allais avoir mal.
Mais ça n’avait pas d’importance à cet instant précis. Je voulais expérimenter la douleur. Elle serait forcément meilleure professeure que l’ennui du primaire, du collège et du lycée.
L’importance qu’a pour moi cette histoire
Alors, j’ai sauté dedans.
J’ai sauté du train de ma vie banale et j’ai roulé longtemps sans trouver d’obstacles suffisant pour stopper ma course, jusqu’à atterrir dans un mur.
Un beau mur à chapeau rayé. Un mur comme on en voit dans les films. Un mur contre lequel on apprend aux femmes qu’il est doux de se cogner, à coups de films à la con qui glamourisent l’amour douloureux, torturé, « passionnel ».
J’ai vite pigé, d’ailleurs, que « passionnel » signifiait violent, mensonger, et vide de logique.
Cette histoire d’« amour », la première de ma vie, je ne peux pas la raconter en quelques lignes. Cette histoire ne se raconte que dans les détails, car c’est dans les détails que se cache la vérité.
En apparence souvent, les couples ont l’air d’aller bien, ses membres semblent complices, amoureux, unis.
Mais c’est dans le détail d’un geste, dans le ton d’une phrase ou dans une ride de colère qu’on peut relever la violence et l’injure.
Je ne peux donc pas raconter, même pas en substance, ces presque 3 années de couple.
J’essaie depuis des lustres d’en faire un bouquin. Ni par ego ni pour l’originalité du récit (laisse-moi te dire que cette histoire n’a rien d’original).
Je ne veux pas non plus rédiger ce bouquin dans l’espoir d’en écrire d’autres ensuite.
Je veux simplement raconter CETTE histoire et seulement cette histoire-là, pour expliquer à d’autres jeunes filles de 17 ans qu’il n’y a rien d’exaltant dans la violence morale, dans la violence physique, dans le mensonge.
Toutes ces aberrations que j’ai subies, et auxquelles j’ai largement participé.
Que la passion est un fantasme destructeur et erroné, véhiculé notamment par la littérature et le cinéma.
Quel est le but de cet article ?
Cet article a simplement pour vocation de raconter ce morceau infinitésimal de vie où mon histoire personnelle a basculé.
Un instant ridicule à l’échelle d’une existence entière, sans lequel je ne serais pas la personne qui t’écrit dans cet appartement précis, sur ce clavier précis, pour ce job précis.
Parce que oui, parfois un changement peut naître en seulement quelques heures passées à bord d’un train.
C’est cette rencontre, aussi insignifiante peut-elle sembler pour toi, qui a déterminé celles d’après, et contribué à la formation de la femme « costaud » que j’ai l’impression d’être devenue.
Plus costaud en tout cas que l’ado de 17 ans, qui vivotait dans l’attente d’un « élan romanesque » (de mon cul).
Je crois très fort que ces instants de bascule, positifs ou négatifs, méritent d’être davantage contés, parce qu’ils révèlent l’imprévisibilité du vivant et signent le passage à l’âge adulte.
Un matin, tu te réveilles, tu bois ton café comme d’habitude, tu grognes, tu t’ennuies, parfaitement inconsciente que les prochaines heures modifieront profondément ta manière de concevoir l’existence.
Modifieront profondément ton « toi », et pour toujours.
X, c’est mon premier drame, la première cicatrice sur ma vie chanceuse d’humain privilégié, ma première claque.
Pendant des années, X a écorché ma peau et chacune de mes pensées.
Années qui m’ont vu être aussi violente que lui, à porter des coups, à insulter, à vomir la douleur.
Ce drame, peu importe ses contours, peu importe ses rouages, est surtout le premier auquel j’ai tordu le cou. Son issue est ma plus grande fierté.
Parfois, je pense à X, sans une once d’animosité, sans colère, sans rancune.
J’observe ce point charnière de ma vie et le considère simplement tel. Un instant de bascule.
Aujourd’hui, ça fait dix ans que je mûris tranquillement cette histoire. Dix ans que j’ai choisi d’en tirer des leçons, et d’entamer l’écriture d’un livre que je ne finirai sans doute jamais.
Dix ans que quelques heures à bord d’un TGV m’ont finalement permis de ME rencontrer.
À lire aussi : Je suis cam girl, je m’exhibe sur Internet pour de l’argent (et par amour du sexe)
Pour témoigner sur Madmoizelle, écrivez-nous à :
jaifaitca@madmoizelle.com
On a hâte de vous lire !


![Copie de [Image de une] Horizontale (49) Copie de [Image de une] Horizontale (49)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/10/copie-de-image-de-une-horizontale-49-300x300.jpg?resize=135,187&key=ec48b9bb)






![[Image de une] Horizontale (26) [Image de une] Horizontale (26)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/image-de-une-horizontale-26-768x432.jpg?resize=300,350&key=3f4065eb)





![[Image de une] Horizontale (18) [Image de une] Horizontale (18)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/08/image-de-une-horizontale-18-768x432.jpg?resize=300,350&key=1a90e2f6)








![Copie de [Image de une] Horizontale (84) Copie de [Image de une] Horizontale (84)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/12/copie-de-image-de-une-horizontale-84-768x432.jpg?resize=300,350&key=30319f9e)

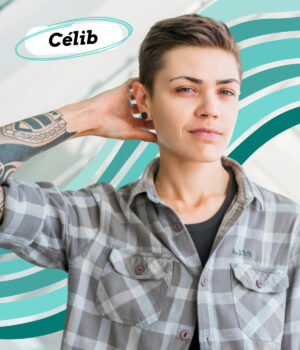




![[Image de une] Horizontale (27) [Image de une] Horizontale (27)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/image-de-une-horizontale-27-768x432.jpg?resize=300,350&key=19a71e0d)
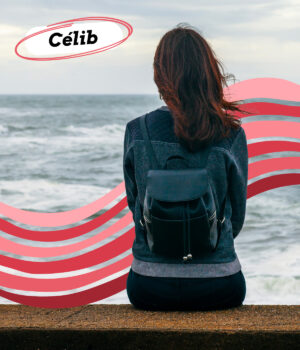
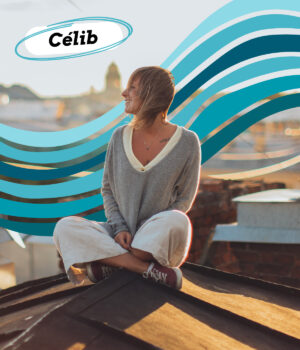




Les Commentaires