Publié initialement le 21 juin 2011
Il y a un adage très connu des amateurs de hip hop qui dit que « si le rap est une chose qui se pratique, le hip hop, lui, est une chose qui se vit ». On tient peut-être là l’essence même de ce qui anime cette culture : le hip hop refuse l’étiquette de simple « discipline », et se revendique véritable « paradigme » – que valeurs et code de conduite structurent. Du tatillonnage terminologique pour le grand public ? Pour les puristes de la question, il s’agit d’un vrai point d’honneur. « Rap is someting you do, hip hop is something you live » dit KRS-One dans son morceau 9 Elements.
Mouvement culturel né en territoire américain au début des années 70, le hip hop englobe pêle-mêle, deejaying, rap, b-boying et graffiti. De ces 4 disciplines, celles qui ont le plus de résonance dans notre société actuelle sont vraisemblablement le rap et le graffiti – le rap, parce qu’il suppose un public et par extension, un circuit économique ; le graffiti, parce que, vandale, il est considéré comme un véritable fléau par les politiques d’urbanisme. Vraisemblablement, il y a aujourd’hui un gouffre entre l’essence du hip hop et la société qui l’accueille. Comment le rap, style musical généralement dissident, peut-il à la fois prétendre s’opposer au système… et évoluer en son coeur ? Pire encore : que penser des taggeurs qui acceptent de ne plus peindre que sur des surfaces prévues à cet effet ? Le tag n’arrête t-il pas d’être tag dès lors qu’il se pratique dans la légalité ? Dans le milieu, deux voix s’élèvent : la première défend l’idée que l’exercice du hip hop dans le respect de la loi est un moyen de toucher le grand public et donc, d’assurer la pérennité du mouvement. La seconde, tonne contre cette attitude, qu’elle compare à de la prostitution. Enquête sur cette scission familiale, qui peut rappeler la plus grande des guerres rapologiques : celle qui a opposé la « east coast » à la « west coast » .
ALBUMS VENDUS VS CRÉDIBILITÉ
Chez les DJ, MC et taggeurs, l’authenticité d’une personne et le respect que ses pairs lui accordent se jaugent via la notion de street credibility, également appelée ghetto cred. Ce concept, un peu flou au premier abord, se résume en fait à une bonne connaissance du milieu urbain, une capacité certaine à imposer la déférence vis à vis de ses confrères et à une dégaine, classe et cool à la fois (ce qu’on appelle « swag« ).
La street credibility est une notion très chère aux amateurs de hip hop. De la même façon qu’on a une « bonne » ou une « mauvaise » réputation, la street cred se « gagne » et se « perd ». Cet idéal va souvent de pair avec l’illégalité, la rebellion et le non-respect des lois par goût de la débrouille.
De fait, être en procès ou être recherché par la police, être interdit de radio ou se prendre 3 balles dans le torse*, sont des gages de respectabilité dans le milieu.
* Souvenez-vous comme 50 Cent a gagné en notoriété lorsqu’il a été blessé par 9 balles, en plein milieu du Queens… Un incident qui n’est pas sans rappeler la consécration posthume de Tupac Shakur (assassiné par balles en septembre 1996).
Et paradoxalement, pour de nombreux fans, une chanson qui ne passe pas sur Skyrock, radio pourtant référence en matière de rap, est une chanson de qualité. C’est notamment ce qu’explique le blog “Sois Conscient”, ironiquement hébergé sur la plateforme de blogs de la radio Skyblog :
« Skyrock, c’est de la merde. Ils se prétendent premier sur le rap, mais y’a pas un truc qui cloche ? Dans Skyrock, y’a le mot ROCK, et pour cause : ils ont longtemps passé du rock, avant de décider de passer du rap, pour investir une part du marché qui était encore vierge. Stratégie marketing à l’origine. Stratégie marketing encore aujourd’hui, puisqu’ils ne passent que les rappeurs dont les maisons de disque ont passé un accord avec eux. Et qui sont les rappeurs qui ont des maisons de disque ? Les rappeurs qui acceptent de se plier aux exigences du système. Voilà pourquoi Skyrock passe sur ses ondes 10 fois Sniper par heure. C’est du bourrage de crane auditif, à force d’entendre une chanson tu finis par la kiffer et à en redemander. »
Stratégie marketing, prostitution, rimes et châtiment. Cette critique, on la retrouve aussi chez les rappeurs de la banlieue parisienne, ceux qui n’ont que le petit public d’une MJC pour les acclamer.
Ainsi, François, 26 ans, rappeur depuis l’âge de 11 ans, explique :
« je ne cherche pas la reconnaissance mainstream. Pour moi, la reconnaissance mainstream, c’est avant tout le nivellement vers le bas. Une fois que t’es repéré par une petite maison de disque et que tu vends des mixtapes, tu te sens plus pisser, t’es content d’avoir un public de gens qui t’adorent mais que tu ne connais pas, et un matin tu te réveilles avec l’envie d’être signé sur une major, de faire des plateaux télé avec Ruquier et de vendre des millions d’albums. Sauf que tout ça, ça suppose quoi ? Ça suppose baisser son pantalon et être conventionnel. Moi j’préfère rapper pour mes potes, meme si c’est les 5 pauvres clampins de mon immeuble, je préfère rapper comme je l’ai toujours fait : dans ma cage d’escalier ou dans la rue, juste entre nous »
Des puristes du rap comme François, il y en a beaucoup : ils pensent que rap engagé et succès commercial sont des idées antithétiques. Ce constat est aussi le coeur de l’intrigue de la série De L’encre (dont on vous parlait ici), scénarisée et réalisée par Hamé et Ekoué, fondateur du groupe irrévérencieux La Rumeur (qui vient tout juste d’être relaxé après 8 ans de procès avec le Ministère de l’Intérieur).
De L’encre raconte l’histoire d’une rappeuse qui, pour subvenir aux besoins financiers de sa famille, accepte d’être le “ghost writer” d’un artiste connu. Soit un petit boulot qui suppose écrire des textes pseudo-engagés, juste assez révoltés pour exciter la foule qui veut s’encanailler, mais au fond, tout à fait conforme à la bien-pensance. Quand on sait à quel point des morceaux tels que « Seul le crime paie » (Lunatic) et « Hold-up » (113) ont un jour fait peur aux pouvoirs publics jusqu’à faire craindre à la scène rap des procès…
https://www.youtube.com/watch?v=GDcWNBSnjOs
La société actuelle aime plus l’illusion de la subversivité que la subversivité elle-même, accusent donc les puristes.
« LE RAP COMMERCIAL FAIT VIVRE LE RAP TOUT COURT »
Ce point de vue, Bruno Laforestrie (PDG de la radio rap Générations 88.2) ne le partage pas. Contacté par téléphone, il nous explique :
« Je ne pense pas que la scène du rap français soit trop étroite et réservée aux artistes non-politisés et à ceux qui s’auto-censurent. Il y a de la place pour tout le monde, et les rappeurs qui réussissent restent cohérents dans leurs parcours. En général, ils ne font pas de leur rage une critique systémique entière. Prenons La Rumeur par exemple : le groupe s’est longtemps félicité de ne pas passer sur Skyrock, et aujourd’hui, ils bossent avec Canal +, qui est lui aussi un grand groupe médiatique. Est-ce à dire qu’ils ont retourné leur veste ? Je ne crois pas. Ils saisissent les opportunités lorsque celles-ci leur semblent en cohésion avec leurs revendications. »
L’homme qui est aussi président de l’association Hip Hop Citoyens de préciser :
« Je n’ai pas de malaise avec les artistes qui assument leurs ambitions commerciales, comme le font par exemple, Booba, La Fouine, Diam’s, Sexion d’Assaut. Après tout, le but d’un artiste n’est-il pas de chercher la diffusion de son oeuvre, la rencontre avec le public, la médiatisation et la notoriété ? Et puis, on ne peut pas exiger de tout le monde qu’ils aient la haine. Beaucoup d’artistes ont une approche festive du rap, et c’est très bien aussi. »
Cette approche festive est effectivement une posture que beaucoup de rappeurs ont adoptée, depuis toujours : pour ne citer qu’eux – Grandmaster Flash dans les années 80, TTC dans les années 2000, et plus récemment, des artistes tels que Orelsan.
Ils font généralement preuve de beaucoup d’humour et d’ironie dans leurs paroles, se jouant la plupart du temps des situations cocasses qu’offre la vie quotidienne. Ils parlent d’eux, font de l’ego trip (exercice stylistique qui consiste à se mettre en avant et s’autoproclamer le meilleur), donnent dans le story-telling (format dans lequel les paroles visent à rapporter une histoire) et jouent avec la rhétorique de la grossièreté.
Ainsi, Fanny, amatrice de hip hop, défend le hip hop non-engagé :
« on a fait toute une histoire du rôle politique du rap. C’est un peu injuste, pour le rap non-partisan : ce n’est pas parce qu’un morceau de rap ne véhicule pas des idées politisées qu’il n’est pas militant à sa façon. J’avais 14 ans quand j’ai commencé à écouter les paroles graveleuses de TTC. Quand beaucoup de gens étaient choqués par les paroles, mes copines et moi on trouvait ça très drôle de fredonner ces refrains un peu déconneurs. Pour moi, être capable de chanter ‘c’est garanti ma petite, on va baiser comme des lapins, quand t’engloutis ma bite, comme après une grève de la faim’, c’est être capable de recul, de second degré et d’autodérision. Il est aussi là, le militantisme. On milite pour une société moins coincée du cul ».
Du côté de la scène parisienne, même son de cloche. Des rappeurs connus et reconnus regrettent que le rap qui se vend soit considéré comme du “rap de vendus”. Pour ces artistes qui expliquent être entrés par la petite porte et avoir trimé pour en arriver là, la notoriété ne rime pas toujours avec l’autocensure.
« On est contents d’être médiatisés. Les rigoristes pensent que le vrai rap c’est le rap sous-terrain, nous on pense que pour que ce rap sous-terrain continue à être apprécié, il faut aussi que du rap de visibilité existe »
Ainsi, des rappeurs tels que Dabaaz (membre du célèbre groupe Triptik) continuent à faire parler d’eux, tout en revendiquant un rap authentique. Et la nouvelle garde de Rap Contenders (un open mic de Cergy) de continuer à être présent sur le web, et les soirées rap Poyz & Pirlz, de continuer à battre son plein. Avoir pignon sur rue, ça permet de montrer aux gens que le hip hop n’est pas mort.
GRAFFEURS DE SALON VS PURISTES DE LA RUE ?
Mais le débat hip hop véritable VS hip hop commercial est loin de se limiter au domaine du rap. Dans le graffiti, les pionniers de la peinture murale aussi se déchirent entre eux.
« Par définition, le tag se pratique par session, la nuit, à la dérobée. Le but, c’est de prendre possession d’un espace urbain de façon illégale et montrer qu’il nous appartient aussi, la nuit, une fois la ville endormie. »
nous explique, en anonyme, un membre très actif d’un crew parisien, avant d’ajouter :
« Les mecs qui acceptent d’être récupérés par la Mairie de Paris, de graffer sur des murs autorisés le temps d’un événement à moitié sponsorisé par le service culture de la ville, les types qui en viennent à exposer dans des galeries bon chic bon genre de bobos, à faire du tag non plus sur des murs, mais sur des toiles de 50cm de longueur sur 30 cm de largeur… c’est affligeant, y’a pas d’autre mots ».
Se faire de l’argent en ne taggant plus que légalement, ce serait donc brûler à petit feu l’esprit véritable de la discipline. C’est ainsi que Fafi, graffeuse, s’est retrouvée à exposer au Palais de Tokyo et à faire des motifs pour des baskets vendues chez Foot Locker. Mais pour la punir, maintenant on l’appelle « graffiti-artiste ». Pas « graffeuse ». Une histoire d’étiquettes, donc.

C’est visiblement également l’opinion de Kidult, un taggeur hyperactif qui a créé le buzz en février dernier en taggant à grands jets de peinture les façades de toutes les enseignes qui jouent avec l’esthétique du graffiti dans leurs produits.
[vimeo]https://vimeo.com/24246227[/vimeo]
La technique était simple : déguisé en éboueur, Kidult s’est amusé à repeindre les façades de Colette, Agnès B, et Castelbajac, en utilisant un extincteur transformé en pulvérisateur géant de peinture (appelé Fat Cap dans le jargon).

Source : le blog de graffiti Allcityblog.fr
L’ironie de la situation ? Si les autres ont porté plainte, la boutique Agnès B, elle, aurait longtemps hésité à effacer le tag : eh bien oui, sa vitrine avait plus de street cred, d’un coup…





![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/05/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-05-22t164945311-768x432.jpg?resize=300,350&key=638f1da8)


![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-28t150710132-768x432.jpg?resize=300,350&key=0dbf06ef)

![[Image de une] Horizontale (26) [Image de une] Horizontale (26)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/image-de-une-horizontale-26-768x432.jpg?resize=300,350&key=3f4065eb)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-15t163147788-768x432.jpg?resize=300,350&key=c0e2a724)
![[Image de une] Horizontale (24) [Image de une] Horizontale (24)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/image-de-une-horizontale-24-768x432.jpg?resize=300,350&key=bd0cfdc3)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-16t173042478-768x432.jpg?resize=300,350&key=e6ae1102)









![Copie de [Image de une] Horizontale (84) Copie de [Image de une] Horizontale (84)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/12/copie-de-image-de-une-horizontale-84-768x432.jpg?resize=300,350&key=30319f9e)



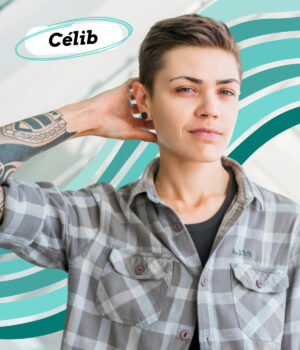







Les Commentaires
moi je pense que c'est un débat qui a toujours existé dans tous les arts, il y aura toujours les puristes torturés qui reprochent aux autres de faire du blé sur le même art qu'eux, ils leurs reprochent surtout de ne pas être torturés je pense car du blé tout le monde s'en fait et je les crois pas hypocrites au point de dire ça juste par jalousie de leur fric, après tout, le but c'est de vivre de ton art,
maintenant le truc de rester illégal je ne comprend pas du tout, bien sûr la culture hip-hop est fondée sur l'underground, la vitesse d’exécution pour les tags à cause de l'illégalité, mais si tu es passionné et tu as la chance de vivre dans un pays qui te permets d'en vivre grâce au fait que tu es dans le circuit légal du commerce, tu ne va pas cracher dans la soupe, ça montre que la société reconnaît ta culture, ce qui te tient à coeur, et s'y intéresse,
et c'est marrant, de ceux que vous avez cités, j'en adore trois : Booba, TTC et Fafi n'ont jamais vraiment même à leurs débuts été contestataires, Fafi je sais même pas si on peut appeler ce qu'elle faisait du graff, c'était du street art OK, mais ça restait des illus gentilles, pour ce qui est de TTC les textes on les connaît, c'est pas n* la police ou ta mère mais plutôt les meufs, c'est vraiment bon enfant, dans toutes les mouvances il y en a certains plus light que d'autres, je vois pas pourquoi il faudrait leur reprocher quoi que ce soit,
maintenant Booba j'ai l'impression que tout le monde s'accorde pour dire que c'est plus le même qu'avec Lunatic, après il a grandi, mûri, il est à mon avis d'une part moins énervé qu'avant, et il n'a jamais caché qu'il s'intéressait d'abord au "biff", même à l'époque, quand un des plus gros succès s'appelle "seul le crime paie" on se rend compte que, loin d'avoir vendu son âme au diable comme on l'entend partout, si à la base tu as la conscience politique d'un voyou tu ne vas pas renier l'enrichissement, l'empêcher, et si rendre le son plus mainstream permet cela, et bien allons-y;
voilà je suis d'accord, tous ne sont pas obligés de parler de politique, mais de la part de ceux qui sont engagés je trouve très malsain de critiquer et dénoncer les autres, et à part culpabiliser les gens d'écouter la musique qui leur fait plaisir je vois pas à quoi ça sert;
enfin, pour les actions pour re-illegaliser le tag, je trouve simplement ça curieux que certaines personnes aient l'impression illusoire que les codes hip-hop leur appartiennent !!! qu'une contre-culture devienne majoritaire, c'est plutôt un bon signe d'évolution de la société dans leur sens, donc il faut savoir ce qu'ils veulent . Si ce qui les dégoûte c'est que le support qui un jour servit de contestation et de révolte soit un prétexte marketing dont la cible serait un public très large, qu'ils se rassurent, et qu'ils se tournent vers d'autres cultures : le Rock'n'Roll a connu la même chose.