Si on vous dit fast food, vous imaginez sûrement de la nourriture peu chère, préparée rapidement, qui s’avale plus qu’elle ne se déguste, et ce, à vitesse grand V. Son petit prix s’explique par la piètre qualité des matières premières utilisées (dont on se soucie peu de la provenance d’ailleurs), le travail à la chaîne des employés, et le volume massif produit pour réaliser d’importantes économies d’échelle. L’expression « junk food », qu’on peut littéralement traduire par « nourriture déchet », en est d’ailleurs devenue synonyme. Eh bien, la fast fashion (littéralement « mode express ») en est l’équivalent mode : c’est de la mode jetable.
Qu’est ce qu’on appelle la fast fashion ?
La fast fashion est traitée comme le grand méchant loup de la mode. À raison. Sauf qu’elle n’est qu’un symptôme parmi d’autres des nombreuses dérives de l’industrie de la mode dans nos sociétés du spectacle et de l’hyper consommation. Mais qu’est-ce vraiment que la fast fashion ?
Elle a transformé tout un modèle économique qui régnait jusque-là. Grosso modo, avant l’essor du prêt-à-porter durant la seconde moitié du XXe siècle, les foyers modestes portaient sans cesse les mêmes vêtements, s’offrant une nouvelle tenue par an réalisée par une petite couturière, moins par vanité que pour compenser l’usure. On ne dérogeait à cette vision utilitaire du vestiaire que le dimanche pour se rendre à la messe dans ses plus beaux habits, ou d’éventuels grands événements. Les foyers plus aisés pouvaient se permettre une plus large garde-robe, mais toujours réalisée par une petite couturière d’après un patron à la mode, voire commandée auprès d’une maison de couture. Mais la popularisation du prêt-à-porter, d’abord un luxe, a donné au goût au renouvellement de garde-robe plus fréquent. Dans les années 1970-1980, on a ainsi comencé à voir fleurir en France des enseignes à prix relativement accessibles, comme Naf Naf (1973), Camaïeu (1984) ou encore Jennyfer (1985).
Mais c’est avec l’arrivée en France de Zara (fondée en 1976 en Espagne et implantée en France en 1990) et H&M (fondée en 1947 en Suède et implantée en France en 1998) qu’on a réellement commencé à parler de fast fashion dans les années 1990.
Le modèle économique de ces mastodontes de la fast fashion repose sur la production en masse, pour réaliser des économies d’échelle, de collections de qualité médiocre, qui se succèdent tous les mois (voire plus), dans le but de procurer un sentiment d’urgence, exhausteur de désir. Jusque-là, l’industrie de la mode fonctionnait plutôt avec deux collections par an : une pour le printemps-été, l’autre pour l’automne-hiver, voire quatre (une par saison).
Or, quand les collections changent tous les mois à des prix plus accessibles, cela peut donner l’impression d’une accélération du cycle des tendances et de leur obsolescence. C’est ce qui peut donner envie de se débarrasser plus souvent de ses vêtements pour s’en acheter des nouveaux, d’où l’expression de fast fashion ou de mode jetable. Depuis les années 2000, d’autres acteurs accélèrent encore le rythme comme le groupe britannique boohoo (boohoo, PrettyLittleThing, Nasty Gal) ou le mastodonte chinois Shein, pour qui l’on parle même d’ultra fast fashion.
Aujourd’hui, les marques de fast fashion peuvent produire jusqu’à 36 collections par an, ce qui a des conséquences sociales et environnementales délétères.
Quelles sont les conséquences de la fast fashion ?
Les impacts environnementaux de la fast fashion
En amont, les marques de fast fashion produisent pour optimiser leurs finances souvent dans des pays dits du Sud (surtout en Asie du sud-est et en Afrique subsaharienne), où la main d’œuvre est moins chère, et où les lois sont moins regardantes sur les conditions de travail, ainsi que la régulation de la pollution. Les entreprises ont ainsi moins à dépenser dans le choix de technologies de production les moins polluantes possibles. Or, transformer des matières premières en tissu, les traiter chimiquement, les tanner, les teindre, etc, nécessite beaucoup d’eau et d’électricité. Et surtout, cela rejette énormément de déchets toxiques dans l’air et surtout dans les eaux alentours, contaminant la faune et la flore de toute une région. Et de façon générale, plus l’on produit de vêtements, plus on consomme de ressources environnementales, or on dépasse largement les ressources que la planète est capable de produire en un an pour régénérer ces consommations ou absorber les déchets produits, dont le CO2. On puise donc de plus en plus, de manière irréversible, dans les réserves « non renouvelables » (à échelle de temps humaine) de la Terre et accumule les déchets qu’on ne saurait éliminer.
En aval de la vie des vêtements issus de la fast fashion, si ceux-ci sont de piètre qualité et que l’industrie de la fast fashion pousse à sans cesse racheter de nouveaux habits, on se débarasse plus régulièrement de ceux qu’on possède déjà. Or, on recycle encore peu, et ces vêtements sont rarement assez solides pour changer plusieurs fois de propriétaire dans le marché de la seconde main, ou même sous forme de dons aux plus démunis via des associations. C’est pourquoi ils terminent le plus souvent dans des décheteries où ils finissent incinérés (ce qui pollue), enfouis (ce qui pollue aussi), ou envoyés à l’autre bout du monde à se dégrader lentement dans des « décharges à ciel ouvert ». Par exemple, le désert d’Atacama au Chili ou la ville d’Accra au Ghana font partie des cimetières de la fast fashion les plus connus au monde, mais sont loin d’être les seuls. De là, les vêtements se dégradent dans l’environnement, débordent dans les égouts, polluent les plages, et se décomposent péniblement dans les océans, abîmant la faune et la flore.
Même durant le cycle de vie des vêtements, ces derniers polluent relativement (mais c’est dérisoire comparée à la production, et à la fin de vie). En effet, quand on les porte et surtout les lave, ils génèrent des micro-particules. On peut se dire que ce n’est pas grave pour du coton ou de la laine, mais s’inquiéter davantage pour le polyester, l’acrylique et autres matières premières de synthèse. En effet, cela forme des micro-plastiques qui finissent dans les océans et contribuent à former le « 7e continent de plastique » (de manière dérisoire, encore une fois, comparée à la pollution plastique industrielle).
Les impacts sociaux de la fast fashion
Outre les économies d’échelle, pour gagner encore plus d’argent, les marques sous-traitent leur production principalement en Asie du sud-est et en Afrique subsaharienne où les ouvriers textiles reviendront moins chers que dans les pays dit du Nord où est le plus lourdement consommée la fast fashion. Or cela contribue à ce que l’économie des pays producteurs dépendent énormément de cette industrie, au détriment du développement d’une économie plus autonome.
Pour maintenir leurs profits, les marques paient le moins possible leurs sous-traitants à l’autre bout du monde, sans toujours se soucier de leurs conditions de travail. Or, l’effondrement des ateliers de confection du Rana Plaza au Bangladesh en 2013 a tristement illustré les conséquences d’une telle négligence : 1 127 morts sur le coup, et 1 135 morts d’après des estimations ultérieures. À Tanger au Maroc en 2021, c’est 28 autres personnes qui sont mortes en fabriquant nos vêtements. Les catastrophes de ce genre sont nombreuses et rarement mentionnées dans les médias. Mais ce n’est que le pic émergé de l’iceberg de la fast-fashion.
Sous la glace, dans ces ateliers de misère, travaillent à 80 % des femmes soumises à une cadence infernale et sous les ordres d’hommes qui maintiennent la pression par tous les moyens. Parmi ceux-ci, comptent évidemment le harcèlement moral, sexuel, les agressions sexuelles et les viols, comme l’a souligné un rapport d’avril 2022 Business & Human Rights Resource Center.
En fin de vie des vêtements issus de la fast fashion, puisqu’ils sont produits et jetés massivement (la France s’est débarrassé de 205 000 tonnes de vêtements en 2020 par exemple), et que leur piètre qualité ne leur permet pas de durer du côté de la seconde main, cela pollue donc l’environnement, comme on vient de le voir, mais étouffe aussi les marchés de l’habillement de certains pays. Par exemple, comme 15 millions de vêtements d’occasion arrivent chaque semaine rien qu’au Ghana (qui compte 32 millions d’habitants), dont 40% tiennent de déchets, les 60 autres pourcents tentent péniblement de se vendre sur les marchés locaux, au détriment de ce qui est produit sur place. Et le tri est surtout réalisé par des femmes et des enfants, ce qui maintient et renforce un cercle vicieux de précarité.
Quelles sont les marques qui font de la fast fashion ?
Les marques les plus connues de la fast fashion sont celles du groupe H&M (H&M, COS, & Other Stories, Arket), du groupe Inditex (Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home), du groupe boohoo (boohoo, Nasty Gal, PrettyLittleThing), ou encore du groupe Fast Retailing (Uniqlo, Comptoir des cotonniers, Princesse Tam Tam, Theory). N’oublions pas Asos et Shein qui contribuent largement.
Mais en réalité, le succès économique de ces marques a inspiré une grande partie de l’industrie de la mode qui leur a emboîté le pas pour produire des collections toujours plus fréquemment. Ainsi, même du côté de certaines marques de luxe bien connues, il arrive qu’elles proposent plus d’une dizaine de collections par an (dans des volumes de production moindre, tout de même). Les marques premium / milieu de gamme aussi proposent des dizaines de collections par an, désormais. Ce sont donc des dynamiques de production et de marketing qu’on peut retrouver dans toutes les gammes de prix, aujourd’hui. C’est pourquoi il vaut mieux tâcher de les comprendre afin de pouvoir les identifier partout, plutôt que de chercher à retenir une liste que voici tout de même :
- H&M
- COS
- & Other Stories
- Arket
- Zara
- Pull & Bear
- Massimo Dutti
- Bershka
- Stradivarius
- Oysho
- boohoo
- Nasty Gal
- PrettyLittleThing
- Uniqlo
- Asos
- Shein
Comment remédier à la fast fashion ?
Si l’on veut remédier à la fast fashion à l’échelle individuelle, on peut commencer par acheter moins de vêtements en général, a fortiori de première main. Car s’acheter tous les mois plusieurs vêtements d’occasion, c’est continuer à participer au système global qu’est devenu la mode jetable, en contribuant à la fast-fashionisation de la seconde main. Si l’on s’achète 2-3 fois par an, 2-3 pièces issues de la fast fashion, surtout si on les a chinées de seconde main, par exemple, il n’y a vraiment pas de quoi culpabiliser. À l’échelle individuelle, le plus important reste de réduire sa consommation globale, réparer ce que l’on a déjà, tenter de le réutiliser autrement si ça n’est plus portable en l’état en le réinventant et/ou en le recyclant.
À lire aussi : Mode d’emploi pour passer de la fast-fashion à un style plus éthique et responsable





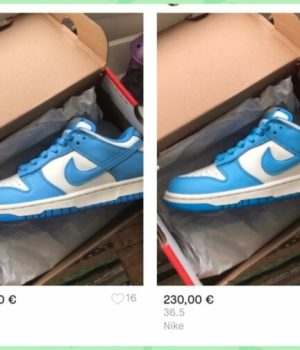




























Les Commentaires
Comme dit @Onaimelesfleurs : de constituer une garde robe écoresponsable nécessite des moyens financiers que nous n’avons pas tou.tes. Chez nous, nous faisons super attention à ce qu’on achète comme vêtements (gardes robes minimalistes pour nous trois), mais c’est impossible malgré ça d’avoir du 100% écoresponsable. Exemple concret (nous sommes en Suisse) : un pull 100% coton varie entre CHF 25.00 et CHF 35.00. Le même en 100% éco/bio/responsable sera disp à partir de CHF 45.00 voire CHF 50.00 (soit une demie semaine de courses chez nous). L’idée d’acheter - drastiquement considérablement et radicalement - moins est évidente, mais quand bien même on achète peu, mettre si cher pour une pièce, ce n’est pas possible.
Cela rejoint le débat du bio: doit on être riche pour manger moins ?
Pour moi, la réponse est non. On ne mange pas bio chez nous, mais local et de saison. C’est possible de trouver un juste équilibre dans l’écoresponsabilité en achetant raisonnablement et en privilégiant le 100% coton (par exemple). Ce sont les habitudes de consommation des clients qui vont faire bouger l’offre, mais ce n’est pas gagné.
Et en ce qui concerne les habits de ma progéniture, je ne peux clairement pas lui faire une garde robe en bio éco etc. Ça coûte un rein, les enfants grandissent vite - et explosent le tissu à une vitesse folle - donc il n’y a que du seconde main dans l’armoire de mon enfant. C’est la meilleure alternative que j’ai trouvé pour que ça roule pour nos finances et le côté écologique de l’affaire.