Le 22 juin 2021
« Ce film est éminemment politique et pourtant, il n’y a pas de sociologue : les adultes adoptés n’ont pas besoin d’experts. »
En salles le 23 juin 2021, Une histoire à soi est le dernier documentaire d’Amandine Gay. Elle y dresse le portrait de cinq adultes ayant été adoptés dans un pays alors qu’ils étaient originaires d’un autre.
Du privé au politique, de l’enfance à l’âge adulte, les images d’archive qui se succèdent et la voix off des protagonistes nous poussent à réfléchir sur les différents enjeux posés par l’adoption internationale, mais pas que. Réflexion que l’autrice et documentariste poursuit à travers un nouvel essai, Une Poupée en chocolat, aux éditions La Découverte, publié le 23 septembre 2021. Interview.
Interview de Amandine Gay, autrice, documentariste, et artiste
Madmoizelle : Comment décrirais-tu Une histoire à soi ?
Amandine Gay : Une histoire à soi, c’est un film d’archives, au sens propre du terme. Il va au bout de la forme, car j’ai fait le choix de ne représenter les participants qu’à travers des images d’archives. C’est le récit de cinq personnes adoptées qui, au moment du tournage, avaient toutes entre 25 et 53 ans. Elles sont originaires du Sri Lanka, du Brésil, du Rwanda, d’Australie et de Corée du Sud.
Je voulais, à travers ce film, représenter les différents temps de l’adoption, mais aussi les contextes géopolitiques dans lesquels les adoptions ont lieu. Je voulais aussi élargir les sujets du film et amener les spectateurs à une réflexion sur le faire famille.
Comment as-tu choisi les participants et participantes ?
J’avais plusieurs critères. Je voulais des personnes possédant beaucoup d’archives très diverses. Je voulais aussi un casting mixte : mélanger des hommes et des femmes d’âges différents. Il fallait aussi qu’ils puissent tenir un discours politique.
Avec Enrico Bartolucci, on a rencontré 93 personnes à qui on a bien expliqué le processus. De là, 42 ont accepté d’être enregistrées. On a ensuite écouté leurs témoignages pour faire le tri. On a alors choisi de retranscrire 19 récits. À la relecture, on en a gardé onze. Puis on a fait un choix en essayant de résumer les différents récits sans les trahir — par exemple, on a eu affaire à une dame de 73 ans dont le vécu était beaucoup trop riche pour être racontée en une vingtaine de minutes, alors on n’a pas pu la garder.
On est alors arrivés aux cinq participants qu’on voit dans le film. Le processus a mis presque un an.
Y a-t-il eu un élément déclencheur pour la création de ce film ?
Je suis plutôt un diesel, moi [rires]. ça m’arrive rarement d’avoir des épiphanies.
J’ai commencé à travailler sur la question des adoptés internationaux en 2015 alors que j’étais à Montréal pour mon master en sociologie ; je faisais d’ailleurs partie de l’Hybridé, une association pour personnes adoptées. En 2018, j’ai créé le Mois des adopté.e.s [qui a lieu en novembre, NDLR]. Et c’est à cette époque-là que j’ai commencé l’écriture du film.
La phase de création arrive à un moment de synthèse après des années de militantisme. J’y trouve donc un intérêt personnel : j’ai envie de m’intéresser à ce que ça veut dire que d’être adoptée. Avec la sortie de mon livre autobiographique à venir, la boucle sera donc bouclée.
C’est quoi les circonstances politiques de la séparation des familles ?
Amandine Gay
Est-ce que le but d’Une histoire à soi, c’est de lever le tabou sur la dimension politique de l’adoption internationale ?
Il n’y a pas de tabou autour de l’adoption internationale. En une recherche sur Google, on trouve plein d’articles, de films… Mais beaucoup d’éléments politiques n’ont pas été traités pour autant : la race, la classe, l’acculturation, le fait d’être assimilé à une autre culture. On se concentre parfois sur le « est-ce que c’est bien ou pas ? », mais on parle peu des parents de naissance : c’est quoi les circonstances politiques de la séparation des familles ?
Et puis, qu’est-ce qui se passe pour les personnes adoptées tout au long de leur vie ? Est-ce qu’elles peuvent se rencontrer entre elles ? On avait rencontré une fille en Belgique à qui je demandais si, dans son organisme d’adoptés, il y avait des rencontres entre adoptés. Elle a répondu « mais “adopté” c’est pas une identité, on ne va pas faire un weekend des adoptés ! ». Pourtant, il faut qu’on se retrouve, qu’on crée du lien, qu’on montre notre expérience.
Ce que je veux, c’est améliorer la pratique des personnes adoptées qui continuent d’arriver en France. Elles peuvent bénéficier de notre expérience. Une histoire à soi, c’est le film dont j’aurais eu besoin durant mon adolescence.
Qu’est-ce que ça veut dire pour toi « améliorer la pratique des personnes adoptées » ?
C’est faciliter la vie des personnes adoptées. Par exemple, j’ai déjà animé un atelier permettant aux parents blancs d’apprendre à s’occuper des cheveux de leurs enfants noirs.
Il faut que les parents se préparent à l’adoption : un enfant noir, par exemple, a des besoins spécifiques. Alors il faut se poser des questions : est-ce qu’on a visité le pays de l’enfant ? Est-ce qu’on peut l’y amener ? Est-ce qu’on s’intéresse à sa langue, à sa culture ? Est-ce qu’on a une sociabilité noire avant d’adopter des enfants noirs ? Parce que si son enfant est la seule personne noire qu’on connaît, c’est de mauvais augure…
En France on a un énorme tabou autour de la race, ce qui ne peut poser que des problèmes dans le cadre de l’adoption internationale.

Et c’est d’ailleurs le casting lui-même qui amène ces questionnements au sein du film, il n’y a aucun expert !
Il faut reconnaître l’expertise des personnes concernées. Pour que l’on comprenne notre histoire, il faut qu’on se mette à lire, qu’on mette en place des stratégies pour rencontrer des gens, trouver les dossiers, etc. Donc on développe une expertise et un regard politique. Moi, ce qui m’intéresse, c’est leur parole.
Ce film est éminemment politique et pourtant il n’y a pas de sociologue : on n’a pas besoin d’experts. Et j’ai un regard politique aussi. Donc on trouve quand même une dimension d’expertise, sans pour autant qu’il y ait de parole d’autorité.
Pourquoi avoir choisi de raconter les différents récits de manière chronologique ?
Cette histoire qui semble racontée de manière chronologique est en fait une reconstitution par les intervenants. Quand on est adopté, la condition pour pouvoir se réapproprier son histoire et tout remettre en ordre, c’est d’atteindre l’âge adulte. C’est une question d’agentivité [capacité à agir sur soi et sur le monde, ndlr] parce qu’on effectue un travail de détective. Et l’intérêt du cinéma, c’est de remettre le récit en forme, on peut recoller les morceaux.
Cette question d’agentivité, c’est aussi ce dont Virginia Woolf parle dans Une chambre à soi. Donc j’imagine que, au-delà du titre, il y a un lien entre les deux œuvres ?
Oui ! Je m’intéresse beaucoup aux groupes peu représentés. Dans Une chambre à soi, on parle des conditions nécessaires pour que les femmes puissent devenir écrivaines. Donc, par extension, on s’intéresse aussi aux personnes issues de minorités et aux conditions qui leur sont nécessaires pour qu’elles s’accomplissent.
Pour une personne adoptée, la condition principale, c’est devenir adulte — pour aller dans son pays d’origine, avoir accès aux dossiers… C’est là qu’on se crée soi-même. Il y a donc un parallèle entre la situation des femmes à l’époque de Virginia Woolf qui devaient avoir certaines conditions pour écrire leurs romans, et les adoptés qui ont besoin de certaines conditions pour créer et se réapproprier leurs propres récits.
Tout comme tu vois une dimension universelle dans Une chambre à soi, vois-tu une dimension universelle à Une histoire à soi ?
Je veux que le film ait une dimension universelle ! Qu’on soit adoptée ou non, je veux que suite au visionnage d’Une histoire à soi on s’interroge sur la manière dont on fait famille aussi. Quand on se pose la question de la PMA, de combien de parents on peut avoir, eh bien on se rend compte avec l’adoption qu’on peut avoir quatre parents ! Il y a aussi le statut des enfants. Il faut arriver à les considérer comme de jeunes personnes avec peu d’expérience, certes, mais qui ont des ressentis et des pensées tout à fait pertinents. Le film amène toutes ces questions.
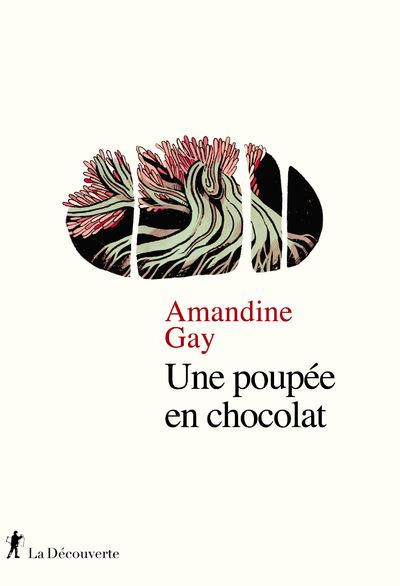
Une poupée en chocolat, de Amandine Gay, éditions La Découverte, 20€ les 368 pages.
À lire aussi : Kelsi Phụng, artiste non-binaire : « Zone Interdite présente la non-binarité comme un phénomène de mode »
Crédit photo de Une : Portrait d’Amandine Gay par Otto Zinsou
Et si le film que vous alliez voir ce soir était une bouse ? Chaque semaine, Kalindi Ramphul vous offre son avis sur LE film à voir (ou pas) dans l’émission Le seul avis qui compte.


































Les Commentaires