Madmoizelle. Trois ans après Le Cœur Synthétique, vous revenez avec Pauvre folle. Exit Adelaïde, bonjour Clotilde. Est-ce que vous voyez un lien entre ces deux héroïnes ?
Chloé Delaume. Ce sont des doubles. Adélaïde, c’était mon double “râteau”. La période où je découvrais le célibat tardif. C’était tout ce qu’il y a de plus tarte chez moi. Et Clotilde, je la développe depuis 2004. Elle est apparue la première fois dans “Certainement Pas”. Clotilde est mon double de travail : elle est autrice, comme moi, sur le profil psychique aussi, elle est bipolaire. C’est le double calqué. Pour Adélaïde, j’ai décalé un peu. J’ai mis des ingrédients qui venaient de l’extérieur, des anecdotes de copines en plus des miennes. Sur le sujet des connexions, je travaille sur un projet de série qui adapte les personnages de ces deux livres. Le but est de dégager des problématiques contemporaines à partir de ces femmes, en prenant Clotilde comme héroïne.

Vous abordez dans ce roman dense diverses thématiques féministes, dont le mouvement Me Too, joliment rebaptisé “La Violette”. Vous revenez sur le féminicide de votre mère. Est-ce que La Violette vous a permis de mieux comprendre ce qui s’est passé ?
Oui, le fait que le terme ne soit entré dans le dictionnaire qu’en 2015 déjà, ça implique qu’avant, on n’avait pas le mot. Or, ce qui n’est pas nommé n’existe pas. Je me suis construite sur ce qu’on appelait un “fait divers” et pas un point systémique, l’acmé des violences patriarcales. Du coup, j’avais l’impression que c’était quelque chose de singulier et pas de général. Et cette singularité-là me paraissait monstrueuse. C’était très tabou et vu comme pas commun. Or, c’est commun ! Une tous les deux ou trois jours qui tombe, ça veut dire quelque chose de commun.
“Ce qui n’est pas nommé n’existe pas”
Quand j’ai écrit “Le cri du sablier” en 2001, sur le sujet, c’est passé par une écriture expérimentale, parce que le nommer est excessivement difficile. Je n’avais pas les outils, donc oui, ça modifie. Il y a une lucidité supplémentaire. C’est pas nouveau chez moi, mais l’incarnation se fait différemment. J’ai envie de communiquer avec les femmes, ce qui n’était pas le cas avant. J’étais dans une démarche purement esthétique. Je n’étais pas sur un discours commun. Là, j’ai envie d’être utile. Parler à des femmes, qui pourraient se rendre compte que ça peut leur pendre au nez. C’est une réalité.
Vous évoquez avec force le sujet de la santé mentale. Clotilde est bipolaire et se débat avec son “raptus suicidaire”. Ces dernières années, post-covid, ont vu cette thématique prendre le devant de la scène. Comment l’avez-vous vécu ?
On se réjouit toujours dans ces cas-là. Le fait que ce soit un sujet dont tout le monde peut s’emparer, surtout faire sortir du bois ceux qui ont honte d’avoir des troubles psychiques. Parce qu’il y a un problème de déni, de la personne malade. Le regard des autres joue beaucoup là-dessus. Le fait d’avoir une prise de conscience collective, c’est toujours une très bonne chose.
Dans le chapitre sur ce sujet, je parle d’aliénation et magie blanche, en référence au texte d’Antonin Artaud, “Aliénation et magie noire”. Il y a la volonté de parler à ceux qui sont atteints de troubles, et qui ne veulent pas se médicamenter pour des questions de principe et de rapport à la faiblesse. Il faut accepter d’être en dépression. Il y a encore des gens qui considèrent que c’est abdiquer face à la vie.
J’ai aussi vu Pauvre folle comme un grand roman sur la bisexualité et ses complexités. Clotilde se dit plus ou moins bisexuelle, mais malheureuse. Le Monstre s’accroche à son identité de gay comme à une bouée de sauvetage. En tant que bi, n’est-on pas toujours un peu déchiré dans cette société ?
C’est compliqué, parce que personne n’a confiance en fait. La lesbienne va se dire qu’on est un peu chez les hétéras, donc un peu un ennemi, et l’hétéro va vous percevoir comme une lesbienne potentielle. Donc en fait, ça met tout le monde en insécurité. Il y a rien de plus insécurisant qu’une personne bisexuelle !
Et je ne me définis même pas comme bie. J’ai plutôt une grosse tendance hétéra et après c’est une question de rencontre de personne. Je sais que maintenant, les jeunes disent pansexuelles. J’ai d’abord été rétive à l’apparition de ce terme, parce que ma génération s’est évertuée à faire tomber les catégories. On n’aimait pas ça, les catégories. A l’époque, c’est l’universalisme qui domine. Le mouvement se veut dans le rassemblement. De fait, toute nouvelle catégorie a tendance à crisper les enfants de Casimir, dont je fais partie. Mais c’est vrai que le mot pansexualité définit une situation réelle : on tombe amoureux d’une personne, indépendamment, justement, de toutes catégories.
“Il y a toujours ce problème d’assumer un chemin de traverse, une fluidité.”
Et dans le cas de Guillaume, aka Le Monstre, on voit rarement ce type de trajectoire : un personnage gay qui refuse sa bisexualité ou pansexualité.
C’est toujours une question de placard. Guillaume est dans le placard “gay” au bout du compte. Il y a une inversion, mais ça revient au même. Parce qu’il y a toujours ce problème d’assumer un chemin de traverse, une fluidité. Les vieilles générations, on n’est pas prêtes. C’est évident chez les jeunes, mais on a été tellement formatés, avec de l’internalisé. Le discours du personnage de Wilfried dans le roman est là pour ça : il explique que ça valorise Guillaume d’être aimé par une hétéra, parce qu’il a de l’homophobie internalisée. Il y a une forme de honte. D’où sa revendication de se dire “pédé” à tout crin, pour contrebalancer. Et aussi le fait, qu’il ne peut pas s’être défini gay pendant 50 balais et d’un seul coup basculer en hétérosexualité. Ce serait pour lui une régression absolue. Il s’est battu pour construire son identité. C’est un truc de case, ça voudrait dire renier l’identité sur laquelle on s’est construit. Alors qu’en fait, c’est assez logique que ce soit fluctuant.
Vous posez dans Pauvre Folle une question fort pertinente : “Le féminisme radical est-il compatible avec une histoire d’amour hétérosexuelle ?” Avez-vous la réponse ?
Je crois que malheureusement la réponse n’est pas oui. Et c’est là que ça va être bien pratique d’être fluide à un moment donné (rires). C’est extrêmement compliqué. Encore une fois, c’est une question de génération. A partir de 35 ans je dirais, on peut en trouver qui sont déconstruits, mais vous les prenez entre 45, 50 ans et au-delà, il faut avoir une femme de ménage et un lave-vaisselle !
Il y a un passage dans le livre, où Clotilde en a ras-le-bol. Tout ce qui est dedans, ce sont des choses qu’on m’a sorties IRL à un dîner lunaire (rires) ! Un homme m’a vraiment dit ‘Ici c’est pas l’Afghanistan’ ! Ou une citation d’Emmanuel Todd : ‘le patriarcat n’a jamais existé en Occident !’. Super ! Et la phrase de Darmanin, ‘Ok mais prenons un dernier verre’. Un grosse partie des hommes est dans le déni, de ses privilèges. C’est un peu compliqué de relationner dans ces cas-là. Je suis assez persuadée que pour les hétéras, c’est une génération sacrifiée. La lucidité fait qu’on ne peut plus y aller, c’est pas possible.
“Comment est-ce qu’on peut, dans une relation qui s’avère objectivement toxique, ne pas lâcher le morceau, jamais ?”
“Est-ce que c’est vraiment l’autre qui déclenche les émois ? Tombe-t-on amoureuse uniquement parce qu’on a besoin de shoots réguliers de dopamine ? Est-il possible d’aimer à en devenir folle juste pour ne pas crever d’ennui ?” Dans Pauvre Folle, vous tentez de discerner la part de désir, d’ego, d’ennui, de fantasme dans une relation amoureuse. Je sens deux forces contraires dans ce roman : le besoin de sublimer le sentiment amoureux et de le dépecer. Laquelle va gagner ?
Aucune ne peut l’emporter, parce qu’on est face au problème de la dissonance cognitive. Ce sont des forces égales. D’un côté, il y a la lucidité, le ‘merci bien, j’ai autre chose à foutre’, et de l’autre côté, il y a le ‘oui mais la crinoline me pousse et j’aimerais bien aller à Heidelberg’ (destination romantique où se rend en train l’héroïne du roman) ! Je voulais travailler sur deux choses : ce mouvement de tension et le mécanisme du déni. Comment concrètement, on est dans le forçage de la réalité et l’évitement. Comment est-ce qu’on peut, dans une relation qui s’avère objectivement toxique, ne pas lâcher le morceau, jamais ? Alors que c’est une insulte à l’intelligence ! Qu’est-ce qui fait freezer l’intelligence (rires) ? C’était un peu ça l’idée.
Le chapitre intitulé “Petite typologie du mâle hétérosexuel post #MeToo” est si drôle et incisif. Il y a un mélange des genres dans votre roman qui fonctionne tellement bien. Un part de comédie, le registre merveilleux pour raconter “elleetlui”, des moments plus sombres… Quelle partie vous a donné le plus de fil à retordre ?
La scène de sexe. Elle fait un paragraphe, ça m’a pris trois jours à l’écrire. Je n’y arrivais pas. Je déteste tout ce qui touche à la littérature érotique et pornographique. Je trouve ça grotesque. Je lisais Sade en hurlant de rire quand j’étais môme, et à part lui, tout me paraît gênant. On n’a pas un vocabulaire très adapté. Soit c’est cru, soit c’est fleuri à base d’abricots. Le vocabulaire érotique est hyper flippant ! La scène du coup de foudre m’a aussi demandé du travail. J’ai relu la scène de rencontre entre Chloé et Colin dans « L’écume des jours » (de Boris Vian, ndlr). Techniquement, ce n’est vraiment pas simple à écrire, un coup de foudre.
“La vie et l’écriture, c’est la même chose”
“Pauvre Folle” est une nouvelle autofiction. Entre ce genre et vous, c’est une histoire d’amour ?
J’ai commencé en autofiction expérimentale. J’étais au « je ». Là, c’est une autofiction impure. Normalement, une autofiction s’écrit au « je » : héros, narrateur et auteur doivent être la même personne. Mais je fais ce que je veux (rires) ! Dans ce livre, on comprend, alors qu’habituellement on ressent. Mon écriture est faite pour ressentir mais ce n’est pas une écriture qui raconte. C’est un condensé des livres précédents, il y a tout dedans. Et l’histoire d’amour commence page 57, ce qui n’est pas très préconisé ! Ça donne une construction presque cinématographique, avec un premier tiers qui correspond à l’installation de la situation.
Mais pourquoi ce genre de l’autofiction ?
Parce que la vie et l’écriture, c’est la même chose. En médecine chinoise, on dit que le cœur est relié à la langue. Et je pense qu’il faut avoir éprouvé avec le cœur pour être capable d’avoir la langue juste. Peut-être aussi que les événements vécus sont suffisamment riches et porteurs d’universalité aussi pour ne pas avoir à inventer.
Comment réagissent vos proches, qui se retrouvent dans vos autofictions ?
Au début, ils étaient morts, donc ça solutionnait pas mal le problème (rires). Sinon, ce sont des outils de vengeance. J’ai fait un livre pour tuer ma grand-mère quand même ! Ils ne le prennent pas très bien. C’est étudié pour. Et puis, aujourd’hui, les gens savent ce que je fais. Ce qui est drôle, c’est qu’ils se reconnaissent quand c’est pas eux. Quand ils sont dedans, ils ne sont pas contents et en même temps, ils sont flattés. Et quand ils ne sont pas dedans, ils se plaignent ! Donc, je crois qu’il ne faut pas s’en occuper.
Votre style est si particulier, si reconnaissable. Cet amour pour la métrique et la poésie conjugué à des sujets contemporains. Comment avez-vous trouvé votre voix ? Avez-vous un conseil pour celles qui débuteraient ?
J’ai été éduquée par ma mère à la métrique, c’est ça qui prédomine du coup. Spontanément, mes phrases sortent en huit ou en douze. Des conseils, je ne sais pas… Je pense que ça ne s’apprend pas. Pour trouver sa voix, il faut se faire confiance, c’est tout. Il faut creuser sa singularité, je dirais. On vit dans une époque où tout est tellement formaté.
Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos podcasts. Toutes nos séries, à écouter d’urgence ici.



![Copie de [Image de une] Horizontale (1) Copie de [Image de une] Horizontale (1)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/01/copie-de-image-de-une-horizontale-1-1-300x300.jpg?resize=135,187&key=6318d96b)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-08-27T142659.508 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-08-27T142659.508](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/08/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-08-27t142659508-300x300.jpg?resize=135,187&key=3f482104)


![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/05/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-05-22t164945311-768x432.jpg?resize=300,350&key=638f1da8)


![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-28t150710132-768x432.jpg?resize=300,350&key=0dbf06ef)

![[Image de une] Horizontale (26) [Image de une] Horizontale (26)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/image-de-une-horizontale-26-768x432.jpg?resize=300,350&key=3f4065eb)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-15t163147788-768x432.jpg?resize=300,350&key=c0e2a724)
![[Image de une] Horizontale (24) [Image de une] Horizontale (24)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/image-de-une-horizontale-24-768x432.jpg?resize=300,350&key=bd0cfdc3)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-16t173042478-768x432.jpg?resize=300,350&key=e6ae1102)









![Copie de [Image de une] Horizontale (84) Copie de [Image de une] Horizontale (84)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/12/copie-de-image-de-une-horizontale-84-768x432.jpg?resize=300,350&key=30319f9e)



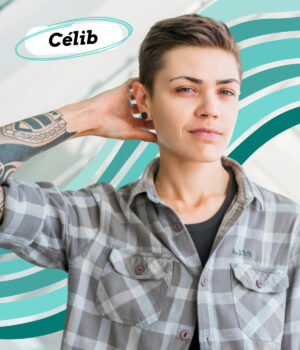







Les Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaire sur cet article.