Sur une affiche bleutée, une policière à la mine tendue. On pense à The Guilty, de Gustav Möller. S’il commence comme un thriller, Quitter la nuit prend un virage à 360°. Le film a beau partir d’une histoire vraie, il se désintéresse très vite de l’aspect impressionnant du fait divers pour se tourner plutôt vers l’exploration de mécanismes profonds et viciés de la justice.
La bande-annonce de Quitter la nuit
Une nuit, une femme en danger appelle la police. Anna prend l’appel. Un homme est arrêté. Les semaines passent, la justice cherche des preuves, Aly, Anna et Dary font face aux échos de cette nuit qu’ils ne parviennent pas à quitter. Entre une institution aux méthodes parfois glaciales et les trois personnages, un fossé se creuse.
Madmoizelle. Quitter la nuit est inspiré de faits réels. Pouvez-vous nous parler de sa genèse ?
Delphine Girard. En 2018, je suis tombée par un hasard sur un appel au 911, le numéro d’urgence aux États-Unis. C’était une femme qui faisait semblant d’appeler sa sœur pour appeler les secours alors qu’elle se faisait kidnapper par un homme. J’ai été très secouée et touchée par cet appel, par ce qui peut être dit ou non pour faire comprendre à l’autre la détresse que l’on est en train de vivre. J’en ai fait un court-métrage qui est d’ailleurs les 15 premières minutes de Quitter la nuit. Le but de ce film est de suivre la trajectoire des trois personnages après cette nuit cauchemardesque, et de voir quelle proposition le système judiciaire va leur faire.
Votre film révèle que la justice attend un certain comportement de la part des victimes. Votre personnage, Ali, ne rentre pas dans ce rôle.
C’est ce que j’ai observé durant les procès auxquels j’ai assisté, c’est qu’on attend des victimes qu’elles soient dans une certaine posture. Certaines femmes m’ont expliqué devoir surjouer pour être crues. Ali, le personnage de mon film, ne veut pas s’aliéner, mentir pour être écoutée. Lors de leur rencontre, l’homme qui deviendra son agresseur lui a plu, c’est elle qui lui a proposé d’aller chez lui, avant de se rétracter. Mais ça, ça ne colle pas avec le discours que la justice veut entendre. Ali n’est pas docile. Elle n’est pas une victime parfaite, mais en fait, ça n’existe pas. On n’a pas à exiger quoi que ce soit des victimes.

Votre film résonne avec Anatomie d’une chute. Dans le film de Justine Triet, l’avocat de Sandra lui répond « ce n’est pas la question » quand elle lui dit qu’elle est innocente. Ces deux films montrent que la justice n’est qu’un jeu, un simulacre.
C’est très juste. En allant à des procès, j’ai eu l’impression de voir du mauvais théâtre.
Naïvement, j’ai cru que la justice était un endroit où on cherchait la réparation, l’évolution des mentalités.
Mais il n’y a ni le temps ni la place. Soit la justice punit, soit elle ne fait rien du tout. J’étais très naïve, mais je pensais que face à la justice, les victimes pouvait dire ce dont elles ont besoin. Mais ça n’existe pas. On s’en fout. La justice est tellement préoccupée par les preuves qu’elle passe à côté de ce que vivent les gens.
À lire aussi : Après Anatomie d’une chute, 6 films qui prouvent que le cinéma français est le meilleur du monde
Votre film suit la vie de l’agresseur, alors qu’on aurait pu s’attendre à ce qu’il se concentre uniquement sur la victime. La plupart du temps, dans les films et les séries, les agresseurs restent dans l’ombre. Pourquoi avoir fait ce choix ?
Je pense que ça ne nous aide pas de se dire que c’est un monstre. Les hommes qui commettent des actes violents, des viols, sont des hommes que l’on connaît. Le psychopathe malade est une infime proportion des agresseurs. Je veux réfléchir à ce qu’il faut à cet agresseur pour lever le voile sur son agissement, se remettre en question.
Je peux entendre que ce soit particulier de voir un film qui les contient tous les deux. C’est inconfortable. Et lui se porte assez bien. Mais ça fait partie de la problématique.
Un homme qui a violé, ça ne se voit pas. Il est sympa avec sa mère, aimé à son travail. Ce qui m’intrigue chez ce personnage, c’est à quel point il ne sait pas ce qu’il a fait.
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-04-09T155744.636 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-04-09T155744.636](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/04/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-04-09t155744636.jpg?resize=1920,1080&key=762eef61)
Pour résumer, l’enjeu pour ce personnage est de comprendre qu’il a détruit la vie d’une femme ?
Je pense que chez les humains, à des degrés différents, on s’arrange avec la vérité. On parle beaucoup d’amnésie traumatique pour les victimes, mais ça existe aussi pour les auteurs. Il s’arrange avec une image de lui-même avec laquelle il peut vivre. La justice devrait aider les coupables vers cette compréhension, vers l’empathie.
Votre court-métrage s’appelait « Une sœur ». Est-ce que la sœur, ça ne serait pas la policière qui reçoit l’appel et se soucie de la victime même des années après ?
Oui. Quitter la nuit est traversé par la sororité. Il parle de la façon dont les femmes doivent bricoler leur réparation entre elles. Mais pour moi, la sororité est un pansement mais pas une solution, en attendant que les hommes prennent leur part dans ces changements. D’ici là, les femmes doivent se réparer entre elles.

Même si votre film fait un état des lieux glacial de la justice, est-il permis d’avoir foi en cette dernière et croire en l’avenir ?
Des institutions aussi anciennes que la justice nous donnent l’impression que ça ne pourra jamais être différent. Mais s’autoriser à penser que ça pourrait être différent, c’est déjà un grand pas.
Quitter la nuit, un film de Delphine Girard avec Selma Alaoui, Veerle Baetens, Guillaume Duhesme, Gringe et Anne Dorval. En salles le 10 avril 2024.
Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.





![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/05/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-05-22t164945311-768x432.jpg?resize=300,350&key=638f1da8)


![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-28t150710132-768x432.jpg?resize=300,350&key=0dbf06ef)

![[Image de une] Horizontale (26) [Image de une] Horizontale (26)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/image-de-une-horizontale-26-768x432.jpg?resize=300,350&key=3f4065eb)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-15t163147788-768x432.jpg?resize=300,350&key=c0e2a724)
![[Image de une] Horizontale (24) [Image de une] Horizontale (24)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/image-de-une-horizontale-24-768x432.jpg?resize=300,350&key=bd0cfdc3)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-16t173042478-768x432.jpg?resize=300,350&key=e6ae1102)









![Copie de [Image de une] Horizontale (84) Copie de [Image de une] Horizontale (84)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/12/copie-de-image-de-une-horizontale-84-768x432.jpg?resize=300,350&key=30319f9e)



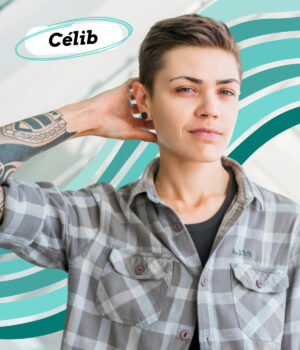







Les Commentaires