Article publié le 17 avril 2015
Manger, c’est quelque chose que l’on fait tous les jours, un peu tout le temps, un peu partout : c’est quelque chose qui peut paraître anodin, et qui est pourtant loin de l’être !
Manger, c’est un acte biologique, mais aussi culturel, psychologique, social…
Un acte qui mobilise plusieurs sens
Lorsque l’on se nourrit, l’acte de manger sollicite plusieurs sens : le goût naît des voies gustatives, olfactives, visuelles, auditives, tactiles.
Nous voyons la couleur des aliments, leur forme, leur organisation dans notre assiette, nous sentons les parfums des plats, nous entendons les trucs qui craquent, qui croustillent, notre bouche sent la consistance des produits, leurs saveurs…
Tout cela, ça crée une « image sensorielle » dans notre cerveau – et chaque aliment, chaque plat a son image sensorielle propre !

Cela signifie aussi que les aliments sont liés à ce que nous avons « vécu » avec eux. Nous associons à la nourriture des sensations, des souvenirs, des personnes, des moments… En somme, nous aurions toutes et tous des madeleines de Proust !
Comment se forment nos goûts alimentaires ?
Vous avez déjà remarqué comme les repas diffèrent d’une famille à l’autre ? Avez-vous déjà été effaré•es par les choix alimentaires de votre partenaire ou de vos potes ?
Je ne veux pas balancer, mais de mon côté, j’ai connu quelqu’un qui mettait du ketchup dans des pâtes à la carbonara (DU KETCHUP !).
Nos goûts se forment de façon très complexe, et sur ce point précis, nous sommes toutes et tous très différent•es.

À la naissance, la plupart d’entre nous ont des comportements adaptés à notre corps. Les nourrissons consomment ce dont ils ont besoin et, a priori, ils ajustent leurs prises alimentaires à leurs sensations de faim et de satiété.
Cette histoire de sensations est essentielle : cela pourrait couler de source, mais une bonne partie des adultes a des difficultés à « écouter » ces sensations !
À lire aussi : J’ai testé pour vous : avoir des troubles du comportement alimentaire
Ensuite, dans la petite enfance, autour de deux ans, les enfants savent reconnaître les aliments « nourrissants », ceux qui calmeront leur sensation de faim immédiatement.
Ce serait pour cette raison que les bambins préfèreraient les féculents (d’autant plus s’ils sont gras) à des choses moins nourrissantes (je vous le donne en mille : les légumes).
Ainsi, jusqu’à l’adolescence, nous aurions une tendance générale à bien kiffer le gras, le sucré, le doux… puis, progressivement, nous adoptons de nouvelles choses, les légumes commencent à être appréciés (mais bon, moins que le reste, quoi).

Ces premiers constats sont des tendances générales, qui reposent sur des statistiques, mais en fait, tous les gens sont très différents face à la nourriture.
Nous sommes même différent•es d’un point de vue « physiologique » : vous vous souvenez de l’histoire de la robe bleue et noire que certain•es voient blanche et dorée ?
Pour les aliments, c’est la même histoire : nous avons tous et toutes des sensations différentes, parce que nos « cellules » olfactives et gustatives sont différentes.
Du coup, nous ne percevons pas les aliments de la même manière, nous avons des sensibilités différentes.
Pour certain•es, l’odeur du chou-fleur est insurmontable, pour d’autres, elle n’est pas si forte que ça.
Cette première observation explique les choses de façon « physiologique », « biologique », mais notre goût est influencé par bien d’autres facteurs : par notre entourage, notre culture, l’endroit où l’on vit, notre psychisme…
La néophobie : la crainte de goûter
Selon un article de Gérard Apfeldorfer, les ¾ des enfants entre 2 et 10 ans refuseraient catégoriquement de goûter des aliments qu’ils ne connaissent pas.
Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais moi, du haut de ma presque trentaine, je suis toujours très peu enchantée à l’idée de goûter un nouvel aliment (on sait jamais, des fois qu’il m’empoisonne).

En fait, ce phénomène a un nom et toucherait un paquet de monde : c’est la « néophobie », la peur d’avaler un aliment inconnu, de flanquer à l’intérieur de nos corps un truc qu’on ne connaît pas.
Pourquoi ? Parce qu’on ne connaît pas son goût, parce qu’on craint de ne pas aimer, parce qu’il nous dégoûte, parce qu’il pourrait ne pas être « bon » pour nous (et donc nous empoisonner)…
La néophobie est surtout présente chez les enfants, mais pas seulement.
Pour dépasser cette crainte, les psychologues conseillent de passer par la « familiarisation » : augmenter le nombre de contacts entre l’enfant (ou l’ado, ou l’adulte) et l’aliment maudit avant de le présenter dans l’assiette.
Ensuite, Gérard Apfeldorfer souligne que plus on consomme un produit, plus le plaisir pour ce produit augmente (c’est « l’effet positif de l’exposition »).
La psychologue Leann Birch a étudié le lien entre le contexte affectif et l’appréciation de la nourriture : elle a observé des enfants âgés de 3 à 5 ans chaque jour, pendant six semaines, et a constaté que les aliments mangés dans un contexte chaleureux, ou présentés comme des récompenses, étaient significativement plus appréciés que les autres.
Autrement dit, la présence de notre entourage, ou la manière de présenter les aliments, pourraient favoriser le développement d’un lien affectif avec la nourriture (et pourrait donc nous filer un coup de pouce pour l’apprécier).
Rino, adorable petite fille japonaise, goûte plein de trucs dans une chaîne YouTube devenue célèbre.
L’influence de la culture
La psychologue Estelle Masson rappelle que chaque culture entretient un rapport particulier à l’alimentation : nous sommes influencé•e•s par le pays où l’on grandit, par les origines de nos parents…
Ma mère a des origines italiennes, par exemple, et pour elle, un plat de pâtes, c’est le truc de base. En revanche, mon père et ses racines malgaches préfèrent un plat à base de riz !
À lire aussi : « BrunchCity », le tour du monde de la bouffe en photos
Une recherche lancée par l’OCHA (« alimentation-corps-santé : une approche transculturelle ») a analysé les spécificités du rapport à l’alimentation dans cinq pays européen (France, Suisse, Italie, Royaume-Uni, Allemagne) et aux États-Unis.
Pendant deux ans, les chercheuses et chercheurs ont interrogé plus de 7 000 personnes.
Cette étude note que dans l’ensemble des pays, lorsque l’on demande aux gens ce que signifie « bien manger », ils évoquent souvent un lien entre l’alimentation et la santé, mais c’est pour les habitant•e•s des États-Unis que ce lien est le plus prégnant.
Il y aurait même une sorte de « subordination » de l’alimentation à la santé : on mange ce que l’on mange d’abord pour être en bonne santé !

Pour les ressortissants italiens, « bien manger », cela veut dire consommer des produits de qualité, et pour les individus français, cette notion est caractérisée par l’idée de partager un repas.
Dans les pays européens, la santé est une conséquence heureuse, mais aux États-Unis, « bien manger », c’est faire les bons choix nutritionnels.
En fait, dans une société, ce qu’on prépare et ce qu’on mange peuvent être un code, un moyen d’exprimer une identité, des relations…
La cuisine est influencée par la culture parce qu’elle rassemble des pratiques, des règles, des normes, des représentations. La nourriture est chargée de symboles !
La nourriture émotionnelle
Nous avons causé biologie, développement du goût, nous avons dit que ce que l’on mange pouvait avoir une origine et une portée sociale.
Figurez-vous que la nourriture peut également être influencée par ce qu’il se passe dans nos têtes : par la psychologie ! Pour le professeur de psychologie Michael Macht, l’acte de manger et l’équilibre émotionnel seraient étroitement liés.
Les émotions auraient un rôle dans nos comportements alimentaires. Parfois, nous mangeons pour nous « remplir », pour nous réconforter, pour diminuer notre stress, pour célébrer une heureuse nouvelle…

Selon plusieurs études, nous mangerions de plus grandes quantités dans les situations de crise. Par exemple, les étudiantes et étudiants mangeraient davantage avant leurs examens, sans avoir de troubles alimentaires spécifiques.
Manger plus pour diminuer des émotions négatives serait un comportement « commun ».
Lors d’une expérience, des chercheur•ses ont montré à des volontaires une vidéo dans laquelle un garçon apprend le décès de son père.
Après cette diffusion, les spectateurs sont attristés… mais ils se sentent mieux si on leur donne un morceau de chocolat (à condition qu’ils jugent le chocolat spécialement bon : je veux dire, si votre truc, c’est les Kinder Bueno et qu’un chercheur vous file un morceau de saucisson, l’effet ne va pas fonctionner).
En fait, le plaisir immédiat et l’émotion suscitée par le morceau de chocolat vont apaiser la tristesse.

Pour certaines personnes, ce mécanisme peut être trop souvent utilisé, et devenir une source d’inquiétude ; les thérapeutes conseillent dans ce cas d’essayer de réguler ses émotions par ses propres moyens, sans utiliser la nourriture, et de tenter de manger « en pleine conscience ».
À lire aussi : Le non-régime de l’été : et si vous écoutiez vos sensations alimentaires ?
En fin de compte, ce qu’il est essentiel de retenir, c’est que la nourriture, est un sujet particulièrement complexe, qui touche à peu près tous les aspects de nos vies : nos identités, nos cultures, nos relations, nos sociétés, notre santé…
Lorsque l’on parle de cuisine, il est rare que l’on parle essentiellement de se nourrir !
Lorsque vous pensez à la sauce tomate de votre mère, ou aux pancakes de l’un de vos proches, il est possible que vous pensiez en même temps à des moments que vous avez vécu ensemble, à vos origines, à vos sensations…
Pour aller plus loin :
- Un article de Gérard Apfeldorfer pour le site du G.R.O.S.
- Une conférence de la chercheuse Nathalie Rigal
- Bien manger : trois principes d’un pays à l’autre – par Estelle Masson
- Un article de Cerveau et Psycho à propos de la nourriture émotionnelle
À lire aussi : Le sexe et la nourriture ne font pas bon ménage, arrêtons de nous mentir
Et si le film que vous alliez voir ce soir était une bouse ? Chaque semaine, Kalindi Ramphul vous offre son avis sur LE film à voir (ou pas) dans l’émission Le seul avis qui compte.






![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-12T121853.563 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-12T121853.563](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-12t121853563-768x432.jpg?resize=300,350&key=23d9309e)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-05T162351.452 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-05T162351.452](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-05t162351452-768x432.jpg?resize=300,350&key=e78566c8)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-14T100237.364 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-14T100237.364](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-14t100237364-768x432.jpg?resize=300,350&key=e4d9aa30)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-30T001240.377 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-30T001240.377](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/09/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-09-30t001240377-768x432.jpg?resize=300,350&key=b290e944)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-19T120824.592 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-19T120824.592](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/09/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-09-19t120824592-768x432.jpg?resize=300,350&key=36cd3f56)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-13T102036.454 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-13T102036.454](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/09/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-09-13t102036454-768x432.jpg?resize=300,350&key=6c0a06de)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-09T103006.910 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-09T103006.910](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/09/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-09-09t103006910-768x432.jpg?resize=300,350&key=c4ed828b)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-08-28T102135.129 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-08-28T102135.129](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/08/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-08-28t102135129-768x432.jpg?resize=300,350&key=9e48fce4)






![Copie de [Image de une] Horizontale (84) Copie de [Image de une] Horizontale (84)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/12/copie-de-image-de-une-horizontale-84-768x432.jpg?resize=300,350&key=30319f9e)


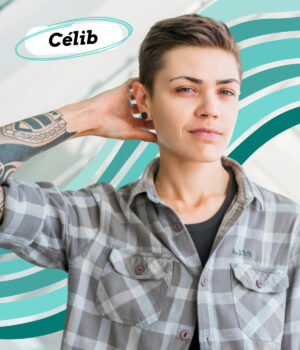




![[Image de une] Horizontale (27) [Image de une] Horizontale (27)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/image-de-une-horizontale-27-768x432.jpg?resize=300,350&key=19a71e0d)
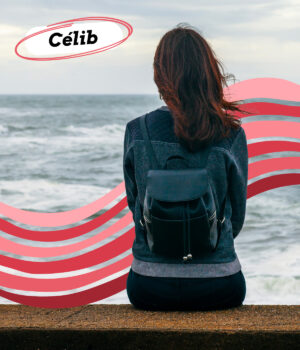
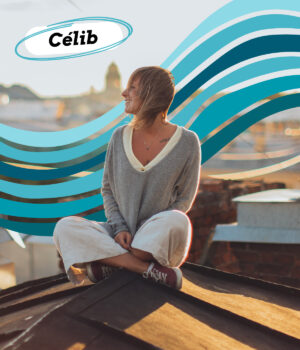




Les Commentaires