Nedjma est un roman de Kateb Yacine, publié en 1956. Connoté un peu difficile d’accès, il a d’ailleurs été au programme du concours de l’ENS il y a quelques années. Pas de quoi se laisser avoir par une sombre histoire de khâgneux, ce livre est en réalité plus facile d’accès qu’il n’y parait. Quelques pistes pour t’en donner envie, mais aussi pour le décrypter.
Au-delà de la colonisation
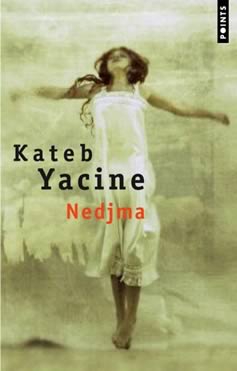
Une histoire d’identité
Nedjma compte plusieurs protagonistes, mais l’intrigue tourne principalement autour de 5 personnes : Mustapha, Lakhdar, Mourad, Rachid, et Nedjma. Les quatre hommes vont, au fil du roman, découvrir qu’ils sont liés par leur origine : ils sont tous descendants d’une tribu algérienne ancestrale : les Kebloutis. Nedjma, elle, est la femme dont ils sont tous amoureux. Elle aussi descendante de Keblout (chef de la tribu), elle représente finalement le délicat passage entre une Algérie « ancienne » et l’Algérie colonisée : elle est née de la liaison d’un Keblout et d’une Française. Figure absolue du désir pour les personnages, elle n’en reste pas moins insaisissable : elle est mariée. Toute l’ambivalence des personnage se comprend dans le comportement qu’ils ont avec Nedjma : même s’ils la désirent (l’un d’eux va l’observer longuement lorsqu’elle prend son bain en pleine nature), ils ne peuvent l’approcher pour autant (elle est déjà « salie » par le mariage et par le sexe d’un autre homme). Leur identité est également mise en cause : leur tribu ancestrale, au temps du récit, est pratiquement éteinte, d’autant plus que l’Algérie est en plein mouvement. En se raccrochant à Nedjma, le symbole même de cette identité qui s’étiole, ils essayent de se comprendre eux-mêmes. De même, les personnages sont tous plus ou moins des vagabonds : la marche est un élément très important dans le récit de Kateb Yacine. En choisissant des vagabonds, il montre la crise identitaire que peut traverser son peuple. Nedjma, en arabe, signifie l’étoile. Ses cinq branches sont finalement les 5 personnages, à la fois réunis et profondément éloignés.
Un roman poétique
L’écriture du roman mérite elle aussi un peu d’attention : loin d’être exclusivement narrative, elle reprend quelques éléments poétiques. On remarque des éléments du modèle pastoral (histoire de berger, la nature, la campagne et tout ça) : l’un des personnages, enfant, doit s’occuper de chèvres (et l’une meurt). Un autre va, lui, jouer du tambour et danser : ceci peut se rallier à une certaine tradition poétique de la pastorale, qui trouve ses racines chez les Grecs, parlant de la vie des champs et des mœurs des bergers. Cette poésie servait également à montrer la réalité des champs par rapport à celle de la ville, ce qui peut se comprendre, dans
Nedjma, comme la réalité de l’Algérie agricole, ancienne, par rapport à l’Algérie colonisée par une France moderne.
L’écriture va quelques fois paraître très saccadée, avec des retours à la ligne fréquents durant des pages entières, à la manière des vers en poésie. De même, il n’y a pas vraiment de continuité logique entre les chapitres, c’est au lecteur de faire les raccordements entre les divers passages afin de reconstituer la trame de l’histoire. A l’image d’une longue poésie, Nedjma décompose la logique pour créer une logique interne au roman : celle de l’écriture, de la musicalité.
Nedjma, c’est à la fois un roman issu d’un contexte historique fort, un certain témoignage d’une nation qui se cherche, mais aussi l’exercice de style d’un écrivain qui tente d’allier une langue et une culture qui sont très différentes. Par ce biais, il réinvente une certaine mythologie Algérienne grâce à la tribu Keblouti et la figure de l’étoile, symboles qui se retrouveront dans d’autres œuvres de l’auteur. Je vous conseille donc vivement cet ouvrage qui, au départ, peut être paraître un peu long à lire, mais qui offre au bout du compte de très nombreuses pistes de réflexion.
Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.


![Copie de [Image de une] Horizontale (69) Copie de [Image de une] Horizontale (69)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/12/copie-de-image-de-une-horizontale-69-300x300.jpg?resize=135,187&key=d05a400b)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-01-19T153547.462 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-01-19T153547.462](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/01/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-01-19t153547462-300x300.jpg?resize=135,187&key=9348059f)


![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/05/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-05-22t164945311-768x432.jpg?resize=300,350&key=638f1da8)


![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-28t150710132-768x432.jpg?resize=300,350&key=0dbf06ef)

![[Image de une] Horizontale (26) [Image de une] Horizontale (26)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/image-de-une-horizontale-26-768x432.jpg?resize=300,350&key=3f4065eb)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-15t163147788-768x432.jpg?resize=300,350&key=c0e2a724)
![[Image de une] Horizontale (24) [Image de une] Horizontale (24)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/image-de-une-horizontale-24-768x432.jpg?resize=300,350&key=bd0cfdc3)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-16t173042478-768x432.jpg?resize=300,350&key=e6ae1102)









![Copie de [Image de une] Horizontale (84) Copie de [Image de une] Horizontale (84)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/12/copie-de-image-de-une-horizontale-84-768x432.jpg?resize=300,350&key=30319f9e)



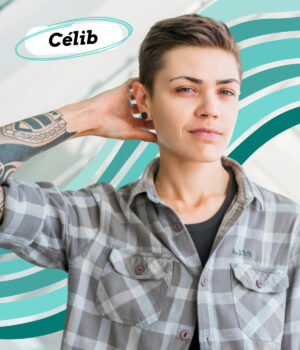







Les Commentaires