Esther est partie recueillir les témoignages des jeunes femmes de plusieurs pays à travers le monde, avec une attention particulière portée aux droits sexuels et reproductifs : liberté sexuelle, contraception, avortement.
Elle a déjà rendu compte de ses rencontres avec des Sénégalaises, puis avec des Libanaises, elle a aussi suivi les débats sur l’avortement en Irlande et en Argentine. Sa cinquième étape l’a menée au Chili !
Retrouve le sommaire des reportages, interviews et autres articles qu’elle y a réalisés ici !
Tu peux suivre au jour le jour ses pérégrinations sur les comptes Instagram @madmoizelledotcom et @meunieresther, avant de les retrouver ici bientôt !
- Précédemment : Celeste et Marina, lycéennes chiliennes qui assurent la relève – Celles qui luttent 3/4
Christina Andrea Vergara Maldonado fait des études pour devenir ingénieure du son. Mais ce qui l’occupe activement ces dernière semaines, c’est avant tout la défense de ses idéaux féministes au sein de sa faculté.
Elle veut devenir ingénieure du son. Et même lorsqu’elle ne fait qu’expliquer ça, on comprend vite son envie de changer le monde.
« Il y a un énorme taux d’abandon chez les femmes. Dans ma filière en ce moment, sur près de 300 étudiants, on est seulement 8 femmes. »
Elle a la passion chevillée au corps et rêve de pouvoir lier les maths à la musique, ainsi que ses compétences artistiques, techniques et humaines en pratiquant ce métier. Mais malgré ça, elle aussi a failli laisser tomber.
« C’est un milieu extrêmement machiste. Mais au moment où j’ai hésité à changer de plan de carrière, je me suis dit que rien ne changerait si on faisait toutes pareil. »
Alors elle est là, fidèle au poste. Et ces dernières semaines, au-delà du milieu de l’ingénierie du son, elle a entrepris de changer la société dans son ensemble avec ses camarades féministes.
La mobilisation féministe chilienne actuelle n’a pas éclos en un jour
Bien sûr, l’histoire n’est pas aussi simple. On ne se lève pas un matin en décidant qu’on va changer le monde avec ses potes. Pour Christina, l’engagement féministe remonte en réalité à 2016.
« Et avant ça, je pense que mon premier combat a été mon coming-out, parce que je suis lesbienne. Même si ma famille l’a bien accepté, ce n’a pas été le cas de celle de ma copine.
C’était une première introduction au fait de se battre contre le système patriarcal on va dire, car ça relève des mêmes mécanismes de domination. »
Elle m’explique avoir tissé les liens entre les différents abus et discriminations qu’elle a pu subir pour arriver au constat que cela émanait globalement du système patriarcal.
« Le féminisme n’est pas seulement un mouvement social et politique, il est aussi lié à l’histoire de chacune d’entre nous Il naît de nos expériences.
Moi, ce sont des épreuves personnelles qui m’y ont amenée : je suis une survivante d’abus sexuels perpétrés dans mon enfance, et j’ai compris que ce n’était pas des choses qui n’étaient arrivées qu’à moi mais qu’elles découlaient au contraire d’un système patriarcal qui fait d’innombrables victimes. »
Après le temps de la réflexion, le temps de l’action
D’où la conversion de son engagement en actes.
« Quand j’ai pris conscience de ce qu’était le patriarcat, c’est comme si j’avais enfilé une nouvelle paire de lunettes qui faisait que je ne voyais plus le monde de la même manière. J’ai commencé à m’indigner, et l’action suit l’indignation. »
Elle a rejoint en 2013, quasiment à sa création, le collectif « Las Tortas de Bello » – un nom qui vise à se réapproprier le mot « tortas » (l’équivalent de « gouine ») pour contrer sa connotation péjorative et qui fait référence au fondateur de son université, Andrés Bello.
« En parallèle, un Bureau de l’égalité et du genre a été créé en 2014 au sein de l’université, par les étudiant·es, pour les étudiant·es. »
Comme dans beaucoup d’autres universités, ces organisations étudiantes ont été créées pour palier au défaut de réflexion et d’action sur les problématiques de genre de l’institution.
« J’ai commencé à m’intéresser vraiment au féminisme, et en même temps je me suis investie dans ce bureau du genre. »
Le but de ces organisations est de visibiliser les violences de genre, de créer des espaces pour les victimes.
Des négociations pour une éducation non-sexiste
Christina me décrit le processus qui a conduit à la mobilisation actuelle dans sa faculté de musique.
« Quand la mobilisation a commencé cette année il y a eu une effervescence, d’abord avec les blocus de la faculté de droit ou de l’école d’affaires publiques. Mais pas dans notre faculté.
Donc on a commencé à s’organiser de manière horizontale avec mes camarades du cursus d’arts : on décide de tout via des assemblées. J’étais la seule qui avait fait partie du bureau de genre et aussi la plus vieille. Du coup quand il a fallu choisir des représentantes, j’ai été désignée. »
Elle fait donc partie des comités qui ont négocié avec la direction de la faculté et avec le recteur de l’université au sujet de leurs revendications.
« On a commencé à réfléchir immédiatement à comment nous nous sentions en tant que femmes dans notre environnement. On a fait le compte des discriminations.
On a peu de professeures, on n’a pas de modèles féminins. On nous dit que c’est un travail d’hommes parce qu’il faut être fort. On nous demande de travailler littéralement deux fois plus que les hommes.
Ce sont des situations auxquelles j’ai été moi-même régulièrement confrontée. Par exemple j’ai un jour eu une mauvaise note parce que je n’étais « pas assez forte physiquement » et qu’il fallait que je « me muscle deux fois plus que les hommes » pour faire ce métier. Mais l’exercice ne consistait pas du tout à évaluer ma force ! C’était du pur sexisme. »
De là a découlé l’écriture de cahiers de doléances, base des négociations :
« On avait des assemblées au niveau de la faculté, des campus, et de l’université. À chacun de ces niveaux de responsabilité on a établi la liste de nos revendications. »
Négociations après négociations, une victoire se dessine
Au sein de l’Université du Chili, elles ont obtenu la révision des programmes pour inclure des femmes, la formation des profs aux thématiques du genre, la création d’un bureau du genre chargé de lutter contre les violences et discriminations, la révision du protocole de dénonciation en cas de violences sexuelles, la possibilité de changer de nom pour les personnes trans, la prise en compte des besoins spécifiques des étudiant·es devant aussi assumer un rôle de parents… et tant d’autres choses.
Pour elle, tout ceci représente un changement « potentiellement historique ».
« Bien sûr, comme dans tous les changements, il y a de la résistance. Mais je trouve tout de même que ça a déjà produit des effets.
Je viens d’un petit village où l’ouverture d’esprit n’est pas la même que dans les grandes villes. Je pensais qu’en y retournant j’allais me heurter de front au machisme, mais finalement mon père, par exemple, a engagé la discussion tranquillement.
Il m’a demandé ce que je pensais de la mobilisation étudiante. Donc je lui ai expliqué que j’étais assez investie et j’ai commencé à lui raconter les discriminations que je subissais au quotidien. Je ne lui en avais jamais parlé.
Et même dans la rue les gens réagissent bien ! »
L’impératif de diffuser les idéaux féministes au-delà de la sphère universitaire
Elle garde cependant en tête que même si les idées se diffusent, cette « marée » féministe reste un mouvement étudiant, ce qui comporte quelques inconvénients.
« Nous sommes des privilégiées. Toutes les femmes n’ont pas accès à l’université. Or la première cause qui me tient à cœur c’est notre devoir d’éducation : éduquer d’autres gens à propos du patriarcat, du féminisme. C’est de là qu’il faut partir : avoir une éducation non-sexiste dès le début.
Ce mouvement a démarré dans les universités, mais la fin en soi c’est de pouvoir marcher dans la rue sans avoir peur. »
- Sommaire : les reportages de madmoiZelle au Chili
Et si le film que vous alliez voir ce soir était une bouse ? Chaque semaine, Kalindi Ramphul vous offre son avis sur LE film à voir (ou pas) dans l’émission Le seul avis qui compte.







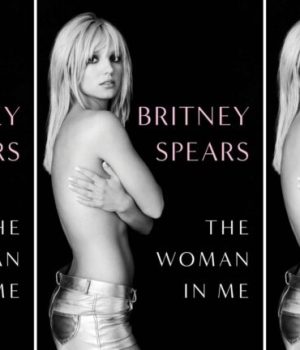











![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-12T103045.066 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-12T103045.066](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/12/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-12-12t103045066-768x432.jpg?resize=300,350&key=93ef36ef)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-10T145633.472 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-10T145633.472](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/12/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-12-10t145633472-768x432.jpg?resize=300,350&key=2403676d)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-25T111624.319 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-25T111624.319](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-25t111624319-768x432.jpg?resize=300,350&key=d78cc3b4)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-28t150710132-768x432.jpg?resize=300,350&key=0dbf06ef)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-20T111708.991 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-20T111708.991](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-20t111708991-768x432.jpg?resize=300,350&key=a2a91e2d)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-15t163147788-768x432.jpg?resize=300,350&key=c0e2a724)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-13T154058.525 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-13T154058.525](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-13t154058525-768x432.jpg?resize=300,350&key=5e3885bf)
![[Image de une] Horizontale (24) [Image de une] Horizontale (24)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/image-de-une-horizontale-24-768x432.jpg?resize=300,350&key=bd0cfdc3)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T170053.120 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T170053.120](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-30t170053120-768x432.jpg?resize=300,350&key=9979862d)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T164414.844 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T164414.844](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-30t164414844-768x432.jpg?resize=300,350&key=f42d86d3)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T115104.723 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T115104.723](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-30t115104723-768x432.jpg?resize=300,350&key=351be990)





Les Commentaires