Prof agrégée de lettres, normalienne, mère, c’est à partir de toutes les composantes de son identité que Yuna Visentin a voulu écrire Une autre école est possible !, paru chez Leduc en août dernier. Elle y décrypte comment l’institution peut et doit revoir sa copie en matière de lutte contre les inégalités et les discriminations.
Mais loin de n’émettre que des critiques, elle propose aussi de comprendre l’origine de ces méthodes et tend à trouver des solutions pour repenser une éducation plus respectueuse et plus émancipatrice.
Une école qui « fait sortir les inégalités de la salle de classe »
Madmoizelle. L’Éducation nationale est une vitrine des principes républicains mais dans « Une autre école est possible ! », vous pointez pourtant une forte contradiction : elle reproduit des schémas oppressifs. D’où vient ce constat ?
Yuna Visentin. Il y a tout un discours qui présente l’école comme le lieu de l’apprentissage de l’esprit critique, de l’émancipation ; mais ce discours se heurte à la réalité de l’école, aux discriminations sexistes, racistes, classistes, validistes reproduites par l’institution, voire légitimées par elle.
À l’école, on transmet l’idée que le personnel éducatif est censé être neutre, mais aussi qu’il faudrait éveiller les élèves à cette neutralité, les aider à sortir de leurs différentes identités, de leurs histoires respectives, de leurs situations sociales, pour les “élever” vers une neutralité présentée comme un idéal à atteindre. Comme des pédagogues anti-oppressifs l’ont déjà souligné — je pense notamment à Célestin Freinet, Paulo Freire, mais aussi au travail de bell hooks — la neutralité est un principe qui sert à faire sortir les inégalités de la salle de classe, et donc à les invisibiliser. Or les inégalités, qu’elles soient de genre, de « race », de classe, etc. restent effectives, même si on n’en parle pas.
Pour mieux le comprendre, je pense qu’il faut rappeler l’Histoire de l’école, dont on nous parle finalement très peu. L’Éducation nationale n’a jamais été une institution émancipatrice pour les minorités. Prenons le cas de Jules Ferry, auquel on doit les lois pour l’instauration d’une école publique, gratuite, laïque et obligatoire à la fin du 19e siècle — bien entendu, il n’est aucunement question de revenir sur la nécessité d’une école gratuite.
Jules Ferry a été un farouche partisan de la colonisation, il a également joué un rôle dans la répression de la Commune, et il voyait l’école comme un moyen d’adoucir l’esprit de la classe populaire. Il faut se rappeler que l’école instituée à la fin du 19e, et cela jusqu’aux années 60, est une école non mixte, qui assigne les enfants selon une conception binaire et hiérarchique du genre.
Tout cela pour dire qu’il y a une contradiction entre la « vitrine » de l’école et son Histoire, ses pratiques réelles. Tant qu’on n’abordera pas de front les constructions oppressives de l’institution scolaire, on ne pourra pas avoir une école réellement émancipatrice.
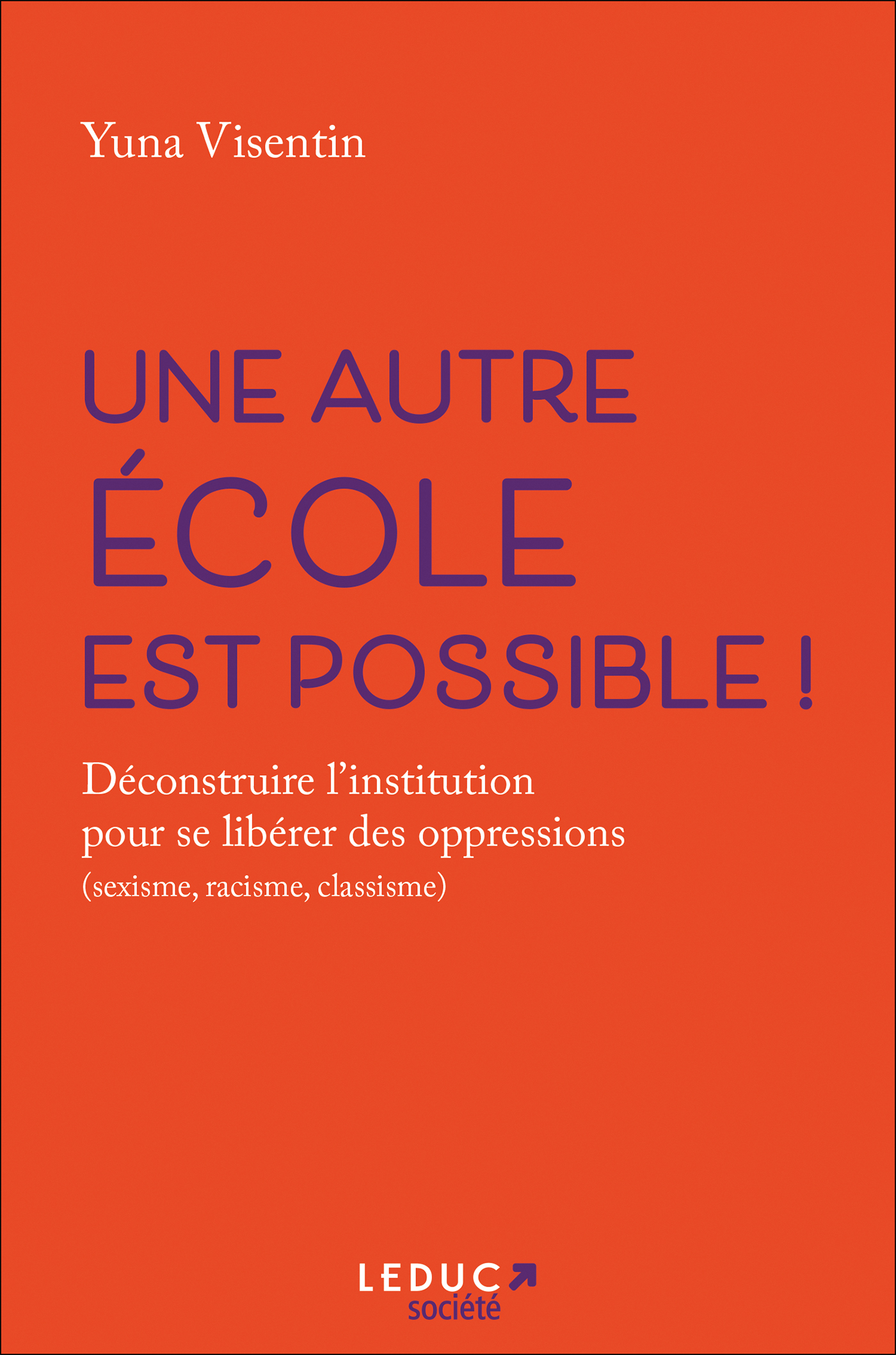
Il y a un discours qui présente l’école avant tout comme le lieu de l’apprentissage d’un savoir commun, des maths, de l’orthographe, etc., et que ces histoires de sensibilisation au respect des différences, n’ont pas à être prioritaires. Que répondre à cela ?
Pour moi, ça devrait être ça l’objectif de l’école : conscientiser ensemble les rapports sociaux afin d’augmenter notre puissance d’action et de révolte, et nous donner la confiance nécessaire pour changer le monde. Et on ne peut pas dire que ça, ce soit un programme au rabais.
Je pense que ce discours, ainsi que celui sur la prétendue baisse de niveau, sert souvent une idéologie réactionnaire assez facile à déconstruire. Prenons l’exemple de l’orthographe. Dans Le français est à nous ! Petit manuel d’émancipation linguistique, les chercheuses Maria Candea et Laélia Véron détricotent l’idée que la langue française serait « en péril », en montrant qu’elle a toujours évolué, que l’orthographe et la grammaire ne se sont rigidifiées que récemment, que l’orthographe hyper complexe du français est bien souvent arbitraire et pas étymologique… Autrement dit que la langue française n’a jamais été figée, qu’elle a autant un passé qu’un futur à construire ensemble, et que sa force vient de sa malléabilité et de sa capacité à se renouveler. C’est pourquoi, les discours protectionnistes sur la langue, l’obsession du niveau qui « baisse » à l’école, l’importance mise sur les fautes, servent une logique protectionniste qui fait de l’orthographe un outil de distinction sociale.
Pour moi, on devrait viser des cultures exigeantes, oui, mais émancipatrices. Des cultures qui ne servent pas à justifier les hiérarchies sociales, qui ne produisent pas de l’insécurité linguistique, qui ne visent pas à adapter les élèves à l’ordre social, à l’employabilité, à l’entreprise.

Pourquoi avoir écrit un essai à la première personne ?
C’était totalement inhérent au projet du livre, c’est même une des raisons pour lesquelles je l’ai écrit. Je voulais sortir de la posture de l’enseignante, de la neutralité qu’on peut montrer aux élèves. Le livre commence par le récit d’un débat en classe sur les stéréotypes de genre qui a été un vrai fiasco pédagogique et un moment difficile, mais qui m’a permis de voir à quel point on parle toustes depuis notre propre socialisation.
On incarne toustes des postures sociales, des rôles sociaux, à l’intérieur de dynamiques complexes, au sein desquelles on peut être plus ou moins privilégié ou discriminé. Et au sein de ces dynamiques, personne n’est neutre : ni la personne discriminée, ni celle qui est privilégiée. Dans un débat sur le genre, un homme cisgenre n’est pas plus neutre qu’une femme trans, une personne non-binaire, ou une femme cisgenre.
Sur la question du racisme, il m’importait également de parler de ce qu’on appelle le « privilège blanc », de mettre en avant la norme raciste et blanche pour voir que, au sein d’une société raciste, on est toustes traversées par le racisme. Et tant que ces inégalités restent invisibilisées à l’école, elles seront reproduites.
Vous abordez justement le sujet de l’antiracisme et de l’antisexisme en les liant, pourquoi ?
Lier les luttes antiraciste et antisexiste était pour moi l’un des enjeux majeurs du livre…justement parce que j’ai l’impression que l’école ne le fait pas. Le combat pour l’égalité filles-garçons est visibilisé à l’intérieur de l’institution scolaire, on le retrouve dans le socle commun des connaissances, il y a des référents égalité filles-garçons au collège… C’est nommé. Pour le racisme, c’est totalement différent. Parler de racisme systémique à l’école est très difficile. Or il existe un racisme scolaire, qui s’exprime par des discriminations quotidiennes, une réduction du champ des possibles des jeunes non blancs, la ségrégation des établissements scolaires.
En croisant les discriminations raciales, de genre, et de classe, on peut par ailleurs mettre en évidence les oppressions spécifiques que vivent les femmes perçues comme musulmanes à l’école, l’orientation à la fois genrée et racialisante des jeunes non blanches. Et cela permet aussi de rappeler que les discriminations, d’autant plus à l’école, s’inscrivent dans une dynamique matérielle, économique, de distribution du travail, et donc aussi d’exploitation
Enfin, on se rend compte aussi à quel point l’objectif de l’égalité filles-garçons est insuffisant : non seulement il reste tributaire d’une vision très binaire, qui invisibilise les questions LGBT+, mais il empêche d’interroger les imbrications entre capitalisme, sexisme et racisme.
Un des aspects les plus intéressants du livre est la critique de la méritocratie, pourquoi cet aspect est-il justement si complexe ?
La sociologue Annabelle Alouch en parle très bien : le mythe de la méritocratie structure non seulement l’école, mais la société dans son ensemble. C’est aussi un concept extrêmement flou : ça veut dire quoi, dire à quelqu’un « tu le mérites » ? Quelle idée du « travail » met-on derrière ? Qu’est-ce qui est mis en valeur ? Quelle culture ? Quel effort ?
Si c’était vraiment le mérite, et pas la classe sociale, qui permettait d’organiser l’accès aux savoirs et au travail, pourquoi l’école, et la société, sont-elles aussi inégalitaires ? En réalité, il y a mille manières différentes de travailler, mille « cultures », mais seulement certaines sont récompensées et pensées comme « méritantes ». Et le plus complexe, c’est que tout cela reste dans l’ordre de l’implicite.
En tant qu’enseignante, comment échange-t-on avec ses pairs sur ces problématiques ?
Il y a un vrai découragement de nombreux enseignants sur ces questions. En faisant la promotion du livre, je me suis rendue compte de manière concrète à quel point beaucoup d’enseignants souffraient de travailler dans un système oppressif qui ne cesse de verrouiller leur marge de manœuvre.
Face à cela, ce qui me semble essentiel, c’est de penser des solutions et des luttes collectives, à l’intérieur et à l’extérieur de l’institution. Ce sur quoi je veux insister avec ce livre, c’est qu’on ne va pas se sauver par des questions individuelles, il faut de vraies transformations collectives.
À lire aussi : Transidentité à l’école : des progrès restent à faire pour protéger élèves et enseignants trans
Crédit photo : (c) Ayla Saura
Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.



































Les Commentaires
Les profs font au mieux, mais dans le grand schéma des choses, l'école formate des futurs travailleurs qui vont devoir accepter de vivre dans un système oppressif, d'un point de vue économique et humanitaire (discrimination raciale, sexisme, harcèlement...).
Ce n'est pas tant l'apprentissage de la lecture et des maths, c'est la capacité de réflexion qui est neutralisée. Mettre fin au sous-effectif des professeurs signifierait pour les élèves avoir un enseignement de meilleur qualité et ça n'a jamais été l'objectif du gouvernement.
En fait quand on est face à un système qui est usé et fonctionne à peine et qu'il n'y a pas d'argent, cela veut juste dire que le gouvernement ne veut pas mettre de l'argent pour ses propres raisons. Parce que quand ils veulent, ils trouvent l'argent. Donc des gens bénéficient du système actuel tout simplement.
C'est pareil pour la santé, la justice et la culture.