On ne le dira jamais assez : tous les (mauvais) goûts sont dans la nature. Ainsi, il existe autant d’opinions que d’êtres humains, si tant est que ceux-ci aient le courage de les assumer.
La critique croisée de Le Diable, tout le temps
C’est ce qu’ont fait deux membres de la rédaction de madmoiZelle aujourd’hui : après s’être intellectuellement étripées sur les réseaux sociaux, elles ont décidé d’étendre leur querelle cinéphile jusque sur le magazine.
Un débat houleux auquel vous pourrez prendre part dans les commentaires.
Je vais personnellement ouvrir les festivités, puis ma collègue Alix Martineau, qui officie régulièrement dans les colonnes ciné/séries, fera étalage de toute sa mauvaise foi.
Le Diable, tout le temps, un thriller suave et gothique
Pour rappel, Le Diable, tout le temps est un film d’Antonio Campos adapté du roman noir de Donald Ray Pollock qui se déroule à Knockemstiff, en Ohio.
Face à sa femme mourante, un homme désespéré, Willard Russell, tente le tout pour le tout en se dévouant corps et âme à la religion.
Ses prières vont petit à petit s’apparenter à des sacrifices dont Arvin, le fils du couple, fera les frais toute sa vie…
Une mise en scène percutante
En dépit de ce que persiflent les mauvaises langues, Le Diable, tout le temps, produit par un Jake Gyllenhaall qui fait décidément toujours les bons choix (on se rappelle surtout du sublime Les frères Sister ou du brumeux Enemy), a tous les atours du grand thriller.
À ceci près peut-être qu’il n’est pas ostentatoire dans sa mise en scène. Or, l’ostentatoire, le grand-guignolesque, flatte d’ordinaire l’œil de celui qui cherche à être diverti fort et rapidement.
Si vous êtes de ces consommateurs, passez en effet votre chemin, car le très gothique Le Diable, tout le temps trouve son intérêt dans sa langueur suave mais fatale, comme un dernier french kiss avant l’échafaud.
À l’exception de quelques éléments gores (le chien, le tournevis), qui sont davantage les faits de l’auteur que du réalisateur, le film échappe aux effets de manche et se concentre sur l’essentiel : la perversion des personnages.
Le Diable, tout le temps pointe du doigt les tares d’une Amérique passéiste, grâce notamment à, comme le souligne le pointu magazine cinéphile TroisCouleurs, « un ton tragique et crépusculaire qui ne va pas sans rappeler celui de Sang pour sang des frères Coen ».
La caméra s’agite tranquillement de visage en visage, capturant tantôt leur folie pieuse, tantôt la lubricité de ces hommes qui pervertissent le Midwest. Et Dieu sait qu’ils sont nombreux…
Des personnages lugubres à souhait
Dans Le Diable, toute le temps, l’homme est un loup pour l’homme. Tous se haïssent, s’entretuent, ou dissimulent leurs sombres desseins sous de factices carcans de vertu.
Un homme fou d’amour prêt à tout sacrifier pour sauver sa femme d’un cancer, un autre crucifié sur un champ de bataille, un prédicateur meurtrier, un prêtre prédateur sexuel, un assassin libidineux : il n’y en a pas un pour sauver l’autre.
Les femmes, quant à elles, essuient toutes un destin tragique, souvent accéléré par la perversité de ceux qu’elles ont épousés. Elles ne font donc jamais long feu, la faute à leurs infâmes bourreaux.
Dans cette revisite gothique du polar de Donald Ray Pollock qui embrasse les classiques du genre (La nuit du chasseur, Voyage au bout de l’enfer, Sang pour sang, L’Antre de la folie, Galveston), l’ambiance est donc à la masculinité toxique.
Une masculinité terrifiante qui semble tout droit sortie des viscères de Robert Pattinson, Bill Skarsgård et Jason Clarke, dont le seul antagoniste — aux intentions presque louables — revêt le visage d’un Tom Holland aussi juste qu’à l’accoutumée.
Tous ces personnages, ensemble ou séparément, dessinent la mythologie infectée et insidieuse qui parasite les tréfonds du Midwest.
L’intrigue, foyer infectieux de ce thriller brillant
Là où Antonio Campos, réalisateur de l’inquiétant Christine (2016), fait fort sans en faire trop, c’est dans sa manière de raconter l’irracontable.
Le vice est au cœur même de l’intrigue, et il fallait savoir le capturer à sa juste mesure, lui rendre honneur.
Il est (beaucoup) trop rare de voir un film grand public s’attaquer à la religion, véritable démon du Diable, tout le temps, qui souligne les déviances et péchés des hommes les plus pieux qui soient.
Sorte de prêche anti-religieux, Le Diable, tout le temps est de ces films qui doivent glisser d’un téléviseur à l’autre pour alerter sur le possible (et toujours actuel) si ce n’est obscurantisme, au moins archaïsme de l’Eglise.
Sans un être un chef-d’œuvre, sans même être une œuvre dont on se souviendra pendant 10 ans, Le Diable, tout le temps est un film nécessaire, qui pointe du doigt les tares d’une Amérique à laquelle on souhaite des jours plus heureux qu’en 1965.
Je cède désormais ma place à la brillante Alix Martineau, qui fera la contre-voix de cette critique.
Le Diable, tout le temps, 2h30 de votre vie à jamais perdues
Si vous êtes de ceux qui crient au génie au moindre chien en décomposition, ce film est fait pour vous.
Cependant, si vous êtes pourvu d’un esprit critique, vous vous rendrez rapidement compte que Le Diable, tout le temps, sous ses airs de thriller subversif sur la religion, n’est qu’un amas de clichés vus, revus et re-revus qui, quelques minutes seulement après l’avoir terminé, échappera définitivement à votre mémoire.
Et pourtant, Dieu (le fameux) sait que j’attendais son arrivée sur Netflix avec impatience !
Des personnages stéréotypés
Mon attente mal contenue pour Le Diable, tout le temps résidait dans l’annonce de son casting, qui m’a jeté beaucoup de poudre aux yeux.
Robert Pattinson, Tom Holland, Bill Skarsgård, Harry Melling, Mia Wasikowska… La liste s’étirait et mon palpitant n’en pouvait plus de battre, jusqu’à la découverte des personnages qu’ils incarnent.
Manichéisme et ridicule s’invitent à la fête, faisant du Diable, tout le temps un repère de grands vilains évoluant sans miscibilité, et ignorant toute nuance. La religion devient alors la colonne vertébrale branlante de ce rassemblement de scélérats hiératiques du Midwest. Elle se fait grande coupable de tous les maux, qu’elle soit chérie, envoûtante ou inintéressante, et hop ! Elle met tout le monde dans le même sac.
Le sac se divise alors en deux catégories : les femmes, des demoiselles en détresse, et les hommes, aussi dangereux qu’instables.
Le seul protagoniste masculin qui parvient à obtenir les faveurs du spectateur est rendu sympathique par son aversion pour l’opium du peuple et sa quête de vengeance, tandis qu’il faudrait l’absoudre des mêmes péchés qui condamnent les autres personnages. D’une mauvaise foi absolue.
Mais il faut tout de même reconnaître au Diable, tout le temps que sa bande de marauds est jouée sans la moindre fausse note. Un film d’acteurs, en somme !
Une mise en scène dépassée par le projet
Si chaque personnage pouvait prétendre à son propre film, les entasser tous dans le même ne garantit pas une réussite. Le côté choral et multi-générationnel du long-métrage semble dépasser son réalisateur qui propose des allers-retours maladroits dans le temps.
Des aperçus d’intrigues plus alléchants que l’intrigue elle-même, des bafouillages gores, des scènes rejouées… Autant de bavures qui font du film d’Antonio Campos un long fleuve qu’on aurait aimé tranquille, parsemé de moucherons un poil irritants.
Rien de neuf sous le soleil, donc, dans cette adaptation anecdotique et vieille avant l’heure qui reprend des thèmes abordées maintes fois depuis La Nuit du chasseur... en 1956.
Une intrigue qui perd de son élan
La première partie du Diable, tout le temps transporte son audience et promet monts et merveille.
Le pasteur Roy Laferty campé par Harry Melling est intrigant, passionnant, et déchirant tout à la fois. Mais malgré la performance impressionnante de Robert Pattinson en Preston Teagardin, un pasteur pédophile, l’intérêt du film s’arrête ici, au glas de la première heure.
Retenez qu’il en reste encore une et demie !
L’intrigue tombe à plat, tente de se raccrocher aux branches en prétextant créer de l’interaction entre les personnages, en vain. Cette croisade pourtant bien engagée contre le Mal s’avère faiblarde et attendue dans chaque coup porté et dans chaque balle tirée.
Si ce déversement de fiel vous froisse, sachez qu’il traduit seulement ma déception d’avoir failli à l’adoration que j’aurais tant aimé avoir pour ce film. Mais la plume sucrée de ma chère Kalindi, qui surpasse en bien des points mes hyperboles maléfiques, vous encouragera, j’espère, à regarder Le Diable, tout le temps pour en débattre à votre tour dans les commentaires.
À lire aussi : « La Sagesse de la pieuvre », le docu Netflix qui ouvre le débat de la place de l’humain dans la vie sauvage
Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.



![Copie de [Image de une] Horizontale – 2023-12-11T145822.152 Copie de [Image de une] Horizontale – 2023-12-11T145822.152](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/12/copie-de-image-de-une-horizontale-2023-12-11t145822152-300x300.jpg?resize=135,187&key=4fc8f4b5)





![[Image de une] Horizontale (21) [Image de une] Horizontale (21)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/09/image-de-une-horizontale-21-768x432.jpg?resize=300,350&key=136ad388)








![Copie de [Image de une] Horizontale (84) Copie de [Image de une] Horizontale (84)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/12/copie-de-image-de-une-horizontale-84-768x432.jpg?resize=300,350&key=30319f9e)


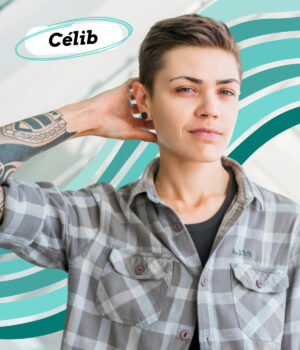




![[Image de une] Horizontale (27) [Image de une] Horizontale (27)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/image-de-une-horizontale-27-768x432.jpg?resize=300,350&key=19a71e0d)
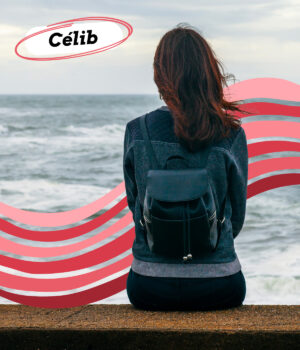
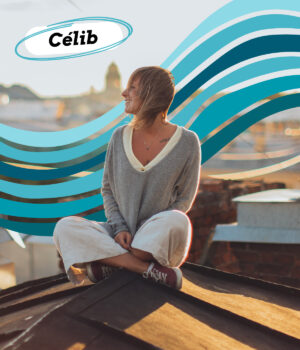




![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-02T111610.619 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-02T111610.619](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/12/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-12-02t111610619-768x432.jpg?resize=300,350&key=d6da8783)

Les Commentaires