« Il n’y a pas de mot pour dire que l’on a perdu un enfant. » J’ai entendu cette phrase pour la première fois de la bouche de Nicole Tercero. Sa fille s’appelle Laurie. Elle a été tuée, dans la nuit du 16 au 17 janvier 2018, par son ex-compagnon. Elle avait 28 ans.
Comme trop souvent, Laurie avait dénoncé les violences aux forces de l’ordre. En vain. Quelques mois après son meurtre, alors que j’enquêtais sur les défaillances judiciaires préalables au passage à l’acte féminicidaire, j’avais pris un train de nuit pour descendre en Aveyron et recueillir le témoignage de Nicole et son mari Charlie. Le couple m’avait conduite chez eux, un pavillon avec vue sur les champs. Après l’interview, on avait déjeuné des spaghettis bolognaise sur leur terrasse. L’air était doux et Nicole avait retiré son pull, dévoilant cette inscription à l’avant-bras : « Laurie mon ange ».
Pendant que je photographiais ce tatouage, elle m’avait parlé de ce terme qui lui manquait cruellement pour se définir : « Je ne suis pas veuve. Je ne suis pas orpheline de mon enfant. »

« Il n’existe pas de mot pour désigner un parent dont l’enfant est mort »
Cinq ans plus tard, je repense souvent à ce moment-là. J’ai eu beau chercher, moi non plus, je n’ai pas encore trouvé. « Personne n’a prévu de mot parce que ce n’est pas dans l’ordre logique de survivre à son enfant », avait remarqué Nicole.
J’ai retrouvé cette réflexion dans un texte de la psychanalyste Laurie Laufer : « Dans la langue française, il n’existe pas de mot pour désigner un parent dont l’enfant est mort », écrit-elle dans On tue une femme, un ouvrage collectif de référence sur les féminicides. « Serait-ce parce que cette réalité est irreprésentable et innommable ? Serait-ce parce que le langage est impuissant à produire les bords signifiants à une inconcevable et indicible souffrance ? »
En Aveyron, avant que je ne reparte en train, Nicole m’avait proposé de visiter la chambre de sa petite-fille orpheline de 6 ans. La pièce était décorée dans des tonalités roses et le lit, envahi par les peluches. Ce qui m’avait sauté aux yeux, c’était le portrait de sa mère défunte, accroché sur le mur à côté de l’oreiller. « Elle s’endort en regardant sa maman », avait murmuré Nicole. À cette époque, le meurtrier n’avait pas encore été jugé. Il avait conservé, depuis sa cellule, ses droits sur l’enfant, et les parents de Laurie devaient faire avec pour gérer des détails pratiques, comme l’inscription de la petite dans sa nouvelle école.
« On pourrait croire que tout s’arrête quand la victime décède. Mais pas pour nous, les proches »

« On pourrait croire que tout s’arrête quand la victime décède. Mais pour nous, les proches, cela ne fait que commencer », scande au fil de ses interventions Sandrine Bouchait, présidente de l’Union nationale des familles de féminicides.
L’hiver dernier, j’ai assisté à un colloque organisé par cette association au Sénat. Cet événement appelait à la création d’un statut pour ces orphelin·e·s, sur un modèle inspiré des pupilles de la nation. En près d’une décennie, de 2011 à 2022, les rapports ministériels de la Délégation aux victimes ont décompté 1 247 orphelin·es, de mère le plus souvent, parfois de père, parfois des deux parents, suite à des crimes perpétrés dans un contexte conjugal. « Il faut prendre en charge ces enfants jusqu’à leur autonomie, sur le plan psychologique, mais aussi en créant des bourses d’études et de l’accompagnement au logement, énumère Sandrine Bouchait. Le but ultime serait que ce statut soit étendu à la famille rapprochée, comme les familles de victimes d’attentats. »
Sur l’estrade du Sénat, elle appelait à la suspension automatique de l’autorité parentale pour les pères inculpés et au retrait définitif en cas de condamnation pour le meurtre d’une mère. Une proposition de loi, portée par la députée Isabelle Santiago, est soumise à la navette parlementaire. Sandrine Bouchait prévient : « On serait agréablement surprises si cela passait parce que les élus sont très frileux à ce sujet. »
À lire aussi : Laurène Daycard : « Comment j’ai commencé à écrire sur les féminicides »
« Le mal ne nous quitte jamais »
Sa sœur, Ghylaine Bouchait, a été brûlée vive le 22 septembre 2017 par son conjoint, alors que leur fille était présente dans l’appartement. Il a été condamné à vingt ans de réclusion criminelle, a perdu ses droits sur l’enfant. « Sur son lit d’hôpital, j’ai promis à ma sœur de prendre soin de sa fille et que ça ne resterait pas impuni », se souvient Sandrine Bouchait, qui a adopté sa nièce. « J’ai tenu ma promesse. » En l’écoutant, j’ai réalisé qu’il n’y avait pas non plus de mot pour dire que l’on a perdu une sœur.
J’ai récemment échangé par téléphone avec Nicole. Elle vit dans la même maison en Aveyron. « Laurie est toujours là », m’a-t-elle aussi expliqué. Je suis restée muette. « Elle est enterrée ici », a repris Nicole.
Sa petite-fille a soufflé ses onze bougies, « une préado », soupire la sexagénaire. Dans sa chambre, me décrit-elle, le rose a fait place à une multitude de posters de chevaux. « Elle rêve de posséder un jour son propre centre équestre. » La photo de sa mère n’a pas bougé, près de l’oreiller.
L’autorité parentale du père a été ôtée par les assises, où il a pris 22 ans. « Mais il n’a pas perdu son droit à nous perturber », s’indigne-t-elle. « Il a tenté de nous joindre par divers intermédiaires et a envoyé une requête au juge. Lui, il bénéficie de l’aide juridictionnelle. Pour nous, un passage au tribunal comme celui-là, c’est mille euros à sortir de notre poche », fulmine-t-elle. Puis enchaîne : « Le deuil, je ne sais pas ce que ça veut dire parce que le mal ne nous quitte jamais. » La douleur se dilue dans le quotidien.
Des images pour remplacer les mots qui manquent
Quand le langage devient une impasse, les images peuvent parfois aider. J’en ai trouvé une, cet été, au détour de l’exposition de la plasticienne colombienne Doris Salcedo, qui travaille sur les violences, à la fondation Beyeler, en Suisse. Elle y a imaginé une installation à partir du récit de femmes dont les fils ont été assassinés dans des conflits armés entre gangs à Chicago.
L’espace était vide, à l’exception de quelques blouses de soie aux murs. En s’approchant, on distinguait un tissu hérissé par des milliers de fines aiguilles. Elles s’enfonceraient dans la chair de quiconque revêtirait la tunique, pour entraver ses mouvements, le temps que la douleur ne dilue son poison anesthésiant.
« Quand Laurie est partie, j’ai d’abord pensé qu’on n’arriverait jamais à vivre sans elle, a glissé Nicole Tercero. Aujourd’hui, c’est l’inverse, je me demande à quoi ressemblerait notre vie si elle était encore là. » Avant de raccrocher, la mère m’a promis de m’écrire si jamais elle découvre ce mot.
Si vous ou quelqu’un que vous connaissez est victime de violences conjugales, ou si vous voulez tout simplement vous informer davantage sur le sujet :
- Le 3919 et le site gouvernemental Arrêtons les violences
- Notre article pratique Mon copain m’a frappée : comment réagir, que faire quand on est victime de violences dans son couple ?
- L’association En avant toute(s) et son tchat d’aide disponible sur Comment on s’aime ?
Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.


![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-20T170330.307 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-20T170330.307](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/09/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-09-20t170330307-768x432.jpg?resize=300,350&key=a0948d55)


![[La Chronique des Absentes] Image de une • Verticale [La Chronique des Absentes] Image de une • Verticale](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/01/la-chronique-des-absentes-image-de-une-verticale-300x350.jpg?key=2e37ecc9)
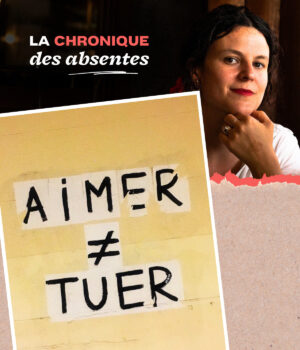
![_[SLPLG] Image de une • Verticale (6) _[SLPLG] Image de une • Verticale (6)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/07/slplg-image-de-une-verticale-6-300x350.jpg?key=94166454)
![_[SLPLG] Image de une • Verticale (5) _[SLPLG] Image de une • Verticale (5)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/06/slplg-image-de-une-verticale-5-300x350.jpg?key=02ef5ee7)
![_[SLPLG] Image de une • Verticale (3) _[SLPLG] Image de une • Verticale (3)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/03/slplg-image-de-une-verticale-3-300x350.jpg?key=015a4fe1)

![_[SLPLG] Image de une • Verticale (2) _[SLPLG] Image de une • Verticale (2)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/01/slplg-image-de-une-verticale-2-300x350.jpg?key=0354d17f)
![_[SLPLG] Image de une • Verticale (1) _[SLPLG] Image de une • Verticale (1)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/01/slplg-image-de-une-verticale-1-300x350.jpg?key=91494dde)





















Les Commentaires