Transidentité : la transidentité est le fait d’avoir une identité de genre différente de celle qui a été assignée à la naissance. Quand on correspond au genre qu’on nous attribué (« tu as un pénis, donc tu es un garçon »), on est cisgenre ; quand on n’y correspond pas, on est transgenre.
Non-binarité : les personnes non-binaires, genderqueer ou encore genderfluid sont celles dont l’identité de genre ne s’inscrit pas dans la norme binaire. C’est-à-dire que ces personnes ne se sentent ni homme, ni femme, mais entre les deux, un mélange des deux, ou aucun des deux.
Dysphorie : Le terme dysphorie, dans son sens premier, peut désigner un trouble psychique, caractérisé par une humeur oscillant entre tristesse et excitation. Il s’agit d’une perturbation de l’humeur, qui est accompagnée d’anxiété, de malaises, et même de réactions coléreuses.
La dysphorie de genre, terme médical spécifique employé dans le manuel de l’association américaine de psychiatrie (DSM-V), décrit la détresse ressentie par une personne transgenre, c’est-à-dire ayant les attributs physiques assignés au genre féminin mais se sentant homme, ou l’inverse. C’est le sentiment d’inadéquation entre le sexe assigné et l’identité de genre qui crée une perturbation. (source)
Mégenrer : utiliser le mauvais pronom pour désigner le genre de quelqu’un (appeler une femme trans « lui » par exemple).
Neuroatypie : la neuroatypie désigne un fonctionnement neurologique ou psychologique qui s’écarte de la norme. Ce terme a été inventé par et pour la communauté autistique, pour les différencier des personnes neurotypiques (donc sans diagnostic d’un trouble de l’autisme). Aujourd’hui le terme neuroatypie englobe aussi les personnes présentant un trouble « dys » (dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, etc.), un déficit de l’attention et/ou une hyperactivité, un Haut Potentiel et d’autres différences neurologiques. Il s’agit d’un terme-parapluie recouvrant plusieurs réalités liées à la santé mentale.
Par respect pour l’identité de genre de Kelsi Phụng, cet article utilise des tournures non-genrées, telles que le pronom « iel ».
Auteurice et réalisateurice non-binaire d’origine vietnamienne, Kelsi Phụng dessine, écrit et met en scène des histoires engagées autour des questions de genres, d’orientations sexuelles marginalisées, de racisme, et de l’Asie du Sud-Est.
Dès la découverte de la bande-annonce de Ni fille ni garçon qui se demande si la non-binarité est un « phénomène de mode ou une révolution », l’artiste d’animation a tiqué. Et à raison : dans cet épisode, l’émission Zone Interdite y mégenre les témoins, dit qu’iels « se sentent » ou « se disent » non-binaires, fait de leur identité un spectacle, une pathologie ou un fait-divers sans dimension politique.
https://twitter.com/ZoneInterdite/status/1347090595525914624
Dimanche 10 janvier 2021, Kelsi Phụng a quand même live-tweeté la diffusion du documentaire sur M6, relevant ses nombreuses incohérences, mais surtout sa violence. Pour madmoiZelle, iel revient sur l’importance d’avoir des personnes concernées derrière la caméra, mais aussi à l’écriture et à la production de plus de projets audiovisuels, afin d’arrêter de traiter la non-binarité comme une nouvelle tendance de développement personnel.
En quoi Zone Interdite : ni fille ni garçon aborde les questions de transidentités avec voyeurisme et sensationnalisme ?
Kelsi Phụng : L’écriture du documentaire présente la non-binarité comme un « phénomène », une « mode », une nouvelle tendance de développement personnel. Quelque chose d’extrêmement superficiel : « se dire » non-binaire (ne pas le vivre, ne pas l’être réellement), se « penser » non-binaire et insister sur l’expression de genre des témoignant·es : maquillage, style vestimentaire.
On passe d’ailleurs un certain temps sur des personnes cisgenres (puisque le documentaire confond expression de genre et identité de genre) qui portent des perruques, se maquillent. On nous amène à plusieurs reprises aux États-Unis, à la rencontre de « la mode unisexe », symbole de la non-binarité selon l’émission, ce qui est évidemment faux.
Le documentaire confond donc identité de genre et expression de genre. Comment situer la non-binarité ?
On doit encore le rappeler : l’identité de genre n’est pas égale à l’expression de genre. Être non-binaire ne signifie pas automatiquement être androgyne. Cela ne signifie pas non plus désirer l’effacement de toute notion de genre, comme le suggère également le documentaire.
Sur le plan de l’expression de genre, on peut être non-binaire et féminin·e, on peut être non-binaire et masculin·e, on peut être non-binaire et androgyne.
Sur le plan de l’identité de genre, la non-binarité est en fait un parapluie d’une multitude de genres : certaines personnes non-binaires sont agenres, neutrois, androgynes (car c’est aussi une identité de genre, et c’est mon cas) ou encore mavériques (complètement en dehors d’une jauge qu’on établirait entre le genre féminin et masculin) ou genderfluid (dont le genre peut varier dans le temps, ou en fonction du contexte : de nombreuses drag queens sont genderfluids).
Prenons l’exemple de Bilal Hassani pour mieux comprendre : il se définit comme un homme cisgenre. Quant à son expression de genre, elle paraît androgyne, voire volontiers féminine. Son apparence est « gender non-conforming » : non-conforme aux stéréotypes de genres binaires.
Gender non-conforming peut désigner l’expression de genre, mais aussi l’identité de genre. Dans le cas de Bilal Hassani, le caractère « gender non-conforming » de son identité ne fait référence qu’à son expression de genre.
Pour certaines personnes cisgenres, comme Bilal Hassani, leur expression de genre non-conforme fait partie d’elles : c’est comme ça qu’elles se sentent le mieux malgré les violences que la société peut porter dessus.
Identité de genre et expression de genre ne se superposent donc pas toujours. Dans quelle mesure le documentaire dépolitise et pathologise la non-binarité ?
Il dépolitise la non-binarité en la présentant comme une tendance de mode, sans parler en profondeur de l’impact qu’a la non-reconnaissance de la non-binarité sur le plan social, administratif et médical.
Le seul aspect médical qui est mis en avant, c’est effectivement pour pathologiser la non-binarité, lui trouver une source sur une base essentialiste : aller fouiller dans le cerveau de cas d’études, jusqu’à l’étude de leurs chromosomes, ce qui est intersexophobe. Le genre est une construction sociale avérée, mais le sexe et la façon dont ont le définit aussi, par le caractère arbitraire de l’association de tels chromosomes, organes génitaux à un genre.
Dans le documentaire, Cami a cependant fait la démarche très constructive de demander des informations à un avocat sur la mention de genre à l’état civil : pourquoi est-elle requise, pourquoi ne peut-on pas supprimer la mention de genre de nos papiers d’identité, comme aux Pays-Bas ?
D’autres pays ont fait le choix de reconnaître la non-binarité à l’état civil, à défaut de supprimer sa mention — une démarche que nous pourrions instaurer en France afin de permettre une meilleure reconnaissance de la non-binarité sur le plan administratif, permettant aux personnes qui souhaiteraient la mentionner (il ne s’agit pas de l’imposer) sur leurs papiers d’identité d’endiguer la dysphorie que nous pouvons ressentir lorsqu’on nous appelle « Monsieur » ou « Madame » (que Cami décrit dans le documentaire comme tous deux aussi dérangeant l’un que l’autre, sentiment que je partage pleinement en tant que personne non-binaire), que nous devons régler des soucis d’ordre administratif (poste, banque, assurance, santé) ou faire respecter notre identité pendant notre scolarité, nos études et dans le milieu professionnel.
Il aurait été constructif et même primordial de parler de l’impact de la non-reconnaissance de la non-binarité à l’école, à l’université ou lorsque nous entamons des démarches administratives ou médicales : nous sommes réduit·es au mensonge, la plupart du temps, car la non-binarité est infantilisée.
Vouloir entamer des démarches de transition médicale, une prise d’hormones, une féminisation ou une masculinisation faciale lorsque les praticien·nes en face de nous considèrent que la non-binarité serait égale à un manque de détermination, une phase, un questionnement (comme le stipule le psychiatre Serge Hefez à la fin du documentaire) c’est extrêmement dangereux face à la dysphorie que nous pouvons ressentir, qui peut s’avérer très différente de ce que vivent les personnes trans dont l’identité de genre est binaire.
Les démarches de transition médicale peuvent-elles concerner les personnes non-binaires ?
Certaines personnes non-binaires peuvent vouloir entamer des démarches de transition médicale dans le but de maîtriser leur androgynie ou une non-conformité à des stéréotypes de genre non pas uniquement vestimentaire, mais aussi corporelle. Le corps médical n’y est pas préparé et continue notamment à forcer l’emprunt d’un parcours de transition unique.
Bien que la transidentité a été dépathologisée, de nombreux·ses praticien·nes, dans le public, continuent d’imposer aux personnes trans de justifier de suivis psychiatriques sur la durée, de demander des attestations stipulant la transidentité des patient·es et le suivi d’un traitement hormonal afin de pouvoir procéder à certaines interventions.
Certaines personnes trans — et de nombreuses personnes non-binaires — ne souhaitent pas forcément suivre une trajectoire de transition unilatérale ; je pense qu’une reconnaissance de la non-binarité auprès du grand public et du milieu médical permettrait de prendre en compte nos besoins de façon bien plus adaptée, sans que nous ayons à les cacher par peur d’être infantilisé·es ou de ne pas avoir accès aux démarches administratives et médicales que nous souhaitons mettre en place pour pouvoir être nous-mêmes.
Les témoignants et témoignantes de Zone Interdite : Ni fille ni garçon passent tous et toutes pour blanches. Toi qui es une personne racisée non-binaire, comment vois-tu cette uniformité des représentations de la non-binarité à l’écran ?
Les médias dits mainstream ont plus d’intérêt, en terme de visibilité, de rentabilité, à miser sur des personnes blanches cisgenres pour vendre une « transgression » des codes de genres. Parce qu’on imagine toujours autant le « grand public » comme étant majoritairement cis, blanc, hétérosexuel : l’identification leur semble donc facilitée, « normale ».
Pourquoi les médias mainstream célèbrent-ils aujourd’hui le fait qu’un homme perçu comme cis hétéro blanc comme Harry Styles, par exemple, porte des jupes ou des robes, quand on continue d’invisibiliser, voire violenter, toutes les personnes « gender non-conforming », transgenres, non-binaires et racisées ? Qui transgresse quoi, par rapport à quelles normes et imposées par qui, initialement ?
Les normes de genres n’auraient jamais eu à être transgressées si elles n’avaient pas été imposées à la base par des siècles de colonisation. Ces populations, racialisées à ce moment là, ont été contraintes d’abandonner nombreuses de leurs coutumes et l’importance qu’elles portaient aux personnes qu’on qualifie aujourd’hui en Occident de « non-binaires », ni hommes, ni femmes, avec des codes d’expression vestimentaire et corporelle qu’on jugerait aujourd’hui « non-conformes ».
Je pense que spectaculariser, se moquer et infantiliser la non-binarité (terme qu’on emploie actuellement dans les pays du Nord) est un acte qui comprend une part de racisme : en oubliant (volontairement ou non) que la non-binarité n’est pas nouvelle, que de nombreux peuples la célébraient sur le plan sociétal avant la colonisation.
Les médias occidentaux la vendent comme une invention des personnes blanches, et jeunes, comme une tendance venue d’Internet et des réseaux sociaux. Le documentaire appuie d’ailleurs cet aspect en n’interviewant que des personnes blanches et très jeunes. Pourquoi ne pas avoir interviewé, quitte à aller aux États-Unis, des personnes comme Travis Alabanza ou Alok Vaid-Menon, des personnalités non-binaires décoloniales qui parlent justement de la colonisation historique des normes de genre qu’on connaît actuellement ?
Voir cette publication sur Instagram
Je pense qu’on peut y retrouver la même logique qui fait que de nombreuses séries actuelles, qui s’adressent au grand public, ne s’intéressent qu’aux minorités un trait après l’autre.
Si on montre à l’écran une personne racisée, il y a de fortes chances qu’elle soit cis et hétérosexuelle. Si on montre à l’écran une personne LGBTI+, il y a de fortes chances qu’elle soit blanche et valide. Si on montre une personne neuroatypique à l’écran, il y a tout à parier qu’elle sera à la fois blanche et hétérosexuelle.
Je pense que les médias ont peur de « trop en montrer d’un coup », parce que nos existences leur semblent chimériques : personne ne pourrait s’y identifier, dans leur regard, parce qu’ils n’arrivent pas à concevoir que nous faisons partie du grand public, et qu’on peut être à la fois queer, gay, non-binaire, transgenre, racisé·e, handicapé·e, neurodivergent·e.
Pourquoi est-ce tout le monde gagnerait à ce qu’il y ait plus de personnes trans derrière la caméra, mais aussi à l’écriture et à la production de projets audiovisuels ?
De ce que j’en sais, il n’y a pas eu de personnes concernées derrière la caméra pour ce documentaire.
Cami, une des personnes interviewées, a cependant fait état de la bienveillance de la journaliste et du caméraman qui l’ont interviewé·e ellui et saon copaine Lana. L’équipe journalistique qui s’est occupée d’autres témoignant·es a été beaucoup moins bienveillante au vu de certaines questions déplacées qui ont pu être posées, comme « Est-ce que c’est pas un peu de la provocation », ou bien encore « Est-ce que vous voudriez lui transmettre plus de virilité ? »…
C’est assez facile de se rendre compte du fait qu’aucune personne concernée n’a été consultée sur l’écriture et la réalisation du documentaire quand on compte le nombre de fois où les témoignant·es ont été mégenré·es, morinommé·es ou décrit·es comme des filles et garçons qui se « disent » non-binaires.
Je pense que si on ne nous considère pas derrière la caméra, c’est parce que les personnes cisgenres (et hétérosexuelles, et blanches, de façon générale) ont l’habitude d’avoir le contrôle sur la narration de nos vies. Elles veulent continuer de se sentir au-dessus de nous et avoir au maximum de la pitié pour nous.
C’est pour ça que les récits qui dépeignent nos vies, lorsqu’ils sont écrits et réalisés par des personnes non-concernées, se concentrent sur la dysphorie que nous pouvons ressentir, sur une forme de violence que nous pouvons avoir vis-à-vis de notre reflet, de notre image. Parce que c’est plus simple de rejeter la faute sur notre santé mentale, sur une fragilité qui nous serait inhérente quand elle est en fait due à la violence dont nous submerge la société. Une société cissexiste, cisnormée, qui ne prend pas en considération notre existence, qui nous invisibilise, nous diabolise dès le plus jeune âge.
On l’a encore vu récemment sur les réseaux sociaux : ces vidéos en caméra cachée de CPE, de professeurs incendiant de jeunes personnes transgenres ou non-conformes aux stéréotypes de genre, leur sommant de ne pas venir à l’école en jupe, avec du vernis, des faux ongles ou des boucles d’oreille, leur inculquant que ce qu’iels sont est digne d’être puni… Nous sommes beaucoup à l’avoir vécu, dans nos familles, à l’école. À nous être caché·es pour ne pas faire tache, pour ne pas décevoir, pour nous conformer contre notre gré.
Ça marque à vie, quand ça ne nous tue pas. Alors forcément que nos revendications ne s’arrêtent pas au fait de porter du maquillage librement, forcément que nos existences deviennent politiques, parce qu’on doit se battre pour avoir les mêmes droits que la majorité, la même reconnaissance.
Mais cette reconnaissance, elle passe par la remise en question de ce qui fait autorité, elle passe par la remise en question de l’éducation nationale, du système médical et du gouvernement face à nos droits les plus élémentaires, face au milieu carcéral qui continue d’emprisonner des femmes trans dans des prisons d’hommes, face aux tribunaux qui nous obligent à justifier notre humanité afin de pouvoir changer la mention de notre genre à l’état civil, face à la violence que nous rencontrons quotidiennement et qui est silenciée, effacée.
Alors oui, la télévision française préfère montrer des paillettes et du makeup ou le dégoût de notre propre corps qui serait de notre fait unique, de notre responsabilité individuelle. Car cela épargne à la télévision de se remettre en question, son rôle en terme de représentation, le rôle de l’État, le rôle de la société.
Retrouvez Kelsi Phụng sur Twitter et sur Instagram.
À lire aussi : 13% des jeunes en France ne sont « ni homme ni femme » : la non-binarité, c’est quoi ?



![[Site web] Visuel horizontal Édito copie [Site web] Visuel horizontal Édito copie](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/04/site-web-visuel-horizontal-edito-copie-300x300.jpg?resize=135,187&key=faf12fa6)






![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-12T103045.066 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-12T103045.066](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/12/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-12-12t103045066-768x432.jpg?resize=300,350&key=93ef36ef)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-10T145633.472 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-10T145633.472](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/12/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-12-10t145633472-768x432.jpg?resize=300,350&key=2403676d)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-25T111624.319 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-25T111624.319](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-25t111624319-768x432.jpg?resize=300,350&key=d78cc3b4)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-28t150710132-768x432.jpg?resize=300,350&key=0dbf06ef)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-20T111708.991 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-20T111708.991](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-20t111708991-768x432.jpg?resize=300,350&key=a2a91e2d)



![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/05/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-05-22t164945311-768x432.jpg?resize=300,350&key=638f1da8)





![Copie de [Image de une] Horizontale (84) Copie de [Image de une] Horizontale (84)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/12/copie-de-image-de-une-horizontale-84-768x432.jpg?resize=300,350&key=30319f9e)



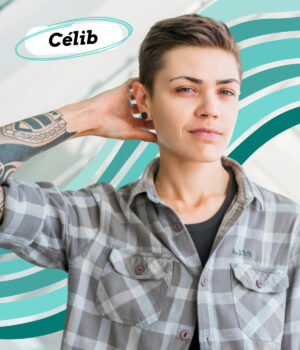








Les Commentaires
Je trouve que parler de genre (je n'ai toujours pas eu une définition précise...) c'est beaucoup plus flou, on parle de ressenti personnel, différent d'une personne à l'autre. Leur discours est très violent...mais rationnel, au sens qu'il suit une logique applicable à large échelle et presque globalement (discrimination basée sur le sexe qui a engendré une éducation normative oppressive pour les filles).