Qu’ils retournent ou qu’ils tardent à quitter le domicile familial, les jeunes sont de plus en plus nombreux à vivre sous le toit de leurs parents.
Le 31 janvier 2017, l’INSEE a publié une nouvelle note dans le rapport de l’enquête du Logement réalisée en 2013.
Depuis 2000, le nombre de 18-29 ans qui habitent dans le foyer parental ne cesse d’augmenter.
D’après l’institut de recherche français, cette hausse est principalement lié au chômage qui touche de plus en plus de jeunes diplômé·es et à l’augmentation du nombre d’étudiant·s chez les 18-24 ans.
Les plus jeunes à rester chez leurs parents sont en majorité étudiant·s (dans 57,8% des cas).
« Pour les 25-29 ans, un individu sur deux qui vit chez ses parents occupe un emploi » précise l’étude. Elle mentionne également que « plus du quart des jeunes adultes de 25 à 29 ans qui vivent chez leurs parents sont au chômage ».
Publié le 2 septembre 2013
Diplômé-e-s et indépendant-e-s, ils et elles ont quitté le nid familial, parfois depuis plusieurs années.
Mais le chômage, les loyers des grandes villes, le coût de la vie quotidienne… les ont forcé-e-s à « revenir en arrière » : retourner vivre chez leurs parents.
Face à la crise et aux possibilités d’emplois qui s’amenuisent sur un marché de plus en plus capricieux, de nombreux jeunes adultes (comprendre « les 25 – 34 ans ») n’ont aujourd’hui d’autre choix que d’abandonner une indépendance dont ils ne peuvent plus assumer les frais.
Ces dernières années, reportages télévisés et papiers dénonçant la difficile autonomie des jeunes parachèvent le portrait de la crise, cette entité Léviathan dont les commentateurs ne s’étonnent plus. madmoiZelle fait le point.
Un « phénomène Tanguy » subi
« Tanguy » : le sobriquet ironique, issu du film d’Étienne Chatiliez (dans lequel le héros, diplômé de Sciences Po et de l’ENS Ulm, vit encore chez papa et maman à 28 ans passés), désigne ces enfants qui tardent à quitter le nid familial ou y reviennent après quelques années d’indépendance.
Mais à l’inverse du mythique personnage de comédie française, les jeunes diplômés d’aujourd’hui envisagent bien souvent le fait de se réveiller tous les jours dans leur chambre d’ado comme un échec.
Une situation qui tend tristement à se répandre, avec l’augmentation du nombre de chômeurs de longue durée et l’arrivée en « fin de droits » d’une centaine de milliers d’entre eux, note le sociologue Éric Donfu, président-fondateur de « Dialogues et relations sociales », un atelier d’études sur les transformations de la société contemporaine.
Marché bouché
Si le chômage des jeunes a diminué en juillet pour le troisième mois consécutif, le nombre de jeunes chômeurs a augmenté de près de 7% sur cette dernière année.
Ainsi, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A (qui n’ont exercé aucune activité dans le mois) a baissé de 0,8% chez les moins de 25 ans (il s’établit à 551 600 personnes, contre 555 800 en juin) mais sur un an, il a augmenté de 6,9%.
Par ailleurs, il faut savoir relativiser la baisse du taux de chômage des jeunes l’été : les mois de juillet et d’août étant généralement flattés par les emplois saisonniers.
Reste qu’au delà de ces faibles soubresauts de la courbe du chômage, un constat perdure : chaque année, les diplômés arrivent sur un marché qui, déjà malmené par la crise, ne les attend pas toujours.
Pour Marie-Laure, diplômée d’un Master en Sciences du Langage, il n’est pas aisé de trouver un emploi en adéquation avec ses études :
« J’ai centré mes dernières années de fac sur la sémiotique en photographie. On avait droit à de nombreux cours aux Beaux Arts où je me suis donné à cœur joie, surtout en photo, en histoire et en dessin.
Après un stage pendant les études dans une galerie puis un autre chez une photographe après les études, je suis au chômage depuis janvier.
Pour me procurer de l’expérience et de la visibilité, je me dévoue à différents organismes bénévolement.
J’ai envie de travailler dans la photographie mais mes parents me poussent à me rediriger vers la communication – mon deuxième domaine.
Sauf que je ne veux pas abandonner ma première passion… »
Faut-il définitivement privilégier le choix rationnel des secteurs qui recrutent ? Pour Arthur, 24 ans, diplômé d’une école de commerce à Bordeaux, la situation n’est pas plus évidente :
« J’ai toujours voulu faire des études de lettres, mais je m’y suis résigné après le bac, pensant faire le bon choix en partant en éco.
Après un stage où je me suis retrouvé exploité et qui n’a pas débouché — comme c’est parfois le cas — sur une embauche, je me retrouve chômeur depuis maintenant plusieurs mois. »
Son appartement à Paris, même plutôt modeste, est une dépense que Arthur ne peut plus assumer :
« Je me suis d’abord mis en tête de ne pas le quitter, parce que repartir vivre chez mes parents est un retour en arrière beaucoup trop déprimant.
Et puis, très vite, j’ai dû me rendre à l’évidence : vivre au-dessus de mes moyens et contracter des dettes, ce n’est certainement pas le meilleur plan pour me lancer dans la vie adulte. »
S’il apparaît d’abord évident que l’offre d’emplois n’est pas la même dans tous les secteurs d’activité, le vrai constat de fond est que la crise n’épargne aucune frange du marché.
Précarité des contrats, stages abusifs, licenciement économique, interchangeabilité des travailleurs, manque de création de postes tandis qu’on impose aux salariés en place une feuille de missions toujours plus dense : rares sont aujourd’hui les emplois qui réunissent le triptyque « stabilité, juste rémunération et épanouissement ».
Pour Léa, 25 ans, qui a quitté le cocon familial en 2008 pour poursuivre ses études dans une école de communication à Montpellier, tout commençait de façon plutôt classique :
« Comme mes parents n’avaient pas les moyens de me payer ces études, j’ai fait un prêt étudiant pour subvenir à mes besoins (frais d’inscription, loyer…) jusqu’à ce que je trouve du travail.
Suite logique de mes aventures, je continue ma formation à Paris, un Master 1 dans une école renommée. Faire mon trou à Paris, c’était mon rêve depuis toute petite ! »
En 2010, Léa trouve un stage de fin d’études dans une start-up intéressante :
« La plupart des étudiants le savent : les stages servent à décrocher un emploi à la fin et nous nous donnons à fond pour ça.
C’est en tout cas exactement ce qu’il s’est passé pour moi : mon stage s’est transformé en CDD puis en CDI, avec un salaire de 1400€ net par mois, ce qui, pour un premier emploi, n’est pas mal du tout. »
À ce moment-là, Léa avait tout : « un super poste de community manager dans une boîte que j’adorais, un appart trop cool, une bande de potes et un salaire confortable qui me permettait de payer mon loyer (700€), ma bouffe et toutes mes sorties », explique-t-elle, nostalgique.
Mais en juillet 2011, la jeune femme apprend brusquement son licenciement économique :
« Mon CDI n’aura duré que 8 mois. Manque de bol, les premiers remboursements du prêt étudiant tombent le mois suivant.
Heureusement, je touche quand même 1000€ de chômage par mois + la CAF (200€ environ).
À ce moment-là, tu te dis : « allez ça va être facile de retrouver du travail, t’as déjà une 1ère expérience assez durable pour être crédible auprès des agences et des annonceurs ».
Grosse erreur : déjà, je suis de retour sur un marché du travail qui ne m’attend pas, et surtout, qui n’embauche quasiment que des stagiaires.
Pendant six mois, je vais donc chercher du travail et passer plusieurs entretiens, aidée par mes copines qui ne loupent pas une occasion de me transmettre les offres d’emploi…
Tout en devant faire face à la dure réalité de la vie : 700€ de loyer + 400€ de prêt étudiant à rembourser, ça fait 1100€ à débourser sur les 1200€ que je touche par mois. Mon compte n’a jamais autant été à découvert ! »
Neuf mois après, Léa « touche le fond » :
« Une dépression, plus d’argent, pas de travail. Un soir de février, au cours d’une discussion avec mes parents sur Skype, le constat est sans appel : je dois rentrer dans le sud pour me refaire une santé et prendre un nouveau départ.
Un mois après, je rends les clés de mon appart la mort dans l’âme et je rentre chez mes parents. »
Redevenir « l’enfant de ses parents »
Mais retrouver ses draps à motifs, ses posters d’ado, l’odeur du café déjà prêt le matin, et un frigo familial toujours rempli… ne suscite pas la même réaction chez tous les Tanguy-malgré-eux.
Pour Mathieu, diplômé d’un Master 2 en Sciences politique à Lille, revenir chez les parents a été « une expérience compliquée à gérer » voire « un traumatisme » :
« Je suis d’un naturel paresseux et ma mère est d’un naturel « mère poule ». Associez ces deux caractéristiques, et vous comprendrez vite ce qu’il s’est passé : pendant que je me complaisais à ne pas en foutre une, elle était beaucoup trop ravie de retrouver son fiston à la maison.
Tous les deux, on a rejoué la partition de mes années lycée : moi en gros branleur de fils, elle en maman aimante qui ne veut pas voir son enfant grandir. »
La mère de Mathieu renchérit :
« Certaines femmes n’auraient pas supporté que leur fils revienne du jour au lendemain à la maison.
Mais, sans vouloir faire de la psychologie de comptoir : Mathieu est notre unique fils et plus jeune, j’ai moi-même regretté de ne pas toujours avoir été en bons termes avec ma mère, qui m’a élevée seule.
Depuis, j’ai sans doute pour obsession que tout se passe à merveille entre mon fils et moi. »
Une situation régressive, qui est vite devenue insupportable pour le père de Mathieu :
« Quand Mathieu a pris son indépendance il y a quelques années, la structure de notre famille a changé : soudain, Mathieu n’était plus seulement notre enfant – mais aussi un adulte en train de se construire, et nous, plus seulement ses parents, mais de nouveau un couple qui ne vit qu’à deux.
Alors, quand il est revenu sans crier gare, a fait l’ado attardé, et que j’ai vu ma femme se transformer en mère hystérique, j’ai eu peur pour l’émancipation de Mathieu ET pour mon couple. »
Mathieu le reconnaît :
« Ne pas trouver de job et galérer, ça m’avait tellement démoralisé que je me suis vautré dans la régression.
Redevenir un gros gamin, ça a été ma façon de me dire « devenir un adulte, franchement ça a l’air d’être la croix et la bannière : tu peux bien attendre avant de sauter le pas ! »
Pour prévenir ce genre de situation, Delphine et ses parents ont choisi de longuement discuter avant son retour à la maison.
La jeune femme, qui a quitté son logement à Paris pour vivre en banlieue au domicile familial et « mettre de l’argent de côté » plutôt que de s’endetter, raconte :
« Je voulais que l’on soit d’accord sur trois points :
- Cette situation ne devra pas durer plus d’un an et il faut que je sois active dans ma recherche d’emploi
- Je suis une adulte que ses parents hébergent, pas une gamine sur qui on a encore autorité : je suis donc libre d’aller et venir sans rendre de compte à personne
- Je leur paie un loyer symbolique, pour ne pas me complaire dans la logique adolescente « à la maison tout est gratuit, je garde mes tunes pour aller boire des coups avec les copains. »
« Poser les termes du contrat » : c’est comme ça que Delphine décrit aujourd’hui cette conversation avec ses parents.
Pour elle, hors de question de s’enliser dans une situation inadéquate :
« J’avais peur d’être infantilisée à nouveau, et de ne pas avoir la force de chercher du boulot. Finalement, une fois ces 3 règles édictées, tout va bien.
Évidemment, la situation reste incongrue et tout n’est pas parfait : mes parents ont parfois du mal à accepter l’idée que je refuse une sortie avec eux le dimanche parce que je suis sortie la veille.
Sauf que quand je n’habitais pas avec eux, ils n’étaient pas là pour me voir traîner comme une loque dans le salon. La tentation de faire un commentaire sur mon mode de vie était moins pesante, c’est sûr… »
Sensation d’échec vs. solidarité familiale
« Outre la dépression engendrée par le chômage, il y a quelque chose de plus fort encore : la sensation d’échec.
Non seulement je n’ai pas trouvé de travail dans ma ville chérie, mais en plus je suis contrainte de repartir à zéro. Jamais je n’aurai pensé rentrer chez mes parents « la queue entre les pattes » ni dépendre encore d’eux à mon âge.
J’ai 25 ans, j’ai fait des études, je me suis donnée à fond… Pour pas grand-chose au final et c’est ça qui me rend folle », explique Léa, qui a trouvé un job de vendeuse l’année dernière, l’a quitté cette année, et envisage désormais les choses « un peu plus sereinement » :
« Mes parents m’ont accueillie à bras ouverts et ne me demandent aucune participation financière.
Et je mesure ma chance : je sais que je suis une privilégiée et que j’ai des parents qui sont prêts à tout pour m’aider. »
Les statistiques ne permettent pas exactement de connaître le nombre de jeunes diplômés vivant chez leurs parents en France.
« Un homme sur trois et une femme sur cinq vivent avec leurs parents », selon la dernière enquête d’Eurostat qui remonte à 2008 et chiffre à 51 millions les Européens dans cette situation.
Et le sociologue Éric Donfu de conclure sur une note un peu plus positive :
« Il est indéniable que la quasi-totalité des familles consacrent, dans la longue durée, une partie de leurs ressources à la mise en place d’un dispositif familial de sécurité, qui permet de disposer d’un peu d’argent pour aider momentanément un chômeur, un malade, un invalide, ou un étudiant.
Dans le même temps, la notion de « privatisation de la vie » à l’intérieur de la famille, cette capacité d’être soi-même tout en étant avec les autres, est bien devenue la règle.
L’autonomie des générations est inscrite dans le nouvel esprit de famille, et les difficultés à assumer ce retour au foyer le démontre.
Mais il faut bien reconnaître que maintenant, la crise a libéré la parole, et avec, tous aveux de systèmes D.
Et les a peut-être aussi décomplexés. Et, pour surmonter les « galères », s’il existe bien un système D, c’est bien le D comme Domicile parental ! »
Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.




![Copie de [Image de une] Horizontale-37 Copie de [Image de une] Horizontale-37](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/09/copie-de-image-de-une-horizontale-37-300x300.jpg?resize=135,187&key=6b1cfce1)




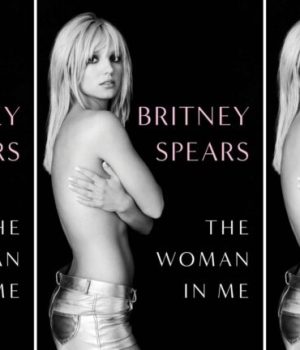









![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-12T103045.066 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-12T103045.066](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/12/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-12-12t103045066-768x432.jpg?resize=300,350&key=93ef36ef)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-10T145633.472 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-10T145633.472](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/12/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-12-10t145633472-768x432.jpg?resize=300,350&key=2403676d)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-25T111624.319 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-25T111624.319](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-25t111624319-768x432.jpg?resize=300,350&key=d78cc3b4)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-28t150710132-768x432.jpg?resize=300,350&key=0dbf06ef)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-20T111708.991 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-20T111708.991](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-20t111708991-768x432.jpg?resize=300,350&key=a2a91e2d)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-15t163147788-768x432.jpg?resize=300,350&key=c0e2a724)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-13T154058.525 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-13T154058.525](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-13t154058525-768x432.jpg?resize=300,350&key=5e3885bf)
![[Image de une] Horizontale (24) [Image de une] Horizontale (24)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/image-de-une-horizontale-24-768x432.jpg?resize=300,350&key=bd0cfdc3)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T170053.120 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T170053.120](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-30t170053120-768x432.jpg?resize=300,350&key=9979862d)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T164414.844 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T164414.844](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-30t164414844-768x432.jpg?resize=300,350&key=f42d86d3)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T115104.723 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T115104.723](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-30t115104723-768x432.jpg?resize=300,350&key=351be990)





Les Commentaires