Madmoizelle. Dans votre livre, vous dressez deux archétypes de féminités contemporaines : la femme “naturelle”, mince et souvent blanche, et celle, hyperféminine, maquillée et souvent racisée. On vient de vivre un exemple édifiant de cette catégorisation avec l’influenceuse Polska, bodyshamée par un chroniqueur de Quotidien. Je suis curieuse d’avoir votre analyse de cette séquence ?
Jennifer Padjemi. J’ai trouvé cette chronique horrible. Il y avait quelque chose de très infantilisant et classiste. Ces deux types de féminités très exacerbées sont un appel à choisir un conformisme. Sur Polska, c’était le petit parisianisme autour d’une table, qui vient se moquer d’une personne qui a décidé d’aller manifester. Et eux, ils font quoi ? J’ai trouvé ça d’un mépris qui exacerbe tout ce que les femmes vivent quotidiennement. Pour être socialement valorisée, il faut renier une forme de féminité. On nous dit : « débarrassez-vous des attributs ultrasexualisés parce que c’est toujours pour le regard des hommes ». Mais c’est aussi une invitation à s’effacer. Ça dérange que Polska soit visible dans cette masse de manifestant·e·s. La même personne avec une féminité plus discrète n’aurait pas subi ce traitement.
Dans le même temps, aux États-Unis, Gwyneth Paltrow a fait l’actualité avec un procès filmé. J’ai l’impression qu’elle a été traitée avec une certaine bienveillance. Les médias ont analysé ses looks, elle a fait le show !
Oui, le traitement a été hyper positif. Avec ce procès, qui avait des airs de série, on l’a revue sur le devant de la scène dans un rôle d’actrice et non plus dans celui du gourou de Goop. Elle savait ce qu’elle faisait : elle a profité de la médiatisation du procès pour faire des mimiques, pour s’exprimer d’une certaine manière. Il y a eu une réception médiatique intéressante, parce que même si elle ne met pas tout le monde d’accord, elle reste consensuelle. Elle a une manière de se présenter au monde qui rentre dans tous les codes acceptables de la féminité occidentale, à l’inverse de Polska.
L’une des grandes questions que pose votre essai, c’est comment est-on passé d’une révolution féministe intersectionnelle, centrée sur la libération de tous les corps féminins, à de nouvelles injonctions esthétiques ?
Cette révolution a été amorcée dès les années 60 par les féministes radicales et par les féministes des générations suivantes, qui ont produit des concepts pour nous aider à nous libérer du patriarcat. Puis, au tournant des années 2010, il y a eu une reprise de la narration par les premières concernées, à travers les blogs et les réseaux sociaux. On a vu émerger des féministes et des influenceuses qui ont proposé de nouvelles manières de raconter le corps. Des séries comme Girls ont aussi joué un rôle. Et puis, après est venue la récupération capitaliste.
Les marques ont commencé à changer leur discours et leurs représentations d’une manière visible, mais aussi artificielle. Ces entreprises sont gérées par les mêmes personnes qu’avant, souvent des hommes, qui veulent faire du profit. Plus on met en avant nos failles et nos complexes, plus les entreprises nous proposent de nouvelles injonctions. On en efface une, mais on en crée une autre. Et puis, le confinement est arrivé. Mon livre aurait été différent s’il n’y avait pas eu la pandémie. Ça a vraiment tout amplifié dans notre manière de consommer, de se voir, de se représenter et d’utiliser les discours soi-disant empouvoirants. Nos vies sont devenues un corps dans un environnement global.
Dans votre analyse de l’industrie du bien-être, vous mettez en lumière le concept de “positivité toxique”. Est-ce qu’il n’a pas été exacerbé par le confinement ?
Si, mais cette tendance a émergé avec le mouvement Body Positive. En théorie, c’est génial, mais en nous imposant d’aimer nos corps et nos apparences tout le temps, on nous maintient dans un ordre où quand ce n’est pas le cas, c’est de ta faute. Or, on est dans une fluctuation, de nos corps, de nos humeurs, de la vie ! Il y a toujours cette idée que si quelque chose ne va pas, tu peux le changer, et comment ? En achetant quelque chose. Soit, tu es le produit, soit tu es la consommatrice.
Beaucoup ont créé des comptes de développement personnel sur Instagram, avec ces phrases inspirantes de méditation, de yoga, de pleine conscience… Ça a pu aider des personnes, mais toute cette tendance à se présenter de façon super positive sur les réseaux sociaux amplifie un décalage avec la vraie vie. On n’est jamais vraiment naturelles, on se retrouve dans un épisode de Black Mirror (rires) ! Et au final, on ne sait plus vraiment qui on est et ce qu’on ressent.
Vous dressez un bilan assez sombre du mouvement Body Positive, que vous qualifiez d’ “arnaque” récupérée par le capitalisme. Comment est-on arrivés à un bilan si catastrophique ?
Il faut bien comprendre que ce mouvement est le résultat d’un travail acharné de militantes, comme Gras Politique. Il a été lancé par des personnes perçues comme grosses, et discriminées au quotidien, dans leurs vies amoureuses ou professionnelles, en raison de leurs corps. Des personnes dont on refuse la même humanité qu’aux autres. Mais ces dernières années, le mouvement Body Positive a été récupéré par des personnes non-concernées, sur le mode de « j’ai quelques kilos en trop » ou « aujourd’hui je suis ballonnée ». On est passé d’un discours contre la grossophobie à un discours contre les complexes. Tout le monde a des complexes, même les hommes, mais tout le monde n’est pas discriminé pour ça. La nuance est là. Et les marques récupèrent ça bien entendu.
Dans la lignée de la taxe rose, vous développez le concept d’ ”afrotaxe”. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s’agit ?
C’est un concept américain qui signifie que tu payes plus quand tu vas chez le coiffeur, si tu n’as pas les cheveux dans la norme. Je me suis rendue compte que dans un contexte français, c’est partout. Les femmes noires paient plus cher leur shampooing, leur coiffeur, mais passent aussi plus de temps à s’occuper de leur beauté en général. Rien n’est fait pour nous.
A Monoprix, des produits adaptés à nos cheveux ont enfin été disponibles, mais ils coûtent jusqu’à 20€ de plus que les autres. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Pourquoi on doit toujours payer plus, parfois pour des produits toxiques, ou vendus dans des packaging minuscules ? Ce prix de la beauté se joue aussi dans le temps qu’on passe à chercher des informations fiables.
On dépense de l’argent pour espérer se rapprocher au maximum d’une norme physiquement impossible à atteindre : la blanchité. L’idée n’est jamais de pointer du doigt les personnes parce qu’elles subissent ces injonctions. La société leur dit « si tu es plus claire, tu seras mieux acceptée ». Donc ça veut dire s’éclaircir la peau, se lisser les cheveux, maintenir une forme de minceur ou vouloir absolument correspondre à ce à quoi on est censées ressembler.
Tout cela a un coût financier, médical et mental. Des années plus tard, certaines personnes se retrouvent avec des cancers, des fibromes ou des difficultés pour avoir un enfant. Et personne n’en parle, parce que ça ne concerne pas la majorité des femmes en France. Il faut une réglementation globale, arrêter de proposer des produits toxiques et faire de la prévention.
Vous parlez aussi dans votre livre d’une autre récupération capitaliste et blanche, celle du self-care, qui est éminemment politique à l’origine, quand il concerne des personnes minorisées.
Oui, c’est cette manière, à chaque fois, de prendre quelque chose qui intéresse la majorité blanche. « Oh ce concept a l’air pas mal, ça me parle à un moment donné de ma vie, je prends ce qui m’intéresse, le reste non, et je capitalise dessus ». Le capitalisme infuse tout, même des idées philosophiques comme prendre soin de soi. C’est un peu comme si on espérait s’acheter du temps, parce qu’on vit dans une société où tout le monde est en burn-out ! Mais pour les personnes minorisées, c’est juste primordial. C’est dur de s’aimer au sein d’une société qui te renvoie constamment à ton identité. La pensée d’Audrey Lorde développe le fait de prendre soin de soi, pour mieux affronter l’hostilité de la société.
Vous analysez dans votre livre comment Instagram et TikTok ont fait main basse sur nos corps. Est-ce qu’aujourd’hui, les influenceuses ont autant de responsabilité que les médias féminins ?
Ce système existait avant elles, mais les influenceuses ont indéniablement une part de responsabilité. Je pense que chacun se nourrit de l’autre et que l’influence doit être considérée comme un métier à part entière. Certaines créatrices de contenu savent monter une vidéo, écrire, filmer, se présenter devant une caméra… D’un côté, il faut arrêter de les dénigrer juste parce qu’elles sont des femmes et qu’elles parlent de sujets jugés superficiels, mais de l’autre, on doit pouvoir questionner cette manière de nous vendre tout et n’importe quoi. Il y a des arnaques, la promotion de produits miracle comme des thés minceur etc…
Il faut être honnête et transparente avec sa communauté. Une loi vient de passer pour plus de transparence quant aux partenariats rémunérés et interdire la promotion de chirurgies etc. Elles ont des abonnées très jeunes qui les adorent, comme nous avec les célébrités durant notre jeunesse. Mais aujourd’hui, elles donnent l’impression d’être ta pote, alors que Jennifer Aniston, à notre époque, on savait qu’elle n’était pas notre pote (rires) !
Revenons au titre de votre livre. Grande tendance des années 2010, le selfie est critiqué par les élites, vu comme une pratique vulgaire. Le Festival de Cannes l’a interdit sur le tapis rouge. Alors, le selfie, ange ou démon ?
Un peu des deux. Avec ce livre, je me suis libérée d’une forme de superficialité mal vue dans les milieux intellectuels. Si j’ai envie de faire un selfie parce que j’adore la lumière et que je me trouve incroyable à cet instant précis, je le fais ! Il y a un phénomène de l’ordre du retournement de stigmates, avec cette idée de se réapproprier un truc hyper dénigré et d’en faire une force.
Là où ça peut devenir le diable, c’est qu’on croit qu’on le fait pour nous, mais la société nous pressurise à plaire. Les personnalités sur Instagram vont mettre en avant une certaine esthétique, multiplier les photos… Il faut réfléchir à pourquoi et comment on le fait. Quand une personne enchaîne les selfies et ne parle qu’à travers des filtres, je me dis qu’elle ne va pas forcément bien. On arrive aux portes de la dysmorphie. Donc, le selfie peut être quelque chose de puissant pour la personne qui s’en empare, mais aussi le reflet d’un mal-être.
Pour moi, le mot « selfie » invite aussi à se regarder, dans une forme d’autocritique bienveillante. On revient à cette idée de self-care : “connais-toi toi-même”. Socrate parlait déjà de bien-être. Prendre soin de soi, c’est s’intéresser philosophiquement à qui je suis, qui j’ai envie d’être, comment j’ai envie de m’insérer collectivement dans la société.
L’individuel va vers le collectif. Si chacun.e fait ça, quelque chose de très fort se passera. On aura plus besoin de se jauger les un·e·s les autres. On saura qui on est et on pourra mieux se battre ensemble.







![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/05/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-05-22t164945311-768x432.jpg?resize=300,350&key=638f1da8)


![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-28t150710132-768x432.jpg?resize=300,350&key=0dbf06ef)

![[Image de une] Horizontale (26) [Image de une] Horizontale (26)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/image-de-une-horizontale-26-768x432.jpg?resize=300,350&key=3f4065eb)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-15t163147788-768x432.jpg?resize=300,350&key=c0e2a724)
![[Image de une] Horizontale (24) [Image de une] Horizontale (24)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/image-de-une-horizontale-24-768x432.jpg?resize=300,350&key=bd0cfdc3)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-16t173042478-768x432.jpg?resize=300,350&key=e6ae1102)









![Copie de [Image de une] Horizontale (84) Copie de [Image de une] Horizontale (84)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/12/copie-de-image-de-une-horizontale-84-768x432.jpg?resize=300,350&key=30319f9e)



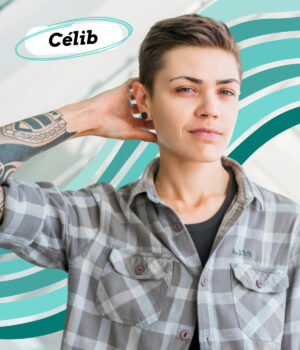







Les Commentaires
En tout cas ça m'a parlé car j'ai toujours pensé que pour être belle il faut s'autoriser à être moche par moments et on s'en fout!