Entre deux séances de travail pour préparer le montage de son prochain film, la cinéaste Baya Kasmi nous accueille chez elle dans son salon rempli de livres.
La scénariste et réalisatrice vient de terminer le tournage de son prochain long métrage, Youssef Salem a du succès avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky et Vimala Pons. Elle en a co-écrit le scénario avec Michel Leclerc, avec qui elle travaille et est en couple depuis vingt ans — ils ont aussi co-écrit ensemble Le Nom des gens, César du meilleur scénario original.

Baya Kasmi évoque à travers ses films aussi bien les violences de genre que la pédocriminalité et le racisme. Et ce, souvent sur un ton de comédie. Elle travaille également à l’écriture de l’adaptation de la nouvelle de Nicolas Mathieu Rose Royal, l’histoire d’un féminicide conjugal.
Avec beaucoup de rires et de sourires, tout en vapotant, elle nous parle de ses projets, mais aussi tout simplement d’elle et de son rapport à l’écriture.
Interview de Baya Kasmi, cinéaste plurielle
Madmoizelle : Quand le cinéma est-il arrivé dans votre vie ?
Baya Kasmi : Petite, je rêvais d’écrire des livres, j’écrivais dans ma tête, mais ça me semblait impossible. Trop grand pour moi. Au lycée polyvalent du Mirail, à Toulouse, j’ai fait une option cinéma. Mon envie d’expression s’est focalisée sur les films. J’ai tout fait pour y arriver tout en n’y croyant pas. J’étais en Deug de droit, j’avais un mi-temps à Mc Do et j’étais bénévole dans un festival de court-métrages.
Un jour, j’ai décidé de « monter à Paris ». J’ai été assistante dans une boîte de production de cinéma, je me disais que j’allais me faire des contacts mais mon boulot c’était des notes de frais, la compta, et j’étais nulle. J’ai perdu le taf…
J’ai compris qu’avant les contacts, il fallait écrire, écrire, écrire.
Ma rencontre avec Michel a été fondatrice. Il a lu ce que je faisais, m’a donné les conseils dont j’avais besoin. Car on peut rêver d’écrire, mais le faire vraiment, c’est terrifiant, il faut avoir tellement confiance en soi et en même temps douter tout le temps, retravailler mille fois.
Une fois des textes écrits, j’ai envoyé ça à l’agent Lise Arif, en prétendant être recommandée. Elle a lu, a aimé et n’a jamais cherché à savoir si j’avais menti. Elle m’a vite trouvé du travail.
Le désir d’écrire est donc né dans votre enfance ?
Oui, je pense que c’était lié à des secrets. On ne se l’explique pas sur le moment, mais moi la première chose que j’ai écrite, c’était un début de roman d’une dizaine de pages, sur les quelques années où, enfant, j’avais caché à mes parents que j’étais abusée sexuellement par mon professeur de piano. C’était déjà sur un ton tragi-comique.
J’essayais de parler de ce que ça représente dans la vie. Surtout quand ça arrive enfant, on a du mal à se définir en dehors de ce qui s’est passé. Qui aurais-je été si ça n’était pas arrivé ?
Ecrire là-dessus, c’est reprendre sa liberté, s’extraire de cet événement et devenir acteur de l’histoire, la réinventer.
Vous parlez des violences sexuelles et de pédocriminalité dans votre court-métrage J’aurais pu être une pute, dans Le Nom des gens et dans Je suis à vous tout de suite avec un agresseur professeur de piano, un autre médecin… Comment s’écrivent ces vécus-là ?
J’écris sur ce que le traumatisme génère chez soi, comment on deale avec, comment on essaye de se révolter contre ça, mais aussi sur des stratégies de survie.
Par le personnage de Bahia Benmahmoud dans Le Nom des gens, avec Michel, on voulait raconter de la complexité. Elle couchait avec ses ennemis politiques pour les rendre de gauche. Alors qu’elle avait été abusée sexuellement, elle semblait très libre avec son corps.
L’idée que se font certaines personnes de quelqu’un qui a vécu une telle agression ou un viol, c’est tout de suite, le corps bloqué, le plaisir absent. J’ai parfois dû expliquer que j’avais vraiment vécu ça pour qu’on ne balaye pas le personnage avec l’argument « ce n’est pas réaliste ».

Quand on est victime d’une agression sexuelle ou d’un viol, on ne veut pas entendre les autres dire ce que ça nous a fait, à quoi ça nous condamne. On a besoin de raconter soi-même.
Que ce soit quand on parle des sujets comme le fait d’être enfant d’immigré, d’être pauvre, ou d’avoir été victime de quoi que ce soit, on écrit aussi pour dire « non, mais vous n’allez pas me réduire à ça ».
Vos films sont inspirés de vos vies, finalement?
Ecrire c’est parler de soi, mais en essayant de se mettre en lien avec le monde. Forcément, on fait avec nos expériences, mais d’un autre côté, je n’ai pas du tout envie de raconter ma vie. Partir de sa propre histoire sert à être plus juste et, ainsi, on évite les clichés.
J’ai l’impression qu’en tant que scénariste, j’ai toujours travaillé sur le matériel personnel des réalisateurs. Avec Thomas Lilti, quand on écrivait Hippocrate ou Médecin de Campagne, on malaxait ses expériences personnelles, les contradictions, les frustrations, les rencontres humaines qu’il avait vécues en étant médecin.
Et cette sincérité, cette tentative de créer du sens avec le chaos de la réalité, c’est forcément passionnant.
Vous diriez que vous vous réappropriez vos propres vécus pour les mettre en fiction ?
C’est tout mon travail, c’est une exploration. L’écriture fait qu’on se réapproprie les choses, qu’on raconte sa propre version, on pose un regard, on met l’histoire à distance et on l’observe comme si elle n’était plus à nous. Cela génère une puissance dans la vie.
On nous a aussi souvent reproché à Michel et moi de ne pas traiter un seul sujet. Par exemple mêler l’histoire personnelle à l’histoire d’un pays, mêler les origines et les traumatismes liés aux violences sexuelles par exemple, de raconter ça avec de la joie, de la vie. Mais c’est vraiment ce que je veux faire. Montrer qu’on est constitué de multiples couches.
La seule chose qui m’intéresse avec les personnages c’est comment l’élan de vie apparaît, comment on bataille avec sa condition pour rester vivant.
Comment les réflexions sur l’identité, les origines… imprègnent votre travail ?
On a cette tête, ce nom… A partir de là, il faut arriver à trouver un chemin d’individu, alors qu’on est dans une société qui nous ramène énormément à notre origine. Quand on a une tête d’étranger en France, ça a des résonances dans notre vie. Quand on a une tête de français alors qu’on est arabe aussi, comme Bahia Benmahmoud dans Le Nom des gens.
« Je n’ai pas envie d’idéaliser les personnages féminins ou issus de minorités : pour moi respecter un personnage, c’est aussi l’aimer dans ce qu’il a de médiocre ou de pathétique, dans ses défauts. »
Baya Kasmi
Ces déterminismes sociaux, physiques ont un poids hyper fort dans la vie et, en même temps, on a plein de choix, on peut faire avec, réinventer cette identité-là. C’est la question de changer de regard sur soi, se libérer du regard des autres. J’ai l’impression que je raconte toujours ça.
Comment le racisme qui existe en France imprègne vos scénarios ?
Mon sujet ce n’est pas le racisme mais la sensation de celui qui le subit, sa réaction au racisme. J’aime raconter qu’il peut y avoir dix mille versions de ce qu’est un arabe, mille façons d’être musulman, d’être les deux à la fois ou pas, mille façons d’être français…
C’est un moment dans la société française où on en a besoin, parce que les clichés prennent trop de place. On est d’une génération qui doit raconter ces histoires-là, comme les Juifs l’ont fait dans les années 1980 aux Etats-Unis, Philip Roth dans ses livres par exemple.
Est-ce important dans votre cinéma que le plus de personnes soit représentées pour que tout le monde puisse s’identifier ?
Oui, mais je ne le fais pas pour ça. Par principe, dans les castings, j’ai toujours essayé de prendre des gens de toutes les origines quel que soit le personnage. Qu’il y ait des gens de toutes les couleurs, de tous les âges, en situation de handicap… ça fait vraiment du bien, mais quand on sent que c’est forcé, c’est pénible.
De même, je n’ai pas envie d’idéaliser les personnages féminins ou issus de minorités : pour moi respecter un personnage, c’est aussi l’aimer dans ce qu’il a de médiocre ou de pathétique, dans ses défauts. Et surtout ne pas le réduire à son origine sociale ou ethnique.
Comment c’est de travailler en couple ?
C’est très spécial. Tout ce qu’on vit, on le travaille dans le scénario. On peut écrire en faisant le repas, en vacances, partout, tout le temps et les disputes qu’on a peuvent servir, tout peut servir.
« Je ne me dis jamais que je fais un film de femme, ce serait réducteur. »
On aime aussi faire des choses l’un sans l’autre, on ne réalise pas ensemble par exemple. Pour écrire des choses intéressantes, il faut qu’on développe chacun nos univers, qu’on n’ait pas l’impression d’être un seul et même artiste à deux têtes.
Que pensez-vous que votre regard de femme apporte en tant que réalisatrice ?
Je crois qu’il apporte tout le temps, dans le film entier, le fait d’être un homme ou une femme, on ne l’oublie jamais, c’est intrinsèque. On n’a pas la même position, on ne raconte pas les mêmes choses, on ne filme pas les scènes d’amour de la même manière, ça change les points de vue…
Mais évidemment, ce ne n’est qu’une partie de mon identité, c’est pour ça que je ne me dis jamais que je fais un film de femme, ce serait réducteur.
Vous filmez beaucoup la nudité, les corps des femmes, comme ceux des hommes. En quoi cela est important pour vous ?
Pour moi, le cinéma ne doit pas nier le corps.
Travailler sur la nudité a toujours été important. Je ne cale pas mes choix sur la vision des misogynes ou des puritains. Je revendique le fait que la nudité, ce n’est ni provocateur, ni sale, ni dangereux, ni insultant, cela fait partie de notre vie.

Tout est une question de regard : il n’y a rien de gênant a priori. J’aime filmer les corps, le désir. Beaucoup d’hommes ont filmé les femmes et le désir que les femmes provoquaient en eux, j’aime le fait d’être une femme qui filme aussi le corps des hommes, qui raconte le désir féminin.
Vous avez un jour dit, en parlant de la comédie, que venant d’un milieu populaire c’était le type de film que vous aviez aimé voir. Est-ce que faire de la comédie pour parler de sujets parfois douloureux, c’est une manière de les rendre accessibles au plus grand nombre ?
Oui accessibles, mais aussi supportables, même pour soi. C’est aussi important de ne pas penser la comédie comme un sous-genre. Les gens qui la pensent comme ça font des mauvaises comédies.
Les premiers trucs que j’ai vus à la télé, c’est Rabbi Jacob, Les Compères, La Chèvre, des grands films, et puis Capra, Hitchcock, Chaplin. Et ça se mélangeait avec les sketchs des Inconnus, les séries. J’ai été imprégnée de cette culture populaire, ça influence, et je n’ai pas fait d’école de cinéma, donc je tâtonne avec ce que je suis et ce que j’ai envie de voir.
Venir d’un milieu populaire et avoir eu ce goût-là, ça donne envie de plaire au plus grand nombre, de ne pas être élitiste.
J’ai écrit des tonnes d’épisodes de la série Coeur Océan pour la télé et on les écrivait avec un vrai plaisir, avec cœur. Oui, ce sont des histoires d’adolescents qui s’aiment sur une plage, mais quand on fait des choses sincèrement, il n’y a pas de sous-genre.
Comment est venu le souhait d’adapter Rose Royal et de parler de féminicide conjugal ?
Du texte de Nicolas Mathieu que j’ai adoré. Je lisais beaucoup Marguerite Duras à ce moment-là – Dix heures et demie du soir en été, Le Ravissement de Lol V Stein… j’avais envie de ces personnages féminins très forts qui tournent autour de leur destin. Puis, Rose Royal m’a bouleversée. Je n’avais plus qu’une idée en tête, faire ce film.
On lit dans le livre le changement de regard de la société sur ces meurtres, ces féminicides. C’est tellement important de les raconter.
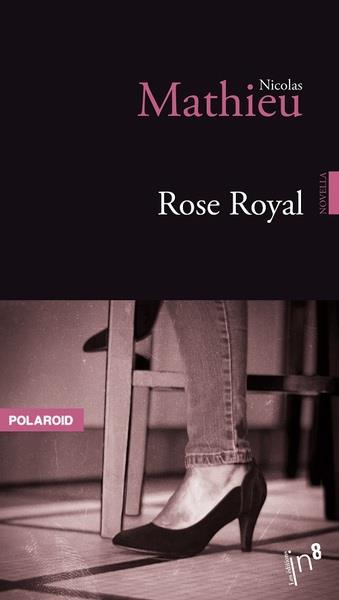
Rose Royal est à 8,90€ en poche
En travaillant sur l’écriture du scénario avec Caroline Deruas, on se rend compte que la violence de ces hommes-là sur les femmes, c’est l’impossibilité d’accepter la dépossession, une faiblesse d’une violence inouïe liée à des constructions sociales….
C’est le portrait d’une femme forte qui va être assassinée et il faut aussi pouvoir penser le bourreau, comprendre sans chercher d’excuses, sans tomber dans une romantisation. C’est un endroit d’écriture très délicat.
Politiquement, c’est important pour vous d’être engagée ?
Parler politique à travers mes films oui, parce que tout est politique. Je ne pense pas qu’on puisse faire des films apolitiques et si on croit en faire, c’est qu’ils sont de droite. Chaque choix, de narration, de comédien, de mise en scène, est politique. Mais je ne me sens pas engagée au sens du militantisme.
Vous venez de tourner votre nouveau long-métrage. Pouvez-vous nous en dire plus ?
C’est encore une fois un film de mélange des genres, une comédie, dramatique et politique, qui parle du rapport au sexe et à l’identité…
C’est l’histoire de Youssef Salem, un écrivain d’origine maghrébine, joué par Ramzy Bedia, qui a écrit un livre qui parle de l’obsession sexuelle et des tabous. Ce livre commence à marcher et Youssef a une peur panique que son père lise le livre car il s’est inspiré de sa famille et de leurs non-dits. Il y a tout un jeu des sept différences entre le roman et la vraie vie de ses frères et sœurs.
Le film traite de l’autobiographie, de la fiction et des catastrophes que cela peut provoquer. Mais aussi de la recherche du plaisir.

Mon film parle aussi d’un autre sujet important pour moi : est-ce que l’arabe aura un jour le droit à la fiction ? Quand on écrit, on n’est pas des sociologues, on ne représente que nous-même. Mais dès qu’on traite des gens issus de l’immigration, on a apparemment un truc à dire sur toutes les personnes de cette origine, ce qui est faux bien sûr !
Le personnage joué par Ramzy écrit pour se libérer, et au lieu de le voir comme un écrivain, tout le monde lui dit « qu’est-ce que vous voulez dire sur les arabes donc » ?
Vous, vous avez eu des reproches dans votre famille de mal les représenter ?
Non, mais c’était quand même un débat, il y a des choses intimes qui se disaient dans mes films qui les ont bousculés, forcément. Cela a été une angoisse pour moi et j’ai fait une allergie à l’autobiographie après Le Nom des gens.
J’ai tout de même eu ce truc plutôt drôle avec mon père qui disait « Mais, je ne suis pas du tout comme ça » et ma sœur qui disait « bah si papa t’es un peu comme ça ». Et puis, en tant qu’auteur, on essaie de romancer pour éloigner le film de la réalité, mais cet entre-deux est parfois encore plus heurtant pour les proches, ils peuvent avoir l’impression qu’on ment.
Ça m’intéresse de questionner moralement l’autofiction.
Quelle est votre vision du féminisme ?
Ma vision du féminisme est complexe. Le féminisme, c’est une expérience de libération empirique, qui prend des formes différentes d’une personne à l’autre, fonction de ses expériences, de l’endroit d’où il part. Donc on ne peut pas imposer une seule vision du féminisme.
« Je ne pense pas qu’on puisse faire des films apolitiques ; si on croit en faire, c’est qu’ils sont de droite. »
Baya Kasmi
J’ai pu me disputer beaucoup sur le voile à l’école quand j’étais jeune avec des féministes qui n’avaient pas grandi comme moi en banlieue et n’avaient pas mes origines, quand elles me disaient « si elles veulent mettre le voile, c’est leur droit », je n’étais pas du tout d’accord, parce qu’à vingt ans ça me révoltait qu’on puisse être essentialiste comme ça. Aujourd’hui, j’ai compris qu’il y a des étapes, que certaines femmes se libèrent même en portant le voile à un moment de leur vie, où ça va les aider, les protéger et peuvent très bien à un autre moment le rejeter.
Moi quand on me traitait de pute parce que ma jupe était trop courte, je la raccourcissais encore et je disais au mec : « voilà, c’est pas pour toi, tu toucheras pas et je t’emmerde ! ». C’était ma façon d’être libre. Des filles préfèrent au contraire éviter d’être sexy parce qu’elles voient ça comme une façon de se conformer aux attentes des hommes, je le comprends aussi.
Le féminisme prend toutes sortes de chemins. J’ai plus de recul aujourd’hui, je scrute mes réflexes, mes limites… Et je pense que les hommes doivent eux aussi s’interroger sans cesse sur leurs réflexes.
Le féminisme pour moi, va forcément aboutir à une libération pour tous les individus, parce que les réflexes machistes et patriarcaux, c’est extrêmement lourd à porter pour tout le monde.
À lire aussi : Mounia Meddour : réaliser un premier film en tant que femme, « c’est un acte de résistance »
Photo de Une fournie par Baya Kasmi.
Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos podcasts. Toutes nos séries, à écouter d’urgence ici.

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-27T162319.056 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-27T162319.056](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-27t162319056-768x432.jpg?resize=300,350&key=3b6a8bc7)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T160849.930 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T160849.930](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-15t160849930-768x432.jpg?resize=300,350&key=805c7101)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-08T164030.491 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-08T164030.491](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-08t164030491-768x432.jpg?resize=300,350&key=3bfffda2)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-18T165018.937 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-18T165018.937](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-18t165018937-768x432.jpg?resize=300,350&key=513eae37)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-07T114455.874 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-07T114455.874](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-07t114455874-768x432.jpg?resize=300,350&key=7f751c05)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-17T114010.690 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-17T114010.690](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/09/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-09-17t114010690-768x432.jpg?resize=300,350&key=d5e1133a)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-12T104005.894 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-12T104005.894](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/09/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-09-12t104005894-768x432.jpg?resize=300,350&key=39374b96)























Les Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaire sur cet article.