J’ai toujours voulu faire une retraite. Je me suis souvent imaginée coucher dans une chambre austère, lire à l’ombre d’un arbre, m’abstraire dans une méditation que ne troubleraient que les cloches qui rythment une journée sans montre. Écrire vaguement, marcher beaucoup, me taire et laisser le lieu infuser en moi une profondeur qu’on n’atteint qu’en ces conditions.
Un jour, j’ai lu la biographie d’un homme devenu moine zen. La résonance a été immédiate et impossible à nier. Cette découverte est devenue une soif que j’ai commencé d’étancher comme j’ai l’habitude de traiter mes enthousiasmes : en lisant des livres sur le sujet.
En lisant, j’ai commencé à entrevoir la profondeur et la discipline du zen, cette branche japonaise du bouddhisme,. Et plus je lisais, plus je comprenais qu’il était absurde de lire. Par delà les divers auteurs, les styles et interprétations, un consensus s’établit : le zen est chose qui se pratique. La pensée peut éventuellement soutenir, orienter et accompagner, mais elle est secondaire, et le zen se résume à sa pratique, qui se nomme zazen, la méditation assise.
Je me suis inscrite pour une semaine de retraite zen en juillet
Le moment était venu. Pour moi qui passe mon temps à penser, analyser, lire, réfléchir et me distancer, cette décision avait un parfum d’audace transgressive. J’ai surmonté ma légère phobie administrative pour chercher et trouver un monastère zen qui organisait des retraites. Je me suis inscrite pour une semaine en juillet, j’ai organisé la garde de ma fille, et j’ai attendu, suspendue comme au moment de sauter dans une piscine, attendant le choc inévitable de l’eau froide et l’enveloppement liquide qui dissout la peur et périme les doutes. J’étais excitée et heureuse, je me conseillais de ne pas trop anticiper et de ne rien attendre de spécial, pour ne pas être déçue et pour laisser l’expérience se déployer par elle-même sans l’encombrer de ce que je pouvais projeter, imaginer, espérer ou redouter.
Pour des raisons logistiques, il était prévu que j’arrive très en avance à la petite gare d’Onzain en région Centre-Val-de-Loire, où je devais attendre environ quatre heures la navette qui m’emmènerait au monastère. Cette attente a formé comme un sas, où je me suis dépouillée petit à petit et où le silence a commencé à parler. La chaleur faisait miroiter les rails, la solitude était douce.
Il y avait d’autres débutants comme moi qui venaient participer à cette retraite. Pendant le séjour, j’ai dormi avec quatre autres femmes sous une grande tente prévue pour douze, qui se transformait en sauna pendant la journée à cause de la chaleur, et protégeait symboliquement du froid la nuit. La première nuit a été mauvaise : je n’étais pas assez couverte et je m’inquiétais du premier zazen.
Découvrir zazen, la posture qui enseigne
Zazen, c’est le coeur du zen, ce en quoi tout se résout, qui seul importe et constitue tout ce qu’il y a à vivre. Zazen est une posture, une discipline et un repos en même temps. C’est “simplement s’asseoir” sans attendre quoi que ce soit, s’asseoir pour rien, gratuitement, sans esprit de sérieux ni esprit de profit. C’est une posture où l’on se contente d’être, où la subjectivité, ce qu’on nomme l’ego, perd de son évidence et de son épaisseur, quoiqu’elle se batte aussi souvent comme un lion pour continuer d’exister. Zazen, c’est le lieu où les choses et nous-mêmes nous dévoilons. Zazen, c’est la posture qui enseigne.
Les journées commençaient par zazen et terminaient de même. Une ou deux autres séances venaient en journée. Entre temps, deux moments de travail communautaire ( appelé “samu”) : la communauté est appelée par un gong, se rassemble pour prendre connaissance des besoins et choisir son affectation en fonction de son goût du moment.
J’ai beaucoup travaillé au potager. C’était une semaine caniculaire, et j’ai aimé travailler dur, sentir les muscles jouer, la sueur couler, et jusqu’aux éblouissements qui me prenaient quand je me relevais trop vite. Se couler aussi profondément que possible dans un geste répétitif suspend la pensée et la remplace par une forme d’achèvement en soi, comme si l’existence se réduisait à un point, sans futur ni passé.
J’ai plongé dans des cathédrales vertes de haricots, accroupie pour ramasser les gousses, j’ai douillettement enveloppé de paille des petits plants de salade pour les aider à conserver leur humidité, j’ai tiré fermement mais délicatement sur les fanes de carotte pour dégager la racine sans les casser et devoir creuser.
Le goût de la simplicité
Le goûter à l’ombre des arbres et la douche qui suivait ces efforts étaient volupté pure. La cuisine était délicieuse. Simple et goûteuse, de saison, fraîche, sans ostentation et raffinée. La mélisse poussait généreusement et parfumait les salades de fruits. Le matin, il y avait le thé vert avant Zazen et il y avait la genmaï après.
C’est sans doute ce qui a suscité le moins d’enthousiasme chez les novices. La genmaï est une soupe de riz, au goût fade et à la texture incertaine. Le riz complet qu’on a fait cuire des heures s’y défait et donne une épaisseur amidonnée à l’eau. Si l’on y ajoute du sel au sésame, le gomasio, la mixture acquiert néanmoins de nouvelles dimensions. Il y a une sobriété digne, un dénuement et un retour aux choses-mêmes dans ce met.
Si, si, j’aime bien
La genmaï est à l’image de la voie zen : elle a le goût de la simplicité, dont il faut se laisser imprégner et dont le charme s’apprend à rebours de ce qui ordinairement séduit. C’est difficile, car notre goût va plus spontanément à l’excitation, à la nouveauté, au contraste et à l’intensité. La simplicité est difficile non tant à atteindre qu’à chérir, car c’est seulement au fur et à mesure qu’on apprend à l’aimer qu’elle peut se traduire et s’exprimer dans notre existence.
La méditation assise est le cœur du monastère
La méditation assise, dans la posture du lotus pour ceux qui le peuvent, en demi-lotus, en tailleur voire sur une chaise pour ceux qui ne le peuvent pas, est le coeur du monastère. Elle se pratique dans un vaste dojo que les premiers membres de la communauté ont construit de leurs mains, qui sent le bois et donne envie de chuchoter.
Une épaisse moquette crème revêt le sol, les murs blancs ont une apparence brute, rien n’est poussiéreux. Un grand autel central supporte une statue de Bouddha, que je n’aurais pas tellement l’occasion de contempler, car la méditation se pratique tournée vers l’extérieur, au pied du mur pour les novices, plus proches du centre pour les plus anciens.
On s’aligne là. Dans l’ensemble, les hommes sont à droite et les femmes à gauche, mais ce n’est pas une règle absolue. Entre les séances de zazen, chacun abandonne contre un mur ou un pilier son coussin de méditation, appelé zafu. On salue en entrant dans le dojo, on s’insère dans une ligne de pratiquants sans chercher la meilleure place, on salue à nouveau, son zafu et les autres pratiquants. On prend le temps de s’asseoir le plus correctement possible – c’est important, les douleurs arriveront bien assez tôt, il faut soigner son assise – on s’immobilise petit à petit, les grandes ailes noires des kimonos se replient progressivement partout autour de nous tandis que chacun entre dans le silence, l’immobilité, et s’absorbe dans sa propre respiration.
Je craignais de mourir d’ennui
Alors chacun commence son voyage intérieur. Tous étaient différents. Je craignais de mourir d’ennui dans ces heures d’immobilité. Cela n’a pas été le cas.
Le temps changeait de texture. Ses dimensions objective et vécue se dissociaient et s’enroulaient l’une dans l’autre en même temps. Tout de présence à soi, tout de chair et de sang, zazen était en même temps une distance. Présence et absence devenaient un peu la même chose, et le temps n’était pas le martyre auquel je m’étais vaillamment préparée.
Quand le corps s’immobilise, l’esprit a le champ libre, et les pensées qu’aucune nécessité d’agir ne vient interrompre déferlent comme des vagues, roulant des souvenirs et se retirant en laissant à la conscience tout le loisir de considérer les diverses épiphanies qui apparaissent comme des coquillages sur le sable humide.
Ces pensées revêtent une dimension de plus en plus fantomatique à mesure que l’esprit s’absorbe dans le mouvement simple de la respiration. L’expiration s’allonge, ponctuée par l’inspiration. La pensée se décolore, le corps gagne en épaisseur. Le résultat de ce processus est une certaine posture de disponibilité, comme une béance prête à tout recevoir.
Laisser les pensées défiler
Le regard se pose devant soi, à un mètre environ, à moins que le mur ne soit plus proche. Les yeux maintenus mi-clos empêchent de s’endormir ou de s’enfoncer dans ses pensées. Il ne s’agit pas de favoriser l’introspection, mais de se faire pure présence.
La lumière varie selon le moment de la journée, et au cours du zazen lui-même. Parfois un rayon lumineux arachnéen, provenant du lointain soleil levant venait achever sa course en dorant un unique fil de moquette sous mon regard et ce spectacle était si abondant que je voulais le partager. Souvent, les imperfections du mur ou de la moquette s’animaient et dessinaient pour moi de petites illusions évanescentes.
Les pensées naissent et meurent, filant comme les nuages. Il ne faut pas les poursuivre, se laisser entraîner dans leur séduction. On s’attache à la respiration, comme Ulysse au mât de son navire pour résister au chant des sirènes. Les pensées qu’on réussit à ne pas laisser s’habiller de mots sont moins dangereuses, puisqu’elles nous éloignent moins de notre centre. Elles sont plus précieuses aussi, pour la même raison.
L’immobilité fait naître la souffrance
Il y a la souffrance aussi, d’une efficacité redoutable pour river au présent et empêcher toute divagation. La posture elle-même devient douloureuse à mesure que l’immobilisation dure. Petit à petit, les échappées mentales, et les trouées métaphysiques reculent sous les assauts des articulations qui gémissent. À quoi peut bien servir cette douleur ? À quoi bon lui tenir tête ? La voie ne devrait-elle pas dissoudre la souffrance ? Alors pourquoi la retrouve-t-on ici, tapie dans la posture même, attendant son heure et arrondissant sa part à chaque minute qui passe ?
La souffrance ramène au corps, à la chair, à son insuffisance et à sa vulnérabilité. Elle protège de l’enthousiasme. Elle s’installait dans les jambes et variait selon la posture. Le demi-lotus me laissait une certaine tranquillité au commencement, mais devenait de plus en plus difficilement soutenable. L’une des deux jambes s’engourdissait toujours et une douleur s’emparait des muscles fessiers, qui ne faisait qu’enfler jusqu’à ce que sonne la fin. Une fois pourtant, un infime mouvement a suffi à libérer le flux du sang, que j’ai senti bouillonner jusqu’aux orteils et qui m’a délivrée de ma passion. Je n’ai pas réussi à réitérer ce petit miracle.
La posture du lotus était douloureuse dès les premières minutes, mais d’une douleur plus équilibrée. Comme elle ne devenait pas insupportable au fil du temps, elle me permettait de ne pas rester rivée à elle. Par contre, dénouer les genoux à la fin était une épreuve.
Quand le sang recommence à circuler
Apprivoiser la douleur
Petit à petit, j’apprivoisais la douleur. J’apprenais comment elle naissait, comment elle se développait, les limites de son empire et la manière de la traiter. On peut l’ignorer, mais au bout d’un moment il ne reste d’autre choix que de l’accueillir. Elle ne prenait jamais toute la place et évoluait en camaïeu à mesure que je traversais zazen.
C’est pratiquement toujours elle qui gagnait, peut-être parce que je suis très novice. La douleur se faisait de plus en plus impérieuse, et mécaniquement, l’attention au présent refluait au profit de l’attente de la fin de la souffrance. Les dernières minutes étaient une bataille pathétique, dont je ne savais même pas si j’étais censée la mener. J’étais alors bien loin des images d’épinal d’absorption mystique dans la méditation.
J’aurais dû poser la question de cette souffrance : est-elle nécessaire ? Disparaît-elle avec la pratique ou est-elle la compagne nécessaire de toute discipline ? Y-a-t-il à lutter contre elle, à trouver des stratégies qui permettent de la faire refluer et de rester tranquille, ou est-elle une sorte d’auxiliaire désagréable mais nécessaire ? A-t-elle un sens ?
Une plénitude rare
Certains moments ont tout de même été pour moi d’une plénitude rare. Toute l’expérience a eu une intensité et une richesse que je n’ai pas seulement imaginées. Tout s’imprimait comme en une cire d’une extrême mollesse, disponible et presque sans épaisseur propre. L’existence était tendre et vulnérable.
Dans la dernière partie du zazen, la godo (c’est-à-dire, l’enseignante) prenait la parole. Sa voix venait chercher chacun au fond du silence où il reposait, et nous prenant par la main, nous ramenait à nous. Serties par la profondeur du silence, ses paroles résonnaient, toujours ajustées à l’expérience intérieure que nous venions de traverser.
Enfin, le gong était frappé et je m’ébrouais comme au sortir du sommeil, quoi que ce soit en un sens exactement l’inverse : d’une forme étrange de veille on revenait à l’endormissement habituel de la conscience dans l’action, le pratique, la conversation, les projets.
Zazen a quelque chose de tectonique. En surface rien ne change vraiment : la réalité est réhaussée peut-être, plus contrastée et d’une palette plus douce. Dans les profondeurs pourtant, il y a comme un magma vide, qui racle, craque et coule.
Ce témoignage t’a intéressé ? Viens en parler dans les commentaires !
Pour témoigner sur Madmoizelle, écrivez-nous à :
jaifaitca@madmoizelle.com
On a hâte de vous lire !






















![Copie de [Image de une] Horizontale (84) Copie de [Image de une] Horizontale (84)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/12/copie-de-image-de-une-horizontale-84-768x432.jpg?resize=300,350&key=30319f9e)


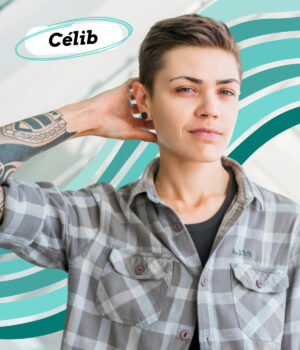




![[Image de une] Horizontale (27) [Image de une] Horizontale (27)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/image-de-une-horizontale-27-768x432.jpg?resize=300,350&key=19a71e0d)
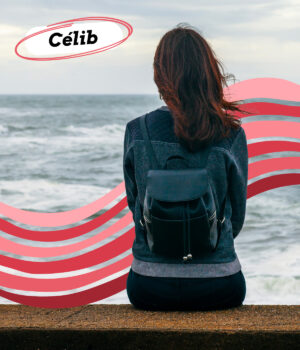
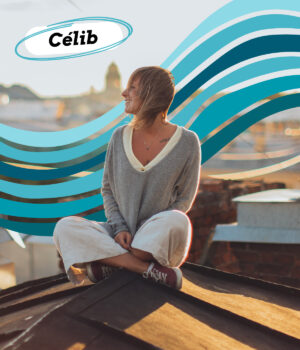



Les Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaire sur cet article.