« Aux écorchés, aux ambitieux, à tous ceux qui se reconnaîtront, et aux miens pour toujours. »
C’est avec ces quelques mots que Nesrine Slaoui ouvre Illégitimes, son premier ouvrage paru aux éditions Fayard en janvier 2021. À 26 ans, la jeune femme pourrait sembler privilégiée : après des études brillantes à Sciences Po, elle s’est lancée dans le journalisme et cumule des expériences chez Loopsider ou encore France Télévisions.
Mais ce n’est pas un long fleuve tranquille qu’a couché sur le papier Nesrine Slaoui en écrivant Illégitimes pendant le confinement de mars 2020 — qu’elle a passé chez ses parents, tous deux d’origine marocaine. C’est le fleuve tumultueux d’une fille d’immigrés qui s’est battue pour devenir « transfuge de classe », tout en sachant que beaucoup d’autres n’auront pas sa chance ; c’est le cri du cœur d’une jeune femme qu’on a menée à croire qu’elle n’est pas légitime.
Illégitimes, d’une fille d’immigrés à une autre
On reproche parfois aux critiques de n’être pas objectives. Mais l’art n’a rien d’objectif : il touche, profondément, à notre subjectivité, façonnée par notre vécu unique, par la somme de nos souvenirs, de nos peines et de nos joies.
Permettez-moi donc de vous parler du mien, de vécu, afin de comprendre tout ce qu’il y a de personnel dans mon rapport à Illégitimes — un livre qui m’a touchée comme rarement.
C’est que je suis, moi aussi, une fille d’immigrée. Je n’ai pas la même vie que Nesrine Slaoui : ses deux parents sont maghrébins, alors que je suis née d’une mère marocaine et d’un père français. Elle a grandi dans une barre d’immeubles de la banlieue d’Apt, moi dans une agréable maison drômoise. Elle a, par son parcours, marqué beaucoup de « premiers pas » dans sa famille, alors que les deux pans de la mienne (en France comme au Maroc) sont dans la classe moyenne à supérieure, avec pas mal de diplômes à accrocher au mur.
Mais tant de choses me lient à Nesrine Slaoui. C’est parce que des voix comme la sienne étaient ignorées par les maisons d’édition que je n’ai jamais réussi à me passionner pour la rentrée littéraire : tous ces romans de vieux beaux blancs, privilégiés, se lamentant sur les malheurs depuis leurs cossus appartements parisiens ou leurs maisons de famille dans les Landes ! On me promettait une analyse passionnante de la vie, et je me retrouvais face à des récits qui n’avaient rien de commun avec ma réalité.
Alors que quand Nesrine Slaoui parle des plats concoctés par sa grand-mère, qui vit dans un petit appartement près de chez ses parents, elle évoque aussi une part de ma vie.
« […] des spécialités marocaines : du salé et du sucré disposés avec soin, en fleur, sur la table du salon. Le plat principal, bien plus volumineux que les autres, a sa place au centre ; un tajine de poulet avec des frites, des pois chiches ou des carottes, remplacés parfois par de la bessara, une purée de pois cassés, ou de la loubia, des haricots blancs en sauce. »
Je ne suis pas Marcel Proust, je suis une fille d’immigrée, et mes souvenirs ne se cachent pas dans des madeleines. Ils se nichent dans le goût du Hawaii, soda marocain à l’éclatante couleur jaune ; dans les épis de maïs grillés vendus sur la corniche de Casablanca ; dans les poivrons brûlés dont la peau se détache comme une mue ; dans le thé à la menthe ; dans la moiteur du hammam et l’odeur du savon noir dont mes tantes m’enduisent la peau avant de me passer le gant de crin.
Jamais, dans un « vrai livre », dans un ouvrage publié dans une grande maison d’édition et salué par les médias, je n’ai vu mentionner le tajine poulet-frites si courant au Maroc. Ce n’est qu’un exemple parmi les mille souvenirs que Nesrine Slaoui couche enfin sur le papier — des souvenirs qui, n’en déplaise aux identitaires, font bel et bien partie de la mémoire française, riche d’influences et d’origines diverses.
Illégitimes affronte la honte d’être fille d’immigrée
C’est l’un des aspects les plus délicats de ma construction, un thème si sensible que je tape ces lignes avec mille précautions, de peur de peiner ma mère et ma famille marocaine. Mais comme tout sujet tabou, celui-ci ne peut se comprendre que si on ose le regarder en face.
Je vous parle de la honte que je ressentais, plus jeune, à être fille d’immigrée. Ce racisme latent qui étendait ses tentacules dans ma psyché et me faisait parfois souhaiter d’avoir une famille qui parle moins fort, moins arabe, met moins de cumin dans ses Tupperwares, écoute Joe Dassin plutôt qu’Oum Khaltoum, et me permettrait de passer des vacances d’été au camping plutôt qu’à Casablanca.
La honte de ne pas être « normale », comme les autres Français et Françaises aux parents bien « de souche », qui semblaient, sans que mon esprit d’enfant ne comprenne pourquoi, avoir l’ascendant sur moi.
Cette honte, Nesrine Slaoui l’a ressentie lorsqu’elle est entrée à Sciences Po et que sa culture métissée s’est heurtée à celle, bien blanche, de la bourgeoisie française. Le contraste entre sa réalité et celle de ses camarades de promotion, la conscience d’appartenir à une classe inférieure, l’autrice en parle avec beaucoup de justesse.
« Tout ce dont j’avais été imprégnée durant mon enfance devenait discriminant. Personne ne m’avait prévenue. Je m’emportais dans la cuisine et pointais du doigt toute la maison autour de moi : les livres de notre bibliothèque sans les ouvrages classiques, la décoration multicolore et surchargée, la table en plastique dans le jardin. Et puis la nourriture. Les assiettes étaient trop pleines, trop grasses, trop salées.
J’expliquais à ma mère, en faisant de grandes gestes, que tout cela relevait d’une identité de classe. Parfois j’en avais honte. […]
Et puis, j’avais honte d’avoir honte. Car cette honte, c’était exactement ce que la bourgeoisie voulait que je ressente. Elle voulait que je dénigre les miens et leur mode de vie. »
En évoquant cette honte, Nesrine Slaoui marche dans les pas d’autres personnalités issues de l’immigration ayant récemment eu le courage de l’évoquer : Nabil Wakim, auteur de L’Arabe pour tous, pourquoi ma langue est taboue en France, Nadia Daam, qui a dénoncé sur Slate
sa « honte » de parler arabe… Les voix se comptent sur les doigts d’une main.
C’est pourtant un vécu commun à tant de jeunes descendants et descendantes d’immigrés, d’autant plus compliqué à formuler qu’en France, pays qui « refuse de voir les couleurs », on refuse aussi bien souvent de parler de racisme aux enfants. Il faut pourtant avoir le courage de nommer les choses, pour que les futures Mymy et Nesrine de ce pays sachent qu’elles n’ont pas à avoir honte de leurs plats relevés, de leurs décorations colorées et des notes d’oud qui virevoltent dans leurs écouteurs.
Illégitimes, la violence de classe mise en lumière
Nesrine Slaoui parle « d’identité de classe », car c’est bien là le sujet d’Illégitimes : la violence de classe, étroitement liée au racisme, sous-tend la colère exprimée par l’autrice. Et ça a commencé, pour elle, dès la fin du lycée, lorsqu’elle a rejoint une promotion d’élèves bien plus aisés qu’elle :
« Être bourgeois, c’est […] une culture générale valorisée par les grandes écoles, un ensemble de savoirs, de savoir-être, de savoir-faire et de goûts qui n’ont rien de spontané. C’est une construction qui se pérennise dans le temps, léguée avec le reste du patrimoine de génération en génération. Et l’acquisition de cet ensemble ne peut pas se faire sans argent.
[…] Ces différences sociales ne seraient pas dérangeantes si elles ne fabriquaient pas des inégalités. Si la réussite scolaire ne dépendait pas des pratiques à l’extérieur de l’école, peu importerait que vous ayez vu tous les ballets de Tchaïkovski ou des concerts de Patrick Sébastien. Mais la réalité est que pour changer de classe sociale, il faut épouser ses pratiques. »
Et la jeune femme d’expliquer qu’en classe prépa, elle notait en marge de ses cours toutes les références — films, livres, expositions — qui lui manquaient, affirmant : « Je ne me suis jamais sentie aussi bête et incompétente ».
Ce que Nesrine Slaoui dénonce dans Illégitimes, c’est un « ascenseur social » illusoire, sévèrement rouillé : devenir « transfuge de classe », comme elle, ne peut s’accomplir qu’au prix d’immenses sacrifices personnels. Les dés sont pipés dès le départ, et chaque discrimination (le racisme, le sexisme…) ne fait que déséquilibrer davantage la balance.
C’est un discours qui parlera à toutes celles et ceux à qui on a voulu faire croire que leur juste place était en bas de l’échelle ; dont on a voulu étouffer les rêves, faute d’avoir le « bon » rang dans la société. Nesrine Slaoui a réussi, mais elle ne prétend pas que tout le monde peut y arriver : elle sait que son parcours est une anomalie statistique. Et plutôt que de changer de dés, la jeune femme propose carrément d’envoyer valser les règles.
« Je n’aurai, en tant que femme maghrébine, jamais la légitimité d’un homme blanc cadre de plus de 50 ans, je ne jouirai jamais du même pouvoir. Tant mieux d’ailleurs car il est bien trop archaïque. Je ferai simplement ce que j’ai à faire, comme j’estime devoir le faire et je tâcherai alors de jouir d’être à jamais illégitime. »
Dans son interview pour madmoiZelle, Nesrine Slaoui développe d’ailleurs le sujet de la violence de classe :
Voir cette publication sur Instagram
Illégitimes, une lettre d’amour aux parents immigrés et aux classes populaires
Rassurez-vous : Illégitimes n’est pas un livre sur la honte. C’est, peut-être avant toute chose, un cri d’amour.
De chaque ligne déborde l’amour que Nesrine Slaoui voue à ses parents, à sa grand-mère, à ses racines, à sa culture populaire, à son quartier. Face à une bourgeoisie qui aurait voulu la mener à renier ses origines, la jeune femme oppose une farouche tendresse.
Ce qui l’a construite, ce ne sont pas ces gens privilégiés ayant tout tenté pour que les personnes comme elle n’accèdent pas aux mêmes statuts qu’eux. Ce qui l’a élevée, ce n’est peut-être pas du Rousseau ou du Voltaire, mais c’est la pugnacité de ses parents, leur sacrifice dans des métiers manuels, dévalorisés par la société, pour que leur fille puisse rêver d’ailleurs.
Nesrine Slaoui n’exprime pas l’envie, à la moindre seconde, de changer son parcours. Qui elle est, cette jeune femme française, maghrébine, banlieusarde, diplômée et journaliste, ça n’existe que si chaque facette est en place. Et c’est grâce à de telles paroles qu’on pourra, ensemble, construire ce monde où nous jouirons d’être « à jamais illégitimes ».
Alors merci, Nesrine, d’avoir apporté ton chapitre à ce nouveau roman français que tant d’autres rédigent à tes côtés, et qui viendra bientôt supplanter la poussiéreuse légende d’une culture aussi blanche que bourgeoise.
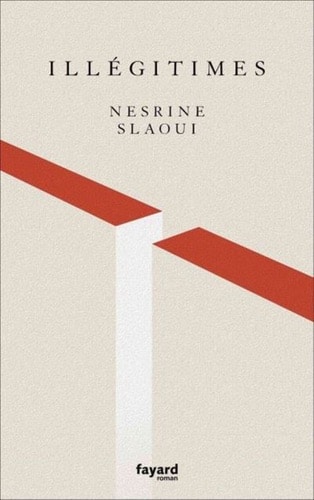
Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos podcasts. Toutes nos séries, à écouter d’urgence ici.
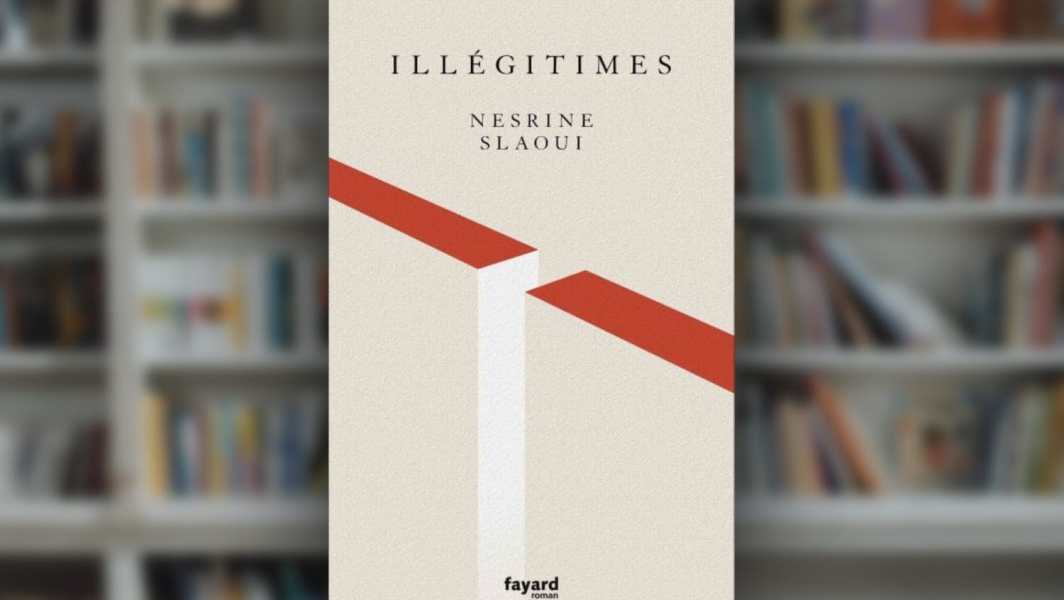







![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-15t163147788-768x432.jpg?resize=300,350&key=c0e2a724)
![[Image de une] Horizontale (24) [Image de une] Horizontale (24)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/image-de-une-horizontale-24-768x432.jpg?resize=300,350&key=bd0cfdc3)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-16t173042478-768x432.jpg?resize=300,350&key=e6ae1102)


![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-08-27T142659.508 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-08-27T142659.508](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/08/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-08-27t142659508-768x432.jpg?resize=300,350&key=2861f644)

![[Image de une] Horizontale (16) [Image de une] Horizontale (16)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/07/image-de-une-horizontale-16-768x432.jpg?resize=300,350&key=f4541c4a)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-06-24T161828.941 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-06-24T161828.941](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/06/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-06-24t161828941-768x432.jpg?resize=300,350&key=366d7096)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/05/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-05-22t164945311-768x432.jpg?resize=300,350&key=638f1da8)


![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-28t150710132-768x432.jpg?resize=300,350&key=0dbf06ef)
![[Image de une] Horizontale (26) [Image de une] Horizontale (26)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/image-de-une-horizontale-26-768x432.jpg?resize=300,350&key=3f4065eb)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-17T105447.652 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-17T105447.652](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-17t105447652-768x432.jpg?resize=300,350&key=46422db2)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-19T102928.481 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-19T102928.481](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/09/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-09-19t102928481-768x432.jpg?resize=300,350&key=c8084f21)
![[Image de une] Horizontale (18) [Image de une] Horizontale (18)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/08/image-de-une-horizontale-18-768x432.jpg?resize=300,350&key=1a90e2f6)












Les Commentaires