Il y a quelques années, lorsqu’on me complimentait sur ma capacité à porter des choses lourdes, je répondais chaque fois :
« C’est normal, j’ai grandi dans une ferme ! »
Voici donc ma petite histoire !
À l’aventure !
J’avais 8 ans quand j’ai surpris du haut de l’escalier une conversation entre mes parents et leurs amis, à propos de notre futur déménagement en Lozère pour la formation d’éleveur que mon paternel souhaitait suivre. Quuuoooiii ?
Du haut de mon mètre vingt, je hurlais, pleurais, tempêtais : POURQUOI ? Je m’entends encore chouiner à ma mère :
« Mais qui c’est qui ira avec Paul (mon voisin) à l’école tout les matins ? Il va être toooouuuut seeeeuuul si on déménaaaageuuh ! »
Et puis bon, comme pour beaucoup de choses quand on est enfant, c’est vite passé et je me suis retrouvée à Florac, à visiter l’école primaire (qui comptait soixante élèves de la crèche au CM2… de la crème glacée à mes yeux de semi-adulte), puis l’appartement où se trouvaient déjà certaines de nos affaires (des cachottiers, ces parents !), et en un rien de temps c’était le mois de mars, et nous étions lozériens d’adoption.
Quand mon père était à l’école, maman était tout le temps à la maison, ce qui changeait. Mais à part ça, ce n’était pas franchement l’aventure. Il y avait moi, mes deux frères, et le chien comme animation principale, qui détruisait le papier peint du couloir dès qu’il était tout seul.

Mais il nous tenait chaud, ça compense.
Enfin, c’était sans compter sur l’été et les stages obligatoires de mon père un peu partout dans la région. On était hébergés parce que les trajets étaient trop contraignants, rapport à la distance démesurée entre les lieux en Lozère. La Lozère, c’est un peu mon Canada quoi !
Sans en avoir conscience, j’ai découvert de nouveaux modes de vie : il y avait ce couple qui avait choisi d’envoyer leurs enfants en pension dès la sixième et ne les faisait revenir que pour les vacances, cet autre famille qui faisait l’école à la maison à leurs quatre enfants, ou encore cette maman qui allaitait encore son fils de huit ans. J’ai trait mes premières chèvres sans me douter que c’était loin d’être les dernières, j’ai appris à connaître la nature et j’ai eu mes premiers émois fromagers. Papa a eu son diplôme, et maman est tombée enceinte de ma première petite sœur.
À lire aussi : Frères et soeurs : des liens qui comptent ?
Sauf qu’après avoir visité sans succès une trentaine de ferme (dont l’une à laquelle on accédait grâce à une tyrolienne), nous avons décidé de retourner en Camargue dans la maison que nous avions gardée !
Des chèvres ? En Camargue ?
Nous y sommes devenus propriétaires du haut d’une colline à l’abandon. Enfin, nous l’avons repérée, mais en attendant d’avoir l’argent il fallait d’abord construire une serre dans notre grand jardin — à moi pelles et marteaux ! On s’est mis à cultiver des haricots verts pour les vendre au marché (et aider au financement pour ne pas faire un emprunt tout de suite), des milliers de petits haricots verts…
Après deux mois de travaux journaliers pour mes parents, étant la fière recrue des soirs et week-ends, et alors que j’étais une nouvelle fois grande sœur, j’ai vu arriver nos premières chèvres ! Elles étaient trente, et elles nous avaient été données contre bons soins par une éleveuse en difficulté. Je les aimais déjà !
Il y a ensuite eu la première traite, le goût du lait et la fabrication de fromages qu’on ne pouvait pas vendre sans autorisation (pour laquelle il fallait respecter une réglementation bien précise qui demandait des moyens), mais qu’on vendait quand même parce que…
- Ceux qui avaient goûté refusaient les « cadeaux » et voulaient payer (que demande le peuple ?).
- Les cobayes c’était nous, et si nous avions été malades nous n’aurions certainement pas fait goûter les fromages à d’autres personnes.
- Les analyses de fromages mensuelles étaient toujours clean.
Pour Pâques, on a aussi vendu des cabris. Nous avons eu des premiers succès prometteurs, mais il ne fallait pas croire que le fromage allait nous permettre de devenir millionnaire en un an (même après sept ans, on n’est sûr•e d’avoir un salaire), et ce n’était pas pour ça qu’on le faisait.
Les vacances d’été sont arrivées, et l’élevage a commencé à demander beaucoup de travail ; les parents étaient peu disponibles, c’était un peu tendu mais on a géré. À la rentrée, j’étais devenue une parfaite petite ménagère : entre le linge, le ménage, les repas et les frères et sœurs, je maîtrisais tout — ce qui me semblait et me semble encore aujourd’hui tout à fait normal. Les parents ne sont pas des super humains, et je n’avais pas encore l’âge d’aider pour les chèvres.

J’avais 11 ans et tout plein de responsabilités que j’assumais avec plaisir quand on est enfin devenus propriétaires de la colline, un peu par obligation (on n’a pas le droit d’élever des animaux dans son jardin à moins de 50 mètres des habitations voisines), et beaucoup par envie de s’agrandir.
À lire aussi : Anaïs s’en-va-t-en guerre, la jeune bretonne qui refusait de subir sa vie (MÀJ)
La colline
A alors commencé la période chaotique pendant laquelle il fallait s’occuper des chèvres toujours dans le jardin, du fromage dans la cave et de la colline, la fameuse colline à un kilomètre de la maison qui était en friche. Il était impossible de poser une serre ; il y avait tellement de végétation qu’il n’y avait pas de chemin.
Un incendie une semaine après l’acquisition (il s’est murmuré qu’il avait été provoqué par jalousie) a simplifié la tâche en détruisant la végétation, mais modifié dans le même temps tous nos projets. On a posé la serre sur la colline six mois plus tard, quand c’était à nouveau l’été. Le troupeau a traversé le village (c’était beau !), mais on a arrêté de faire du fromage (n’ayant toujours pas la fameuse autorisation) ; nous devions construire un bâtiment aux normes pour les chèvres — et pour obtenir l’autorisation pour le fromage. C’est la demande de permis de construire qui ramait, puis l’autorisation pour l’élevage, mais pas pour l’habitation.
Pendant que la demande de prêt ramait également, on a récupéré des anciens poteaux EDF, des fenêtres, des planches et des isolants, et c’était parti pour la construction de la future maison, une cabane en bois de vingt mètres carrés à laquelle on a ajouté notre vieille caravane (pour faire ma chambre). Il n’y avait pas l’eau courante, la douche se faisait à la cuve des chevaux le soir (quand elle avait chauffé toute la journée au soleil), nous ne faisions de machines qu’une fois par semaine, on utilisait un groupe électrogène et des toilettes à l’air libre, et nous n’avions même pas de frigo ! Et c’était bien ! Nous aimions tous ce que nous faisions, notre environnement, la nature. Cette vie rudimentaire ne nous gênait pas.
Le prêt a fini par nous être accordé ; on a donc commandé le bâtiment en bois livré en kit sur Internet et on a tout construit. Pas loin d’un an plus tard, la production était lancée : c’était les premiers marchés, la vente à la ferme, les visites éducatives avec les écoles. On a accueilli des cochons pour qu’ils mangent le petit lait (polluant la nappe phréatique), et très vite nous nous sommes tournés vers le bio. On avait aussi des chevaux, des poules… C’était génial !
À lire aussi : Comment se mettre au bio quand on est fauchée ?
Le mode de vie dans la cabane est par contre devenu difficile à gérer : il fallait s’agrandir. Pour l’hiver nous sommes donc retournés dans la maison, en attendant d’acheter un puis deux mobil-homes deux ans plus tard.
Une activité difficile
Quand l’élevage a fêté ses trois ans, les clients étaient fidèles, mais c’était quand même la galère. Il n’y avait pas de créneau de commercialisation, la grande distribution rachetait 33 centimes le fromage de 60g pour le vendre 2,20€, et les restaurateurs nous faisait parcourir parfois 80 km pour 15 fromages… ce qui faisait que l’argent gagné ne couvrait pas le gasoil du trajet.
À cette époque, une journée-type, c’était la traite de 4h à 6h, le chargement jusqu’à 6h30 maxi, l’arrivée sur le marché avant 7h30, le retour à la fromagerie à 14h, le rangement jusqu’à 15 heures, le repas, à 17h30 la préparation des fromages avec le lait de la veille au soir et du matin, enfin la traite à nouveau et les deux heures de balade des animaux. Avec quatre enfants, c’était impossible de faire des marchés tous les jours. On n’avait donc pas grand-chose, mais on kiffait, et participer autant que je le pouvais aux activités et aux tâches ménagères était un plaisir.
Nous consacrions la plupart de notre temps à la ferme, mais cela ne m’empêchait pas d’inviter parfois des amis – même si je passais plutôt du temps à faire des cabanes avec mes frères, à monter à cheval ou à essayer en vain de capturer le renard qui maltraitait le poulailler.

La fin
Cinq ans après les débuts, nous ne pouvions toujours pas construire de maison sur place. Mes frères jumeaux sont arrivés, nous étions huit à la maison. C’était le déménagement tous les six mois, à chaque hiver, même si il y avait maintenant une douche, des toilettes et un frigo dans notre habitation sur la colline. C’était de plus en plus tendu à la maison, parce qu’on comptait le moindre centime, et qu’il n’y avait pas eu un jour de vacances depuis l’arrivée des chèvres dans le jardin, qui étaient alors 120.
Puis papa a dû se faire opérer, et j’ai pris le relais à « plein temps » avec maman, le matin avant les cours, le soir en rentrant, et tout le temps libre que j’avais allait à ma famille et à la réussite de notre entreprise. J’étais capable de tout gérer sur l’exploitation toute seule. J’avais quinze ans, et je voyais bien que mes parents n’allaient pas très bien ; papa a repris le travail mais petit à petit il s’est totalement isolé du quotidien familial, auquel il n’apportait presque plus que de la violence…
Il est parti quand j’avais dix-sept ans. Ma mère a continué avec mon frère, nos stagiaires les plus motivés (qu’on hébergeait) et moi. Nous avions des projets, comme l’ouverture d’un camping à la ferme et de privilégier la ferme éducative à la production importante, sauf que nous n’avions plus un radis. En réduisant le troupeau, donnant les chevaux, vendant un mobil-home et louant l’autre, on a tenu deux ans. Et puis papa a récupéré son matériel car il avait besoin d’argent, et puisque maman ne pouvait plus payer les dettes, papa voulait plus d’argent, pressait pour son dû. Il a alors fallu capituler et vendre… mais c’était un merveilleux voyage de dix ans.
Et après ?
J’ai passé un bac médico-social parce que je voulais soigner les gens (et surtout mon père), mais j’ai changé de voie pour attaquer une licence de droit (je voulais protéger tout le monde après avoir voulu soigner le problème papa), pour l’abandonner au bout de trois mois et finir par faire une saison (de février à août) en cuisine à la mer, suite à laquelle j’ai décidé de retourner à l’école parce que l’idée d’être commis toute ma vie à 85h par semaine et sans responsabilités me faisait déprimer !
J’ai donc passé un BTS en cuisine en juin 2014, et je vais poursuivre avec un BTM pâtisserie en apprentissage dans le courant de l’année ; à terme j’aimerais ouvrir mon entreprise car j’ai gardé le goût d’être son propre patron, de se gérer et d’être autonome.
La cuisine et la pâtisserie m’ont séduite principalement par le travail des produits frais, bruts, la connaissance de leur production et utilisation qui se retrouve en fromagerie ou élevage ; pour avoir du bon lait, il faut nourrir les animaux avec des aliments de qualité, et pour avoir du bon fromage il faut du bon lait et des animaux sains. C’est la même démarche que celle de la ferme !
Grâce à cette expérience, j’ai la capacité d’énerver mes patrons profondément : mon esprit aguerri aux galères fait que j’identifie très vite les dysfonctionnements professionnels, et je ne sais pas le garder pour moi… surtout si j’ai une potentielle solution !
En ce qui concerne mes parents, je ne sais pas ce que fait mon père, parce que je ne lui parle plus après les violences dont j’ai été témoin. Ma mère s’occupe quant à elle de mes petits frères en attendant de reprendre une formation pour devenir formatrice dans le social (avant la ferme, elle était assistante sociale).
À lire aussi : Comment j’ai décidé de fuir mon père toxique
Ce que j’ai appris
Je sais aujourd’hui que je ne regrette pas la façon dont j’ai grandi, et même que j’en suis très fière. Responsabilisée très tôt, j’ai certes vécu une adolescence loin des revendications de mon âge et sauté pas mal d’étapes entre l’enfance et l’âge adulte, mais je le vis très bien. J’ai appris que la solidarité est essentielle si on veut avancer, que l’argent n’a pas de sentiments, et qu’il fait faire des choix stupides.
J’ai appris que le bonheur n’équivaut pas à la hauteur de son compte en banque, et que le cadre n’est pas formaté si on refuse qu’il le soit. Cette ferme et ma famille nombreuse sont à mes yeux la meilleure des écoles, où j’ai appris le respect de l’autre, des animaux et de ce qui m’entoure, la valeur du travail, celle de l’argent, et surtout la débrouille.
Et puis du coup je sais aussi faire du rodéo sur un cochon, attraper un dindon, couper les ongles d’une chèvre et j’ai le cœur rempli de chevreaux à qui je donne le biberon, les papilles comblées, la tête remplie de rencontres, et une certitude : c’était le meilleur fromage de chèvre de tous les temps !
À lire aussi : J’ai testé pour vous… le Salon de l’Agriculture
Pour témoigner sur Madmoizelle, écrivez-nous à :
jaifaitca@madmoizelle.com
On a hâte de vous lire !
Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2023-11-24T103053.768 Copie de [Image de une] Horizontale – 2023-11-24T103053.768](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2023-11-24t103053768-300x300.jpg?resize=135,187&key=9b92274e)




![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/05/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-05-22t164945311-768x432.jpg?resize=300,350&key=638f1da8)


![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-28t150710132-768x432.jpg?resize=300,350&key=0dbf06ef)

![[Image de une] Horizontale (26) [Image de une] Horizontale (26)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/image-de-une-horizontale-26-768x432.jpg?resize=300,350&key=3f4065eb)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-15t163147788-768x432.jpg?resize=300,350&key=c0e2a724)
![[Image de une] Horizontale (24) [Image de une] Horizontale (24)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/image-de-une-horizontale-24-768x432.jpg?resize=300,350&key=bd0cfdc3)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-16t173042478-768x432.jpg?resize=300,350&key=e6ae1102)









![Copie de [Image de une] Horizontale (84) Copie de [Image de une] Horizontale (84)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/12/copie-de-image-de-une-horizontale-84-768x432.jpg?resize=300,350&key=30319f9e)



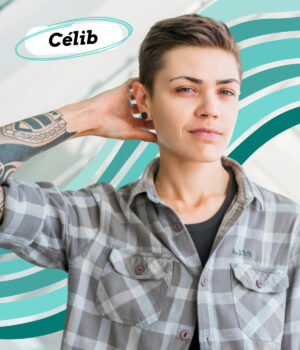







Les Commentaires
Je n'ai pas vécu dans une ferme mais à la campagne. Et j'ai beaucoup de mal à vivre en ville, j'ai besoin des grands espaces, j'ai besoin d'être en contact avec les animaux, j'ai besoin de forêts, de champs, de chemins, de rivières, etc. Alors, pour mes études, je suis partie dans plusieurs grandes villes mais dès que je le pouvais je rentrais chez mes parents ou j'allais faire une escapade en pleine nature!