S’il y a bien une chose que j’ai apprise durant mes années d’études, c’est que pendant la période de révision pré-partiels, TOUT semble mieux que réviser. C’est ainsi que je me suis déjà retrouvée à nettoyer ma douche à la brosse à dents à 2h du matin, que j’ai englouti deux saisons de Breaking Bad en un laps de temps beaucoup trop court, et que je me suis mise à Friday Night Lights sur les conseils d’un pote sériephile, alors que le pitch ne me tentait pas vraiment (faut dire que le sport et moi, ça fait douze).
https://youtu.be/BOPgwZ9hj00
Friday Night Lights ou le sport comme seul espoir d’une vie meilleure
Friday Night Lights se déroule au Texas, à notre époque, dans une petite ville (fictive) appelée Dillon. Il y a un lycée, un concessionnaire automobile, un diner, un bar où des groupes country viennent remuer la poussière le week-end… et un stade, pour l’équipe de football américain du lycée, les Panthers — qui jouent donc le vendredi soir.
Eric Taylor est coach de cette équipe sur laquelle repose tous les espoirs de cette bourgade. Le sport, c’est un des seuls moyens pour les jeunes de changer de vie, d’aller à l’université, dans une autre ville, peut-être même un autre État, plutôt que de prendre racine pour remplacer Papa à la caisse de la station-service et se bourrer la gueule à la mauvaise bière tiède tous les soirs, à l’arrière du pick-up, sous les étoiles.
À travers un casting choral, composé d’Eric Taylor, de sa femme Tami, conseillère au lycée, et de sa fille Julie, mais aussi de divers adolescents liés d’une façon ou d’une autre aux Panthers, Friday Night Lights retranscrit parfaitement les émotions qui animent des personnages se sentant souvent emprisonnés dans Dillon. La série touche à des sujets formant le coeur de la vie moderne aux États-Unis : le père militaire, absent car toujours en mission dans un désert ou un autre, l’ascenseur social fichtrement rouillé, l’alcool et les drogues qui circulent sous le manteau, la religion qui enferme ou libère…

Une famille en or et une tendresse infinie
Soyons clair, j’adore mes parents, ils sont au top, et je ne les échangerais pour rien au monde. Bisou Maman.
MAIS.
J’avoue que si je devais les échanger contre des parents de fiction, je prendrais Eric et Tami Taylor, sans la moindre milliseconde d’hésitation. C’est le couple le plus réaliste et le plus touchant que j’ai vu à la télé, plein de patience, d’inquiétudes compréhensibles, de maladresses parfois. Ils ne prennent pas leur fille adolescente pour une idiote, mais ne se gênent pas non plus quand il faut lui faire remarquer qu’elle n’a de la vie qu’une connaissance limitée. Ils aiment les jeunes dont ils ont la charge, savent leur parler d’adulte à adulte lorsque la situation est grave, sans oublier leur fragilité. Ils s’aiment l’un et l’autre, sont parfois ronchons, parfois injustes, mais se parlent toujours avec une honnêteté et une sincérité qui fait plaisir à voir. Ils sont à la fois amants, amoureux, complices et meilleurs amis, et si c’est pas ça le couple idéal alors je ne m’appelle plus Mymy.

La série est également pleine de tendresse pour tous ses personnages, qu’ils soient « gentils » ou non. On comprend pourquoi Tim Riggins le bad boy met en danger ses capacités sportives en s’enivrant tous les jours, d’où viennent les failles de Lyla, la fifille-à-son-papa qui semble (à tort) si « parfaite », les raisons derrière la discrétion de Matt Saracen, qui s’occupe de sa grand-mère malade en l’absence de son père, le désespoir de Tyra, la « fille facile » qui ne rêve que de quitter Dillon…
Aucun personnage n’est unidimensionnel ou caricatural, chacun est un•e humain•e à part entière, avec toute sa complexité, toutes ses nuances, toutes ses mauvaises et bonnes actions. D’une certaine façon, on les aime tous, on est forcément touché•e•s par ce qui leur arrive, par l’injustice de leur situation, leurs luttes pour une vie meilleure… et le désespoir qui leur fait parfois baisser les bras.

La « vraie vie » aux États-Unis, loin des métropoles fantasmées
Trop souvent, les séries américaines se concentrent sur la vie pas très réaliste de personnages fauchés-mais-vivant-dans-des-lofts-immenses à Manhattan, Chicago, Los Angeles ou Washington. À l’image de Rectify, Friday Night Lights est un de ces rares shows « du terroir » qui prennent le parti d’une petite ville paumée et qui développent épisode après épisode les paysages stupéfiants des États-Unis.
Le rythme prend son temps, les intrigues peuvent se déplier dans toutes leurs nuances et leurs implications, les personnages errer au coeur des interminables champs de maïs ou le long des trottoirs de Dillon. C’est une vie dont on parle peu, une population un peu laissée-pour-compte dans le cinéma et la télévision (sauf quand il s’agit de faire des films d’horreur sans trop de budget) : celle qui vit loin des mégalopoles, dont l’horizon n’est barrée par aucun gratte-ciel, et qui préfère aux voitures hybrides le bon vieux pick-up retapé par tonton sous le soleil de juillet.

Rythmée par la délicate bande-originale comportant de nombreux morceaux du groupe Explosions In The Sky, Friday Night Lights nous permet de plonger dans la petite ville de Dillon, nous accueille avec un peu de méfiance, car « on n’est pas d’ici », mais finit par nous faire une place dans tous les centres névralgiques de cette bourgade qui ne fera jamais la une des journaux. Et c’est, finalement, bien plus humain que la chasse au serial killer prémâchée dans les séries policières, ou que les intrigues amoureuses d’une bande de presque-trentenaires.
Allez, un dernier argument pour la route ? Friday Night Lights est la série préférée de Leslie Knope. Si ça ne vous convainc pas, je ne peux plus rien faire !
- L’intégrale de Friday Night Lights est disponible en DVD sur Amazon et dans les magasins culturels habituels.
Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.




![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T170053.120 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T170053.120](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-30t170053120-300x300.jpg?resize=135,187&key=5b6a0448)



![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/05/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-05-22t164945311-768x432.jpg?resize=300,350&key=638f1da8)


![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-28t150710132-768x432.jpg?resize=300,350&key=0dbf06ef)

![[Image de une] Horizontale (26) [Image de une] Horizontale (26)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/image-de-une-horizontale-26-768x432.jpg?resize=300,350&key=3f4065eb)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-15t163147788-768x432.jpg?resize=300,350&key=c0e2a724)
![[Image de une] Horizontale (24) [Image de une] Horizontale (24)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/image-de-une-horizontale-24-768x432.jpg?resize=300,350&key=bd0cfdc3)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-16t173042478-768x432.jpg?resize=300,350&key=e6ae1102)









![Copie de [Image de une] Horizontale (84) Copie de [Image de une] Horizontale (84)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/12/copie-de-image-de-une-horizontale-84-768x432.jpg?resize=300,350&key=30319f9e)



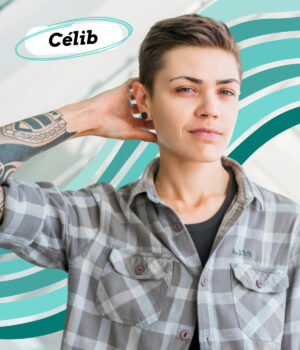







Les Commentaires