— Article initialement publié le 8 mai 2016
Mon père est arrivé en France vers la fin des années 1970, encouragé par sa mère et son beau-père (qui y étaient avec ses petits frères), parce qu’il y avait largement de quoi travailler ici (cf. les politiques ayant favorisé la migration pour satisfaire les besoins de l’économie française).
À lire aussi : Nos Racines — Soley, Française d’origine libanaise
Il était alors déjà marié avec ma mère et est donc venu seul, juste pour travailler après son service militaire et toutes sortes d’emplois temporaires (maçon, vendeur sur les marchés…).
Il ne trouvait pas de travail durable pour nourrir sa famille — ma sœur était déjà née.
Il a occupé beaucoup d’emplois dans la construction à travers toute la France : il a participé à la construction d’universités, de restaurants et autres grands bâtiments durant plusieurs années pour envoyer des sous à ma mère.
Il a fait des allers-retours jusqu’à ce qu’il décide de profiter du regroupement familial au début des années 1980, après avoir obtenu la nationalité française.

Entre-temps, mes deux grands-frères sont nés là-bas.
Ils ont décidé de s’installer en Alsace, près de mes grands-parents paternels. La famille s’est agrandie, et je suis née un frère et une sœur plus tard, en 1991.
Nous avons tous la double nationalité française/turque, par le droit du sol ou par le droit du sang.
Franco-turque : une enfance plus française que turque
Un peu avant ma naissance, mon père a commencé à construire une maison dans une petite ville de 20 000 habitants dans un quartier très calme. J’ai donc grandi au milieu de « Français•es de souche ».
Ma mère a été absente durant mon enfance à cause de divers problèmes de santé, et mon père ayant ouvert son propre commerce (je vous le donne en mille, c’était un Döner), il n’était pas très présent, faisant des journées de seize heures non stop sans aucun jour de congé.
J’étais la petite dernière de la famille, et l’écart d’âge avec mes cinq frères et sœurs était important.
Les trois années qui me séparaient de mon aîné direct étaient suffisantes pour qu’on passe plus de temps à se taper dessus plutôt qu’à tisser des liens fraternels (comme l’a dit Dewey, « Moi, j’aime pas mes frères, moi j’aime que MOI ! »).

Durant ma petite enfance, je passais par conséquent ma vie dehors avec les enfants de mon voisinage, à jouer dans le parc et à des jeux de société (pendant les vacances d’été, c’était du 8h/23h !).
C’était le bon temps : on parlait peu ou pas de mes origines, ce n’était pas important, on était juste copains pour pouvoir jouer ensemble.
Contrairement aux autres enfants d’origine turque dans les environs (il y avait une diaspora importante), je n’ai donc pas grandi dans la communauté turque, et on m’a toujours dit plus tard que je n’étais pas comme les autres Turques.
Je regardais plus la télé française que la turque (insolite : nous avions un « salon télé turque » et un « salon télé française ») : en somme, la culture française est dominante chez moi, même si la culture turque était présente.
On parlait turc avec ma mère puisqu’elle ne parle pas beaucoup le français, et parfois avec mon père. On est même quelques fois allés à la mosquée, sans compter les deux semaines annuelles dans des Club Med turcs pendant mes années collège.
Mais il n’y avait finalement pas beaucoup de monde pour me transmettre l’héritage turc, ce que je regrette beaucoup aujourd’hui.
Franco-turque : scolarité et différence de traitement
Durant ma scolarité, par le hasard des choses j’étais presque toujours la seule fille d’origine turque, et j’ai donc principalement eu des amies « françaises ».
Je ne ressentais pas particulièrement de différence, à part de rares fois, souvent de la part de professeurs et parfois de camarades. Par contre, l’adolescence a été franchement compliquée. Pour qui ne l’est-elle pas?
J’avais l’impression d’être une éternelle incomprise. Je ne m’identifiais à personne, car j’étais clairement différente. Et différente en moins bien, clairement.
Étant sociable, j’avais beaucoup d’amis, même si je n’étais pas assez cool pour être dans le groupe des « populaires ».
Mais j’avais l’impression d’être une éternelle incomprise. Je ne m’identifiais à personne, car j’étais clairement différente. Et différente en moins bien, clairement.
J’ai un prénom disons « difficile » et généralement, la question « Ça vient d’où ? » suivait une demi-seconde après les présentations (que ce soit en classe ou ailleurs).
J’avais l’impression d’avoir une étiquette « DIFFÉRENTE » collée sur le front à la glue perpétuelle (cassdédi à Sirius, je te comprends bro’).

Tmtc
Une fois au collège, un camarade de classe m’a insultée de «
sale Turque ». Ça m’a franchement traumatisée, surtout que c’était pendant la récréation, devant tout le monde.
J’ai toujours eu le sentiment de ne pas être à ma place, avec des Turcs comme avec des Français, l’éternel « cul entre deux chaises ».
Mais à cette époque, j’ai bel et bien commencé à voir ma différence comme une tare, parce que cela m’empêchait d’être vue comme les autres.
J’ai toujours eu le sentiment de ne pas être à ma place, mais à cette époque, j’ai bel et bien commencé à voir ma différence comme une tare, parce que cela m’empêchait d’être vue comme les autres.
En troisième, quand j’ai dit que je voulais aller au lycée général (comme toutes mes copines) pour faire un bac ES, les profs m’ont regardée avec de grands yeux.
Je n’étais pas mauvaise élève, j’étais dans la moyenne sans travailler, mais on ne me voyait clairement pas suivre ce chemin ; j’ai vraiment eu le sentiment qu’on m’imaginait plutôt choisir le lycée professionnel comme les autres « de mon espèce ».
À lire aussi : Comment préparer sa rentrée au lycée
J’ai malgré tout pris l’option « économie et social » en seconde et j’ai eu une professeure géniale.
C’est vraiment grâce à ce cours que j’ai commencé à avoir un esprit critique et à comprendre beaucoup de chose sur la sociologie et donc aussi sur ma situation personnelle.
Ça a été un tournant : j’ai commencé à m’intéresser à la politique et à avoir des idéaux. Les débats houleux étaient mon dada et je les prenais souvent trop au sérieux, en perdant mon calme.
Je voulais faire reconnaître qu’il y avait une différence de traitement que personne ne voulait voir, y compris dans mon entourage proche et mes amies de toujours.
Pour elles, j’étais juste moi et puis c’est tout : elles n’arrivaient pas à comprendre ce que je pouvais endurer et l’influence que cela pouvait avoir, c’était presque un tabou.
Franco-turque : le racisme ordinaire et quotidien
Mon père, même s’il travaillait beaucoup, m’a toujours montré beaucoup d’attention. Il chouchoutait sa petite dernière. Il me racontait souvent comment il fallait arracher ce à quoi nous avions droit — soit l’égalité.
Lui-même a beaucoup souffert de la façon dont il a été exploité au travail (des heures jamais payées ou pas déclarées du tout, etc.), du traitement de l’administration française et de la société en général.

Il m’a parlé de ces appartements qu’il venait visiter : en le voyant, le propriétaire annonçait que « finalement, ils avaient trouvés quelqu’un ».
Il ne compte plus les difficultés, la méfiance sans cesse rencontrée et les bassesses que les gens lui ont fait parce que c’est un « étranger ».
Il m’a toujours montré qu’il fallait persévérer pour être traité•e comme les autres, à égalité. Mais il m’a également encouragée à me méfier et même à me battre.
D’ailleurs, il y a quelques mois encore, des malins ont collé un autocollant « Stop à l’islamisation » avec un minaret barré sur la porte de son local (la belle surprise du matin).
Il m’a toujours montré qu’il fallait persévérer pour être traité•e comme les autres, à égalité.
J’ai moi-même eu quelques expériences marquantes de racisme (outre les plus courantes) dans ma courte vie.
Un soir, lors de la fête de la Saint-Jean dans un village (« Venez donc brûler un tas de bois empilé pour se remémorer les bûchers de sorcières au Moyen-Âge ! »), mes amies et moi avons posé nos sacs dans un coin pour aller danser sur la piste en délire (des valses alsaciennes, faut pas déconner).
Quand j’ai voulu récupérer le mien, j’ai dû montrer ma carte d’identité à un monsieur (un adulte donc, face à une ado qui n’a rien demandé) pour prouver que c’était bien le mien. Parce que vu ma tête, j’étais forcement une voleuse…
Évidemment, mon amie à côté a pu prendre son sac tranquillement. L’humiliation publique, c’est toujours génial pour nourrir la rancœur.

Une autre fois, il y a deux ans, lors d’une promenade entre amies dans une exposition d’art sur la voie publique, on a refusé de me vendre une gaufre : le monsieur m’a gentiment dit d’un air méprisant : « J’en ai pas pour vous ! Allez à coté ! »
Je m’en voudrai toujours de ne pas avoir pas réagi et de ne pas être allée chercher les policiers municipaux qui étaient tout près.
Pour un job d’été, une amie m’avait introduite auprès de sa supérieure pour une place.
Mais quand je suis venue me présenter avec mon CV, elle m’a demandé si j’étais française, a photocopié ma carte d’identité (sans même me poser de question sur mon CV) et ne m’a jamais rappelée.
Plus tard, cette amie m’a expliqué que sa supérieure ne m’avait pas prise à cause de mes origines (elle le lui avait clairement signifié).
Des anecdotes comme celles-ci, j’en ai beaucoup. Je ne compte plus les fois où je suis la seule contrôlée dans le train.
Franco-turque : assumer ses origines
Aujourd’hui, j’assume réellement mes origines. Je sais que des gens ne pourront pas s’empêcher de m’accoler toutes sortes d’étiquettes mais j’essaie de le vivre au mieux, sans trop y penser.
Maintenant, quand on me demande d’où vient mon prénom, je réponds joyeusement de Turquie parce que je sais qu’ils ne s’y attendront pas (ou presque), que je suis différente des images préconçues vides de sens que les gens peuvent avoir.
Parfois, quand j’y pense, je déteste l’image que je peux donner aux gens étroits d’esprit, d’être le modèle de « celle qui s’est bien intégrée ».
Cela me donne envie d’affirmer mes différences. De m’exclure moi-même, comme eux voulaient faire à l’origine, sans même me connaître.
En fin de compte, je me sens aussi citoyenne du monde, car lors des quelques voyages que j’ai fait autour de la Méditerranée, on m’a prise pour une autochtone (sauf en France, bizarrement) et cela me rend fière.
Je suis d’ici et d’ailleurs.
À lire aussi : De la Grèce à la banlieue parisienne en passant par la Chine, je me sens citoyenne du monde
Le résultat de mes différences et de ce que j’ai pu subir, c’est que je mets un point d’honneur à aimer toute l’Humanité, à accepter toutes les différences et à voir l’humain avant tout, à faire preuve d’altruisme et à toujours vouloir raisonner pour comprendre l’autre, quel qu’il soit.
Bon allez, salade tomate oignons pour tout l’monde !



![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-15T103000.820 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-15T103000.820](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/05/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-05-15t103000820-300x300.jpg?resize=135,187&key=fa02fd54)











![Copie de [Image de une] Horizontale (84) Copie de [Image de une] Horizontale (84)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/12/copie-de-image-de-une-horizontale-84-768x432.jpg?resize=300,350&key=30319f9e)



![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/05/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-05-22t164945311-768x432.jpg?resize=300,350&key=638f1da8)



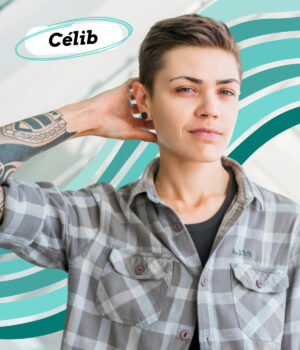








![[Image de une] Horizontale (27) [Image de une] Horizontale (27)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/image-de-une-horizontale-27-768x432.jpg?resize=300,350&key=19a71e0d)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-12T103045.066 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-12T103045.066](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/12/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-12-12t103045066-768x432.jpg?resize=300,350&key=93ef36ef)
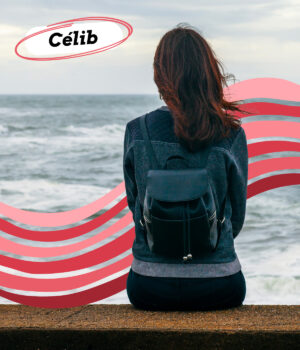
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-10T145633.472 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-10T145633.472](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/12/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-12-10t145633472-768x432.jpg?resize=300,350&key=2403676d)
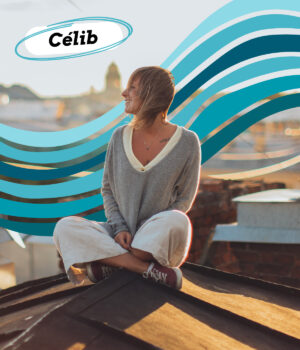


Les Commentaires
Tu as raison de te motiver, moi j'essaierai de reprendre dès que possible !
Si tu es sur Paris je connais 2 endroits pour apprendre le turc (mais il y en a peut etre d autres) : l'Inalco et l'association De la Seine au Bosphore (c'est la que j'étais et ça se passait très bien )