On l’a échappé belle ! En juillet 2021, la définition juridique du harcèlement sexuel a failli être assortie de l’obligation de démontrer l’intention de nuire de l’agresseur devant les prud’hommes. Mais grâce à la mobilisation de plusieurs syndicats, associations et sénateurs de gauche, le verbe « subir » a finalement été retenu, plutôt que le fait d’« imposer » des faits relevant du harcèlement sexuel.
Mais est-ce suffisant, sachant que selon une étude de 2019 menée par l’Ifopp, six européennes sur dix ont été un jour confrontées, au cours de leur carrière, à des violences sexistes ou sexuelles ?
La nuance entre subir et imposer est cruciale : « la preuve, c’est le nerf de la guerre ».
Élise Fabing, avocate en droit du travail
En parallèle, depuis quelques mois, des comptes anonymes pullulent sur Instagram pour dénoncer, entre autres, le harcèlement sexuel au travail. Dans le sillage du mouvement #MeToo, les comptes « balance ton/ta » sont devenus une vraie menace pour la réputation des entreprises, soucieuses d’une image de marque qui, en 2021, se veut plus que jamais concernée par le bien-être des femmes au travail (vous avez dit féminisme-washing ?).
Le recours à l’anonymat, plébiscité par des milliers de followers, ne démontre-t-il pas une défaillance de la justice… et un vrai besoin d’aller plus loin pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail ? On fait le point sur l’arsenal juridique mis en place en France.
« Le nerf de la guerre, c’est la preuve »
Commençons par poser les bases : en France, le harcèlement sexuel est défini dans deux textes de loi. D’un côté, dans le code pénal, qui permet d’aller devant un juge professionnel :
« Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. »
Article 222-33 du Code pénal
Et de l’autre, dans le code du travail, qui édicte les droits des salariés et permet de saisir les prud’hommes :
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
Article L1153-1 du Code du travail
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »
Justement, le projet de nouvelle loi de protection de la santé au travail était d’aligner le code du travail sur la définition pénale. Seulement, cette dernière est peut-être plus précise, mais elle est, du même coup, plus restrictive, car elle retient le caractère intentionnel du harcèlement.
La nuance entre subir et imposer est cruciale : « la preuve, c’est le nerf de la guerre », explique Élise Fabing, avocate en droit du travail. « Démontrer l’intention de nuire rajoute une grande contrainte, c’est beaucoup plus compliqué côté demandeur ou demanderesse », explique-t-elle.
Résultat : portés par les syndicats et l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, les sénateurs de gauche ont obtenu qu’un amendement remplace « imposer » par « subir » dans la proposition de loi, qui sera quand même plus complète qu’auparavant. Ouf !
Faire valoir ses droits : saisir le juge pénal ou les prud’hommes ?
Une petite victoire qui n’empêche pas tout un tas de difficultés pouvant survenir dans le parcours de la victime. Même aux prud’hommes, sans besoin de démontrer l’intention de nuire, les preuves sont déjà difficiles à constituer : seuls comptent les écrits (échanges de mails, textos).
Élise Fabing souligne que les choses sont en train d’évoluer :
« Il y a une jurisprudence de novembre dernier qui reconnaît la production de vocaux. Je m’en sers pour constituer mon dossier de preuves. »
« Je déconseille souvent à mes clients de commencer par aller au pénal : c’est long, le parcours est compliqué. En plus, le juge prud’homal attend souvent la décision du pénal pour statuer, ce qui ralentit toute la procédure. »
ÉLISE FABING, AVOCATE EN DROIT DU TRAVAIL
Les demandeurs à l’action peuvent aussi s’appuyer sur des témoignages de collègues, qui craignent néanmoins souvent de perdre leur travail s’ils parlent. Elise Fabing milite en faveur d’une meilleure protection de ces derniers : « le lien de subordination économique ne doit pas interférer dans leur choix ou non de témoigner ».
Il faut aussi savoir qu’au pénal, on peut attaquer une personne physique OU une entreprise. Aux prud’hommes, en revanche, on ne peut attaquer que l’entreprise qui emploie. Souvent, c’est cette deuxième option qui est préférée, explique Maître Fabing.
« Je déconseille souvent à mes clients de commencer par aller au pénal : c’est long, le parcours est compliqué. En plus, le juge prud’hommal attend souvent la décision du pénal pour statuer, ce qui ralentit toute la procédure. »
L’avocate rappelle aussi que souvent, les victimes sont encore en poste au moment où l’action est engagée : le conflit doit donc être réglé le plus vite possible. Aux prud’hommes, le délai moyen est d’un an, alors qu’au pénal, cela peut aller jusqu’à plusieurs années, du dépôt de plainte jusqu’à la décision du juge…
Ce lundi 6 septembre à Angers, par exemple, un patron d’escape game a été condamné près de six ans après les faits. Autant dire une éternité.
« Pourquoi ne pas mettre en place un recours d’urgence, en cas de danger grave et imminent ? Ça permettrait d’avoir une décision prise dans les trois mois ! »
ÉLISE FABING, AVOCATE EN DROIT DU TRAVAIL
À cette lourdeur procédurale s’ajoutent deux recours supplémentaires. On peut saisir le Défenseur des droits, qui dispose d’un pouvoir contraignant d’enquête… mais il est débordé de demandes, et donc lent à réagir. Quant à l’inspection du travail, elle peut aussi être saisie, mais ce n’est pas systématique. Pourquoi n’est-elle pas intégrée au processus d’enquête interne, en tant qu’institution garante du droit du travail ? Mystère.
En tout cas, pour Élise Fabing, on manque d’une procédure rapide :
« Pourquoi ne pas mettre en place un recours d’urgence, en cas de danger grave et imminent ? Ça permettrait d’avoir une décision prise dans les trois mois ! »
« Il faut que les boîtes aient vraiment peur »
Et côté sanctions, que peut-on espérer ?
Les prud’hommes (ou le juge pénal en cas de constitution comme partie civile) condamnent à une indemnisation des préjudices subis par la victime et le montant varie selon l’appréciation des juges. En outre, la reconnaissance d’un harcèlement sexuel donne droit à l’employeur de licencier son auteur pour faute grave.
Au pénal, la personne physique comme l’entreprise risquent deux ans d’emprisonnement et 30.000€ d’amende. Il existe des circonstances aggravantes, comme par exemple l’abus d’autorité conféré par des fonctions, qui portent les peines à trois ans de prison et 45.000 euros d’amende.
« Pourquoi n’y aurait-il pas un barème proportionnel aux conditions du harcèlement ? Selon la taille de la boîte, son chiffre d’affaires… »
ÉLISE FABING, AVOCATE EN DROIT DU TRAVAIL
Mais il faut rapporter ces montants à la taille de l’entreprise, si c’est elle qu’on attaque : qu’est-ce qu’une amende de 45.000 euros pour une boîte du CAC40 ? Pas grand-chose. D’autant que ce tarif est fixe, quelle que soit la taille de l’entreprise…
Entre prendre une amende ridicule, et garder en poste un cadre qui rapporte du chiffre, bien qu’il harcèle ses collègues, le calcul peut être vite fait.
« Il faut que les boîtes aient vraiment peur », soutient Maître Fabing ; « Pourquoi n’y aurait-il pas un barème proportionnel aux conditions du harcèlement ? Selon la taille de la boîte, son chiffre d’affaires… » suggère l’avocate.
Ce qui a vraiment changé ces derniers mois, selon elle, c’est la perception du préjudice d’image, qu’elle voit même plus importante que la peur de la condamnation par la justice. Une « shitstorm » sur un compte « Balance… » ferait, à certains, plus peur qu’une amende.
Enfin, rappelons que l’employeur est tenu responsable de ce qui arrive à ses salariés : s’il y a du harcèlement, il en est responsable en tant que garant de la santé et de la sécurité de ses équipes. Il a donc un rôle de prévention !
Votre boîte vous a-t-elle déjà parlé de vos droits ? Ou simplement expliqué ce qui caractérisait le harcèlement ou encore l’agissement sexiste ? Non ? Eh bien vous rapprocher de vos partenaires sociaux (comité social d’entreprise, syndicats…) pourrait motiver un petit rappel, histoire de rafraîchir la mémoire à tout le monde.
À lire aussi : Contre le cyberharcèlement, « les mesures prises par Twitch ne suffisent pas »
Crédits photos : le film Working woman / Yan Krukov (Pexels)
Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.






![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-27T162319.056 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-27T162319.056](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-27t162319056-768x432.jpg?resize=300,350&key=3b6a8bc7)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T160849.930 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T160849.930](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-15t160849930-768x432.jpg?resize=300,350&key=805c7101)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-08T164030.491 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-08T164030.491](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-08t164030491-768x432.jpg?resize=300,350&key=3bfffda2)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-18T165018.937 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-18T165018.937](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-18t165018937-768x432.jpg?resize=300,350&key=513eae37)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-07T114455.874 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-07T114455.874](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-07t114455874-768x432.jpg?resize=300,350&key=7f751c05)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-17T114010.690 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-17T114010.690](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/09/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-09-17t114010690-768x432.jpg?resize=300,350&key=d5e1133a)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-12T104005.894 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-12T104005.894](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/09/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-09-12t104005894-768x432.jpg?resize=300,350&key=39374b96)









![Copie de [Image de une] Horizontale (84) Copie de [Image de une] Horizontale (84)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/12/copie-de-image-de-une-horizontale-84-768x432.jpg?resize=300,350&key=30319f9e)


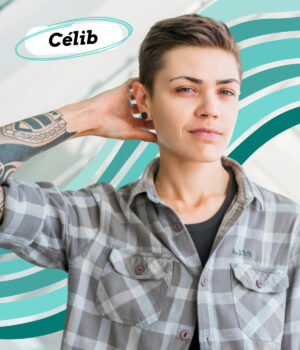




![[Image de une] Horizontale (27) [Image de une] Horizontale (27)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/image-de-une-horizontale-27-768x432.jpg?resize=300,350&key=19a71e0d)
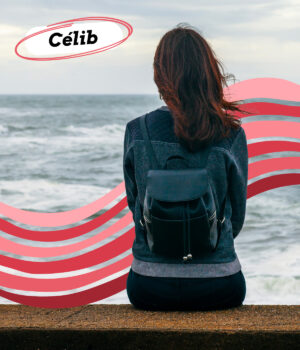
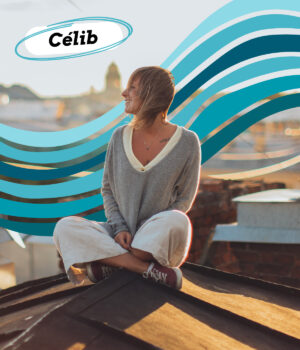



Les Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaire sur cet article.