Récemment, je me suis rendue au Chennai LGBT Short Movie Festival et laisse-moi te dire que j’en suis sortie avec des rainbows plein les yeux !
Un festival LGBT à Chennai. Dans le Tamil Nadu. En Inde.
Oui, bon alors commencons par l’Inde. Une anecdote pour vous expliquer un peu le contexte : les hommes, partout dans la rue, se tiennent par la main, par la taille ou les épaules.
Pourquoi ? Parce que tout simplement, l’homosexualité n’est pas de l’ordre des possibles (tout juste de l’ordre des crimes dépénalisés). Les démonstrations d’affection publiques entre personnes du même sexe NE SAURAIENT donc être autre chose que de l’amitié. CQFD.
En fait, c’est simple, en Inde je n’ai jamais entendu parler d’homosexualité. On ne parle déjà pas beaucoup de sexe, alors entre deux personnes du même sexe, vous pensez bien !
Le magazine GQ met des femmes en couvertures, parce qu’un homme, un vrai, ne mate pas d’autres hommes. Pas (ou vraiment très peu) d’articles sur l’homosexualité dans la presse féminine indienne. Parce qu’une fois de plus, les femmes ont une place bien définie, et elle se trouve souvent entre un homme et la cuisine.
Quand je suis arrivée en Inde, c’est mon manager, français, qui s’est fait l’écho de la culture tamoule très traditionnelle. D’un naturel plutôt crédule, je n’ai pas vraiment demandé mon reste.
Du moins, pas jusqu’au jour où, par un beau matin de mousson, l’une de mes collègues m’a transmis une newsletter de l’Alliance Française à Madras. La newsletter annoncait en violet et rose sur fond noir, un festival du court-métrage LGBT sur trois jours, dans son auditorium. Ô joie, ô impatience. MAIS DISONS-LE: Ô SURPRISE AUSSI.

Au programme : des courts-métrages indiens, français et internationaux, tournant tous autour de problématiques LGBT. Une mention spéciale pour Les Chansons d’Amour, dans lequel Louis Garrel envoie son pesant de phéromones.
J’ai eu le plaisir de découvrir un court-métrage indien sur la condition souvent difficile des transgenres indiens au moment de la vieillesse, traitée à travers le prisme de l’art, de l’amour qui dure — et dépasse donc la question du genre — et d’une jeunesse plus ouverte que leurs parents à cette problématique.
J’ai aussi découvert des réalisateurs moldaves qui parlent du Sida, et des Américains qui remettent la dimension « normative » des contes pour enfants. Ça allait donc de la maladie à la poésie et ça faisait tourner la mappemonde dans tous les sens.
Non franchement, c’était bien. Mais c’était pas encore le mieux. Laisse-moi te parler du public, parce que je crois qu’en définitive, j’ai passé plus de temps tournée vers la salle que vers la toile.
Débattons autour d’un petit chai, voulez-vous ?
J’étais au deuxième rang en partant du bas. Derrière moi et jusqu’en haut, cent cinquante personnes au bas mot : première épiphanie. Il existait donc une communauté LGBT, et des cinéphiles que ça ne dérange pas de voir des films sur le sujet. Quand on sait que la censure cinématographique dans le Tamil Nadu sévit sur tout et n’importe quoi, il y a de quoi être fière et impressionnée et heureuse et pleine d’espoir.
Quand les lumières se sont allumées après le premier court-métrage, je me suis rendue compte que l’audience était essentiellement composée d’hommes entre 20 et 40 ans (à vue de nez). On pouvait aperçevoir ici et là des familles avec des enfants d’une dizaine d’années, ce qui n’a pas manqué de me surprendre.
En tout dans la salle, une vingtaine de femmes et une dizaine de transexuels. Parmi les femmes présentes à la projection ce jour-là, certaines portaient le sari traditionnel, d’autres — plus nombreuses — arboraient des robes découvrant les épaules et les mollets (dans ma tête au moment de ce constat : un long grognement contre toutes les réflexions que j’ai reçues concernant ma décision d’en faire autant). De manière générale, nous avions là un public enthousiaste, qui a applaudi à la fin de la plupart des court-métrages, et une ambiance totalement conviviale : on servait du chai à chaque entracte. Deuxième épiphanie.

Après le dernier court-métrage, le speaker a annoncé un débat autour de la couverture médiatique de la communauté LGBT en Inde. J’en avais l’eau à la bouche.
Quatre personnalités étaient invitées à prendre la parole, quatre représentants de la communauté LGBT indienne et plus particulièrement chennaiite : l’écrivain tamoul Charu Nivedita, la présentatrice transgenre Rose Venkatesan, l’activiste et fondateur de Chennai Dost Vikranth Prasanna et l’actrice-réalisatrice Fathima Babu. Prochaine épiphanie annoncée.
LGBT et médias en Inde
Les quatre protagonistes ont très vite fait le constat d’une couverture médiatique très normative de la sexualité hétérosexuelle en Inde. En effet, il n’est pas rare — mais l’Inde n’en a pas le monopole, nous sommes bien d’accord — de tomber sur des titres du genre Real Girls Reveal What They Really Want in Bed (Les vraies filles révèlent ce qu’elles veulent vraiment au lit — couverture du Cosmo Man de mai) ou encore The Sex He Doesn’t Want (Le sexe dont il ne veut pas — Cosmo du mois de mai) : dites coucou au gros diktat sur ce que tu fais tout nu et avec qui !
Mon moment du débat préféré ? Celui où l’actrice et productrice Fathima Babu a rappelé que l’hétérosexualité était une nécessité pour procréer, mais que tout le reste n’était qu’affaire de préférences sexuelles. Et que toute la salle s’est mise à applaudir.
Sans aucun doute la plus grosse épiphanie de la soirée.
En résumé, le Chennai Rainbow Film Festival m’a montré que les mentalités évoluent en Inde et que rien ne reste figé pour toujours, malgré le poids des traditions. Une très bonne nouvelle !
Pour témoigner sur Madmoizelle, écrivez-nous à :
jaifaitca@madmoizelle.com
On a hâte de vous lire !
Et si le film que vous alliez voir ce soir était une bouse ? Chaque semaine, Kalindi Ramphul vous offre son avis sur LE film à voir (ou pas) dans l’émission Le seul avis qui compte.







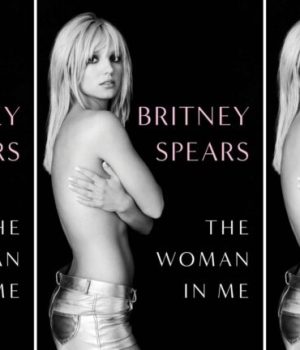









![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-12T103045.066 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-12T103045.066](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/12/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-12-12t103045066-768x432.jpg?resize=300,350&key=93ef36ef)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-10T145633.472 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-10T145633.472](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/12/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-12-10t145633472-768x432.jpg?resize=300,350&key=2403676d)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-25T111624.319 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-25T111624.319](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-25t111624319-768x432.jpg?resize=300,350&key=d78cc3b4)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-28t150710132-768x432.jpg?resize=300,350&key=0dbf06ef)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-20T111708.991 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-20T111708.991](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-20t111708991-768x432.jpg?resize=300,350&key=a2a91e2d)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-15t163147788-768x432.jpg?resize=300,350&key=c0e2a724)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-13T154058.525 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-13T154058.525](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-13t154058525-768x432.jpg?resize=300,350&key=5e3885bf)
![[Image de une] Horizontale (24) [Image de une] Horizontale (24)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/image-de-une-horizontale-24-768x432.jpg?resize=300,350&key=bd0cfdc3)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T170053.120 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T170053.120](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-30t170053120-768x432.jpg?resize=300,350&key=9979862d)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T164414.844 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T164414.844](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-30t164414844-768x432.jpg?resize=300,350&key=f42d86d3)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T115104.723 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T115104.723](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-30t115104723-768x432.jpg?resize=300,350&key=351be990)





Les Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaire sur cet article.