Écoutez ce texte en audio, lu par Dorothée :
Télécharger le podcast S’abonner au podcast : sur iTunes – Flux RSS C’est quoi un podcast ?
==
Publié le 17 avril 2016 —
Un soir je naviguais sur Netflix avec ma mère et mon beau-père, et on a fini par se mettre d’accord pour regarder un film catastrophe (leur petit plaisir coupable dont je ne me dédouane pas totalement).
C’était Deep Impact, un truc un peu obscur des années 90 avec Morgan Freeman en président américain, une journaliste coiffée comme Taylor Swift aux derniers Grammys, Elijah Wood tout bébé et nerdy en membre du club d’astronomie, et une bonne grosse comète de la taille de New York fonçant sur la terre pour y faire une teuf pleine de poussière d’apocalypse, comme avec nos regrettés dinosaures.
Et là, vous vous demandez sans doute, pourquoi se servir d’un vieux nanar en guise d’accroche ? C’était, sans être un affreux navet, un film très oubliable qui ne m’a marquée que parce que dans mon état émotionnel un peu particulier, voir tous ces gens courir et se serrer dans les bras les uns les autres avant que New York ne disparaisse sous les vagues, ça m’est apparu comme une métaphore.

Dans le film, en gros, on sait un an à l’avance que la comète va arriver et rendre toute vie impossible sur la planète. Et pendant un an, les hommes se préparent au pire, tout en tentant bien entendu de la détruire avant l’impact, ce que finit par faire un groupe d’astronautes, se suicidant en héros pour sauver l’humanité.
Mais moi, tout ce que j’ai retenu, c’est la comète. Cette comète qui fonce à tout allure sur la terre, et qui devrait faire que tout soit fini, à une date précise.
La mienne de comète, elle vient de tomber. Elle a commencé par une petite pluie de cailloux enflammés, le lendemain de la dernière nuit qu’on a passée ensemble. Et elle est entrée dans l’atmosphère mercredi soir, quand on s’est parlés au téléphone, quelques heures avant son vol. Et elle s’est abattue le lendemain, quand j’ai réalisé que ça y est, il était parti.
Une relation-comète
Ma comète à moi, c’était la condition sine qua non d’une relation. Une relation avec un corps céleste masculin, plus précisément. Quand on s’est rencontrés, lui et moi on n’a pas mis longtemps à comprendre qu’on se plaisait beaucoup tous les deux. On a, sans réfléchir, vite fini dans un lit, à bout de souffle, sans doute aussi surpris l’un que l’autre que ça ait été aussi simple et rapide.
Et c’était franchement bon, une vraie bouffée d’air frais.
Lui, il sortait de désillusions sentimentales assez lourdes, du genre où on croit que ce sera pour la vie, et en fait non. Moi, bien qu’ayant moins eu le temps de rouler ma bosse sur les autoroutes de l’amoûr, j’avais néanmoins eu le loisir de me prendre du plomb dans l’aile, et j’avais encore mon petit cœur en morceaux dans un Tupperware, quelque part au frigo.
Il disait ne croire en rien, moi je n’en avais plus envie. On ne voulait s’engager à rien.

À lire aussi : Typologie (non exhaustive) des plans cul
Mais quand on se plait aussi vite et aussi fort, c’est difficile de ne pas se revoir. Surtout quand monsieur vous envoie un message quelques heures seulement après être parti de chez vous. Surprise mais pas forcément contre, j’ai répondu sur le même ton badin. Et puis on en est venu à se dire que c’était chouette, la veille, puis à regretter l’absence de ses lèvres sur les miennes, de mon corps contre le sien et…
Bref, vous avez saisi l’idée.
Mes amis me regardaient déjà pianoter sur mon portable avec méfiance, du genre « on ne nous ne la fait pas ». Mes potes et moi on se dit un peu tout, et après une description de la situation dans les grandes lignes, ils n’y croyaient pas à notre projet encore flou de sexe sans conséquence. « T’écris pas à ton plan cul pour lui parler de sa peau d’albâtre », me dit l’un.
Je choisis dignement de l’ignorer.
Et puis on s’est revus. Alors qu’il devait partir passer les fêtes dans sa famille, quelques jours seulement après notre première expérience sans vêtements, il est passé un soir à l’improviste. Et nos bouches se sont trouvées comme des aimants, façon on n’a pas bu depuis des semaines et tu es mon oasis du désert, nos mains s’occupant de vérifier que le terrain ami n’avait pas changé en deux jours.
Est tout de suite apparue la petite pensée sournoise, à l’arrière du crâne, que ce n’est pas comme ça qu’on devrait faire si on ne veut pas s’attacher. Mais on l’a balayée d’un revers de la main, et cela d’un commun accord.
De toute façon, tu partais pour l’autre bout du globe dans à peine plus de deux mois. Pourtant même une fois le ticket d’avion réservé, même une fois la date écrite dans nos deux agendas, malgré les cartons partant à la cave, malgré son appartement se vidant petit à petit, les papiers administratifs pour le mettre en location s’entassant sur son comptoir, il y avait toujours aussi nos vêtements tombant sur le sol.

À lire aussi : Celui qui… m’a redonné la foi (en moi et en l’amûûûûr)
Pas en couple… mais toujours ensemble
On l’a eu trente-six mille fois, la discussion fatidique. On n’est pas en couple, hein. Ça te va toujours ? Et toi dis-moi, c’est bon, on ne se voit pas trop ? Tu voudrais savoir si je voyais quelqu’un d’autre ?
Mais dans notre cas, c’était plus devenu comme un bilan hebdomadaire, de vérification du véhicule. Un contrôle technique un peu hypocrite. Enfin non, pas hypocrite. Je pense sincèrement qu’on n’avait tous les deux pas envie de se mettre en danger, autant peur, chacun à notre façon, de cette entité qu’est le couple.
On ne voulait pas être ensemble. Parce que c’est nul, parce que ça allait tout gâcher, on allait voir l’envers du décor de l’autre.
La notion d’obligation allait se frayer un chemin dans le truc non identifié mais très agréable que l’on vivait. Alors on se rassurait mutuellement comme on le pouvait, et on était très fiers de notre petite combine. En plus, partir de soirée l’un après l’autre, à quelques minutes d’écart, après s’être mis d’accord par textos comme deux espions, qui se retrouvent au tram pour finir d’accomplir leur mission, ça ne gâchait rien.
On n’avait pas forcément besoin de piment, mais en ajouter à notre mixture la rendait encore plus délicieuse.

Et puis on a tous les deux vécu des trucs pas faciles, des uppercuts imprévus. J’ai eu un gros choc émotionnel, marquant la fin d’une amitié de plus de six ans. Sans même réfléchir, je l’ai appelé et suis allée me réfugier dans ses bras. Il m’y a accueillie. Ça m’a fait un bien fou. Pourtant, le lendemain on se regardait un peu comme si on ne s’était encore jamais vraiment vus.
Je crois qu’on était tous les deux surpris, autant que je sois venue chercher son réconfort qu’il me l’ait apporté. Je me suis excusée, mais il n’y avait pas de souci. M’excuser de quoi d’abord ? On a bien le droit de tenir à quelqu’un sans être amoureux, non ? Bon ben voilà, on ne faisait rien de mal.
Ensuite son tour est venu. Une relation compliquée qui implose, et blesse des deux côtés. Sans réfléchir, je l’ai soutenu. Et par là je veux dire faire de l’assistance réponse textos en pleine tempête, le raccompagner chez lui après la pinte de trop, lui tenir la main pendant qu’il s’expliquait avec elle au téléphone. Encore une fois, surprise générale : je l’ai aidé, et il s’est laissé faire. Comme moi juste avant. La rencontre du chevalier blanc et de l’infirmière compulsive.
On le savait, qu’on était tout cassés, tous les deux. Mais de se voir chacun dans de tels moment, ça a rendu nos fêlures bien plus réelles et impossibles à cacher. J’ai compris beaucoup de choses sur lui, et je ne doute pas un instant qu’il a vu bien plus loin que ce que je laisse en général monter à la surface.
Et à force, on a fini par partir en même temps de nos soirées. À se parler sur Twitter, Snapchat, Facebook, textos, sans vraie interruption. À se promettre tous les dimanches que la semaine prochaine, on se verrait moins. Il devait préparer son départ, et il fallait ménager la coupure aussi. Et puis finalement, on se voyait six nuits sur sept. On ne pouvait même plus chanter Indochine. Trois nuits par semaine, mon cul.

« Ah, les nuls ! » – Nicolas Sirkis
La non exclusivité, ironiquement, s’était juste matérialisée dans le déclencheur de son incident (les soucis évoqués plus haut, faut suivre), lequel nous avait au final rapprochés. Même à ça, ça devenait difficile de s’accrocher comme rempart contre l’affection. Mais de toute façon, il partait. On ne risquait rien, non ?
Alors on s’est laissés aller. On a arrêté de faire des points « tout va bien », de checker qu’on ne s’attachait pas. On a été de moins en moins précautionneux.
On savait que la comète tomberait de toute façon, qu’il partirait bien vivre son année chez les kiwis.
Mais on se faisait du bien apparemment, alors en attendant, à quoi bon se limiter ? Des fois, on se voyait même sans coucher ensemble. On se faisait juste des câlins, en buvant un café devant une série. La petite voix sournoise qui criait « JE CROYAIS QUE TU VOULAIS PAS ÊTRE EN COUPLE » dans ma tête, je pouvais lui dire : oui mais dans quelques semaines, quelques jours, c’est fini.
Et apothéose de ce qui serait, pour mes amis, bien plus malins que moi depuis le début, la fin des haricots : on a passé la Saint Valentin ensemble. No limit vous dis-je.
À lire aussi : Celui qui… a tout changé
Le paradoxe de la comète parfaite
Mais ce n’était pas grave, et vous savez pourquoi ? Parce que la certitude de son départ, de l’impact inéluctable, nous a permis de vivre chaque instant à fond. Même la dernière soirée on l’a vécue de façon insouciante et intense, un peu comme chaque moment de notre histoire express, parce qu’on a réussi à mettre le reste à la porte, jusqu’à ce qu’il la franchisse.
Savoir que la réalité allait frapper à une date précise, ça nous a permis de l’éviter jusqu’à celle-ci.
Ça m’a autorisée à n’en avoir rien à faire, à lui écrire une lettre, lui faire une playlist, et à me lâcher, comme une héroïne de comédie romantique indépendante. Ça nous a permis de pleurer dans les bras l’un de l’autre, quand on a enfin compris que ça y est, cette petite danse d’adieu au petit déjeuner, c’était nos derniers instants ensemble.
J’ai compris que je n’en avais pas vraiment rien à faire. Que je venais de vivre un truc parfait. Et que c’était fini. La comète venait de tomber.

J’ai pleuré parce c’est terrible, de voir quelque chose de parfait s’achever. Que comme un enfant, on aimerait que la récréation, elle dure toujours. Mais j’ai aussi pleuré de joie, parce qu’on a eu deux mois et demi parfaits, et que je sais qu’on s’est apporté énormément de choses.
Moi qui ai toujours besoin qu’on me confirme et me prouve son affection par a + b, là, je n’en n’avais pas besoin. Je le savais. J’étais pleine de certitude. Il me les a même dites, toutes les jolies choses que j’avais besoin d’entendre. Et pas forcément avec des mots. M’appeler juste avant son départ, c’est con, mais ça suffit. Il n’avait même pas besoin de parler en fait : le simple fait d’en avoir envie et de le faire, ça me disait tout ce que j’aurais pu vouloir entendre.
Donc je le savais. Et ça ne changeait pourtant rien. On s’aimait beaucoup, mais il devait partir. Il en avait besoin. C’était nécessaire.
Je sais que nous n’aurions pas pu, dans une configuration différente, vivre ce que l’on venait de vivre. Sans la comète, on ne se serait jamais permis autant de choses. Pour deux personnes qui ne voulaient pas s’attacher, c’est vrai qu’on avait l’air un peu bêtes à se morver dessus, et à s’étreindre comme si la terre allait finir engloutie sous les cendres. Mais c’est ça le paradoxe de la comète parfaite.
Vivre quelque chose avec un compte à rebours nous a rendus capable de faire exploser les barrières qui nous auraient retenus en temps normal. Ça ne veut pas dire qu’on est guéris, que je vais me sentir capable de construire quelque chose avec le premier match Tinder venu, ni que j’en ai la moindre envie.
Ça signifie seulement qu’au milieu de cette jolie parenthèse, on s’est prouvés qu’on n’était pas tout morts de l’intérieur. Qu’on s’est trouvés pile au bon moment, même si ce n’était que le temps d’une étoile filante.
Certes, il est de l’autre côté de la terre et ce qu’on avait est fini, en l’état actuel. Mais on n’est pas non plus à des années-lumière. On a vécu sur notre comète, une aventure éclair et parfaite qui a su venir à bout de nos réticences, et nous protéger de par son caractère éphémère programmé.
Et je suis peut-être la plus naïve des idiotes pour quelqu’un qui dit ne plus croire en l’amour, mais je ne désespère pas de le retrouver et garde en tête la possibilité tordue de peut-être se trouver une planète un jour.

Pour témoigner sur Madmoizelle, écrivez-nous à :
jaifaitca@madmoizelle.com
On a hâte de vous lire !
Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.

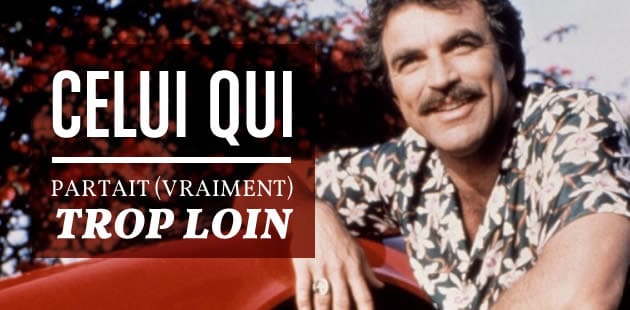

















![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-06-03T152331.664 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-06-03T152331.664](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/06/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-06-03t152331664-768x432.jpg?resize=300,350&key=402d1b58)












![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-03-01T143149.814 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-03-01T143149.814](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/03/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-03-01t143149814-768x432.jpg?resize=300,350&key=d9a4be76)






Les Commentaires
Et si jamais j'apprends que la hin du monde est pour bientôt, soit je me suicide, soit j'en profite en devenant irresponsable..