Esther est partie recueillir les témoignages des jeunes femmes de plusieurs pays à travers le monde, avec une attention particulière portée aux droits sexuels et reproductifs : liberté sexuelle, contraception, avortement.
Elle a déjà rendu compte de ses rencontres avec des Sénégalaises, puis avec des Libanaises, elle a aussi suivi les débats sur l’avortement en Irlande et en Argentine. Sa cinquième étape l’a menée au Chili !
Retrouve le sommaire des reportages, interviews et autres articles qu’elle y a réalisé ici !
Tu peux suivre au jour le jour ses pérégrinations sur les comptes Instagram @madmoizelledotcom et @meunieresther, avant de les retrouver ici bientôt !
- Précédemment : Dictature, peuples originels, droits des femmes : rencontre avec Marce, militante Mapuche
L’IVG au Chili, un an après
En août 2017, le Chili mettait fin à presque 30 ans d’illégalité totale de l’IVG. Depuis septembre 1989 en effet, il était interdit de procéder à un avortement, quelle qu’en soit la raison.
Cette loi instaurée par le régime dictatorial de Pinochet n’a jamais été abrogée, et c’est seulement depuis septembre 2017 que quelques assouplissements y ont été apportés : l’IVG est désormais autorisée dans trois cas.
Si la vie de la mère est en danger, si le fœtus souffre d’une malformation fatale, ou si la grossesse fait suite à un viol ou un inceste. Alors, et seulement alors, il est possible pour la femme enceinte d’y avoir recours.
Un an après l’entrée en vigueur de cette loi, j’ai voulu me pencher sur la situation réelle sur le terrain, sur ce qu’elle avait changé.
C’est pour cela que j’ai rencontré, à Santiago du Chili, Camila Maturana, de l’organisation Corporacion Humanas, spécialisée dans les droits des femmes.
L’IVG légale au Chili, une pratique pas si répandue
Dès le début, elle a tenu à être claire sur un point : la loi votée il y a un an est importante. Obtenir ce droit à l’IVG, même restreint, a demandé énormément de travail aux militantes chiliennes.
Et je ne peux qu’approuver son message : grâce à ce vote, entre septembre 2017 et août 2018, 493 femmes ont pu avorter dans des conditions légales et sûres.
C’est peu, mais c’est déjà ça, car ce sont potentiellement 493 vies épargnées, potentiellement 493 personnes qui n’ont pas eu à se cacher.
Le ministère de la santé indique que 243 avortements ont été pratiquées en raison du danger pour la vie de la mère que la grossesse représentait, 175 pour cause de malformation fœtales, et 75 pour viol.

Pour autant, Camila Maturana reconnaît que cette loi est loin d’être suffisante et qu’il faut continuer de travailler à son évolution. D’autant plus que ces chiffres lui paraissent faibles.
« Nous n’avons pas les moyens de vérifier si toutes les femmes qui souhaitent avoir recours à l’avortement bénéficient effectivement de ces soins.
Il y a notamment une différence énorme entre les cas de danger pour la vie de la mère et les cas de viol. »
Des limites au droit à l’IVG encore trop grandes
Dans le cas du viol…
Dans le cas précis du viol, Camila Maturana a en effet beaucoup de réserves sur l’efficacité de la loi.
« Lors des débats, les anti-choix pensaient que les femmes allaient demander des IVG en série en utilisant le prétexte du viol.
Clairement, ces chiffres montrent que ce n’est pas le cas. En fait, on se demande même si la procédure leur est vraiment accessible. »
Pour pouvoir avoir recours à un avortement pour motif de viol, une femme doit se rendre à l’hôpital où elle sollicite l’intervention. Elle est reçue par une équipe composée d’un professionnel de santé ainsi que d’un psychologue ou travailleur social.
Si ceux-ci jugent le récit de la victime cohérent avec les observations cliniques (date de la grossesse et date du viol notamment), ils valident la procédure.
La loi ne requiert pas d’avoir porté plainte, mais une fois la cause du viol établie, l’équipe de santé doit communiquer les faits au directeur de l’établissement qui lui-même les transmet au ministère pour entamer une investigation.
La victime peut participer à la procédure mais n’a aucune obligation de le faire.
Cependant cette façon de fonctionner comporte deux freins potentiels au droit à l’IVG…
D’abord, l’accès à l’IVG dans ce cadre dépend entièrement du bon vouloir des professionnels. Ils peuvent décider de ne pas croire le récit de la victime, et ainsi nier le droit d’une femme à avorter.
Ensuite, l’idée qu’une procédure soit conduite, même sans obligation pour la victime d’y participer, peut poser problème à cette dernière. Effectivement, il peut exister de nombreuses raisons pour ne pas souhaiter que des poursuites soient engagées.
Dans le cas du risque vital..
Mais la législation contient d’autres inconvénients, comme l’explique Camila Maturana. Dans la cas du risque vital pour la mère par exemple :
« Avant que la loi ne passe, lorsqu’il existait un risque pour la vie de la mère les équipes médicales interrompaient déjà la grossesse pour éviter qu’elle ne meure.
Il était entendu qu’il ne s’agissait pas réellement d’un avortement, puisque ce n’était pas l’intention de base : il s’agissait de la dernière alternative pour sauver au moins l’une de ces deux vies. »
Ça a d’ailleurs été l’un des arguments des anti-choix au moment du vote : selon eux cette disposition était inutile puisque déjà appliquée dans les faits. Elle a cependant été adoptée avec l’objectif d’éviter d’attendre le dernier moment pour intervenir.
« Le but était de pouvoir pratiquer l’intervention quand le risque devient significatif, sans avoir à attendre que la mère soit au seuil de la mort. »
Mais les attentes des militantes pro-choix ont vite été déçues….
« Le problème, c’est que des discours sont venus parasiter l’application de cette loi, notamment les croyances idéologiques des médecins et le fait qu’elle contienne une objection de conscience.
D’autant plus que pour beaucoup d’entre eux, la loi a été difficile à comprendre et à accepter…
On soupçonne donc, à partir de quelques cas qui nous ont été rapportés, que beaucoup de médecins ont au contraire tendance à retarder le moment d’agir, comme pour être certains de remplir les conditions légales. »
L’application de la loi comporte de telles faiblesses qu’il arrive encore que des femmes meurent
Camila Maturana prend immédiatement pour exemple le cas d’Estefania Cabello Ponce, une jeune femme enceinte de 17 semaines, hospitalisée pendant 10 jours suite à une rupture de la poche des eaux.
« Ils ont tenté d’éviter l’infection, mais elle s’est produite quand même, ils n’ont pas pratiqué l’avortement à temps et elle est décédée. C’était le 11 avril 2018. »
Cela faisait plus de deux mois que Camila Maturana attendait les résultats des différentes enquêtes lancées lorsqu’elle m’a raconté cela, et sa colère était palpable :
« Comment est-ce possible qu’une femme meure de cette manière, alors qu’elle est hospitalisée ? Dans un hôpital public ? Alors que selon la loi les médecins ont l’obligation d’intervenir au moment opportun ?
Il n’aurait pas fallu attendre quand l’infection s’est déclarée.
Mais comme la femme est décédée, il subsiste des doutes sur ce qui s’est passé. Clairement, ce n’est pas la responsabilité du dernier médecin, qui l’a prise en charge alors qu’elle était déjà complètement en choc toxique.
Mais que s’est-il passé entre le moment où la fièvre s’est déclarée, son hospitalisation, les heures pendant lesquelles ils ont attendu et sa mort ? […] Estefania a-t-elle pu donner son avis ? »
Camila Maturana pointe le problème : en effet selon elle, beaucoup de médecins ont du mal à accepter le fait que désormais, la patiente enceinte a aussi son avis à donner sur les soins à lui prodiguer.
L’objection de conscience, un problème majeur
L’opinion des médecins est d’ailleurs une limitation majeure à l’accès au droit à l’IVG au Chili, notamment à cause de l’objection de conscience.
« Ici, non seulement les médecins peuvent invoquer une clause de conscience personnelle, mais les institutions aussi.
C’est-à-dire que les cliniques et hôpitaux privés peuvent se déclarer objecteurs de conscience, et dès lors, même les médecins qui ne seraient pas objecteurs de conscience ne peuvent y pratiquer une IVG.
Cette situation autour de l’objection « institutionnelle » n’est pas le résultat d’une loi votée par le Congrès.
Les élus lorsqu’ils ont débattu de la loi ont réglementé l’objection de conscience personnelle seulement, mais le Tribunal Constitutionnel a modifié la norme de façon à reconnaître l’objection institutionnelle.
Ce n’est donc pas vraiment une loi légitime. »
Camila Maturana peste contre cette législation. Selon elle, même dans les hôpitaux publics, un tiers des médecins refusent de pratiquer l’IVG.
« Il y a des villes où aucun médecin n’accepte de pratiquer l’intervention, des hôpitaux où ils ne sont qu’un, deux ou trois à le faire et où ils attirent donc l’attention.
Le ministère public n’a pas fait en sorte de garantir que la loi puisse être appliquée dans tous les établissements. »
Elle déplore que cela doive parfois conduire des victimes à faire 200 kilomètres pour trouver un hôpital qui traitera leur cas.
« C’est une violence supplémentaire infligée à la femme, à l’adolescente, à la fille, que nous considérons inacceptable. »
La loi IVG du Chili ne couvre pas les besoins
En parallèle de toutes les limites déjà énoncées, Camila Maturana rappelle enfin que cette loi est loin d’être suffisante.
« Elle permet seulement l’interruption de grossesse pour les femmes et adolescentes jusqu’à 12 semaines de grossesse, et pour les plus jeunes jusqu’à 14 semaines.
Mais c’est totalement insuffisant, les toutes jeunes filles dont on parle ici ne connaissent pas leur corps, et c’est faire fi de la réalité des violences sexuelles dont elles sont les victimes chroniques.
On considère que l’État chilien ne remplit pas ses obligations internationales en matière de protection des filles. »
La dénonciation de ces actes étant souvent difficile, elle considère que ces délais ne couvrent pas les besoins.
« Mais de toutes façons, la majorité des femmes ayant besoin d’une IVG ne sont pas dans l’une des trois situations pour lesquelles elle est autorisée.
La réalité est toujours la même : les femmes avortent dans la clandestinité. »
Elle estime que cette situation est due l’intégration de valeurs religieuses dans le texte.
« Malgré le fait que le Chili soit un État laïc, nous avons une loi qui entérine les croyances religieuses d’une partie de la population alors qu’elles ne sont pas partagées par toutes et tous.
C’est une question qu’un État démocratique doit résoudre : une loi autorisant l’avortement n’obligerait aucune femme à y avoir recours si elle ne le souhaite pas, tandis que la loi actuelle force des femmes à conduire leur grossesse à terme alors qu’elles ne le souhaitent pas, ou à rentrer dans la clandestinité et mettre en danger leur vie, leur santé, leur liberté. »
En effet, j’ai également rencontré au Chili des femmes ayant avorté illégalement, qui m’ont raconté quelles avaient été leurs méthodes, ce qui fera l’objet de la seconde partie de ce reportage.







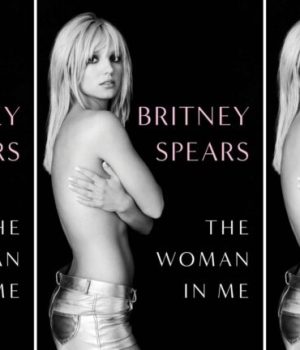



























Les Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaire sur cet article.