Des drames ou des comédies, on en voit beaucoup au cinéma. Mais qu’en est-il des films fous, des films qui repoussent les limites des genres et s’aventurent là où les autres films ne vont pas : dans le style esthétique, la violence, l’humour ou encore la tragédie shakespearienne déchirante qui fait pleurer à chaudes larmes ?
Ce mercredi 29 mars, Romain Quirot nous offre 1h30 d’un trip de cinéma parfaitement écrit, dirigé et mis en scène, pour un film aussi édulcoré que politique et passionnant. Madmoizelle a rencontré le réalisateur. Ancien vainqueur du Nikon Film Festival, Romain Quirot nous a parlé de films de genre, de son amour pour le style et la culture pop française, et de son personnage féminin, à rebours de tous les clichés sexistes du cinéma. Le tout, sans spoilers !
À lire aussi : Dalva, le chef-d’œuvre d’Emmanuelle Nicot qui explore la question de l’emprise d’une petite fille « déjà femme »
Le synopsis et la bande-annonce de Apaches
1900. De Montmartre à Belleville, Paris est aux mains de gangs ultra-violents qui font régner la terreur sur la capitale : les Apaches.
Prête à tout pour venger la mort de son frère, Billie intègre un gang.
Mais plus elle se rapproche de l’homme qu’elle veut éliminer, plus elle est fascinée par ce dernier.
Le film est porté par un casting cinq étoiles avec Alice Isaaz, Niels Schneider, Artus, Hugo Becker ou encore Rod Paradot.
Madmoizelle. Comment vous est venue l’envie de faire ce film sur les Apaches ?
Romain Quirot. Tout est parti d’une discussion avec ma productrice qui m’a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit que j’aimais les films de gangsters, c’est alors qu’elle m’a parlé de ces gangs, les Apaches. Je ne comprends pas pourquoi personne n’en a parlé avant. À Paris, en 1900, ces gangs étaient ultra-stylés, ils avaient des chaussures qui brillaient, ils volaient des accessoires bourgeois, ils étaient très punk. En tant que fan de films de gangsters, ça m’amusait d’aborder ce genre à fond et de voir ce que l’on pouvait créer en France sans faire une parodie, sans faire un film ultra premier degré, mais qui soit tout de même porté par une énergie touchante, celle des Apaches.
J’avais envie de faire un film stylé parce que les Apaches l’étaient notamment à travers leurs codes vestimentaires. Ils avaient aussi un sens aiguisé de la provocation. Par exemple, ils se faisaient tatouer des petits traits derrière la nuque en disant « Le jour de la guillotine, il faut viser ici. »

Vous reconstituez avec minutie la Belle Époque, une époque très mythifiée de l’Histoire française. Pourquoi vous a-t-elle particulièrement intéressé ?
Aux alentours des années 1900, il y a une dichotomie folle dans la société : il y a des inventions partout, des voitures, l’électricité, le cinéma, l’aviation. Tout se met en place de façon exponentielle et très rapide. Et à côté de ça, il y a des gamins qu’on laisse crever dans le caniveau. Il y a une violence énorme là-dedans. La violence, c’est l’ADN des Apaches. Ils sont le fruit de la violence sociale d’une époque. Et à un moment, ces gamins ont dit :
« Votre monde est cool, mais on n’a pas notre place dedans, donc on ne va pas aller crever à l’usine comme des chiens. On va jouer selon nos règles, qui sont qu’on ne travaille pas, qu’on va vivre vite et mourir jeune. Et accessoirement, on vous emmerde. »
Dans votre film, la violence du personnage féminin joué par la brillante Alice Isaaz est sans concession. Ce personnage est puissant, il a une très forte portée poétique et sociale…
Oui. Je me suis toujours demandé comment représenter la violence en fonction de l’état d’esprit du personnage principal, Billie. Au début du film, elle est mue par une rage animale, bestiale comme dans la séquence où elle arrache le doigt d’un type qui essaye de la toucher puis lui recrache au visage.
Mais dans un deuxième temps, elle est plutôt dans la maîtrise, dans une violence presque un peu jouissive. Et puis, petit à petit, sa soif de vengeance va entrer en conflit avec l’idée que les Apaches pourraient être sa famille. À partir de là, la violence prend une autre couleur et devient beaucoup moins stylisée, moins jouissive pour entrer dans quelque chose de plus sec et beaucoup plus réaliste.

Billie est un personnage très complexe en perpétuelle remise en question. Elle est à la fois violente, forte et sensible. Il n’est pas difficile de s’identifier à elle. Comment l’avez-vous écrit ?
Dans Apaches, il y a un côté revenge movie. Mais il y a une chose que je voulais vraiment éviter, c’était de faire un personnage féminin faible qui devient fort parce qu’il lui arrive quelque chose d’horrible et qui va devenir fort. Je trouve ce trope très problématique.
C’est pourquoi Billie a cette rage de vivre, cette envie de ne pas subir dès l’enfance. Quand elle entre dans le gang, ce refus de la condition dans laquelle elle se trouve se transforme en fascination pour les Apaches. Elle comprend qu’elle a trouvé sa famille, qu’elle va peut-être devoir tuer. J’avais envie de faire un personnage principal qui soit une femme nuancée, qui puisse être complètement dépassée par moment, qui puisse par moments épater tout le monde parce qu’elle est tête brûlée, qui puisse aussi avoir envie de rire et d’oublier parce qu’elle est à sa place, tout en se sentant tiraillée.

En parlant du stéréotype sexiste du personnage féminin qui devient fort après avoir été victime d’un évènement violent, vous évitez un autre trope : celui de l’héroïne qui tourne le dos à ses principes, ses projets pour se « ranger » à cause d’un homme.
Jésus et Billy, pour moi, ce n’est pas une histoire d’amour, mais de fascination, une histoire d’âme sœurs. Ça aurait très bien pu être deux meufs ou deux mecs, peu importe : ils ont la même colère qui brûle en eux depuis d’enfance. Ils le sentent. Ils ont la même énergie qui est belle, inspirante, mais très autodestructrice. C’est cette énergie qui va porter le film.

Faire du cinéma de genre en France, selon Romain Quirot
Selon vous, comment faire du cinéma de genre, qui ait sa propre patte et qui ne soit pas seulement la version française de ce que font les Américains ?
Même si c’est difficile, il faut se sentir libre de foncer et surtout, ne pas trop se prendre au sérieux. Les Apaches étaient vivants – ils se marraient, ils faisaient des blagues débiles, ils se vannaient, tout en étant parfois très violents : j’avais envie de faire un film qui leur ressemble
Pour moi, il faut assumer les origines américaines de ce mélange des genres – je suis par exemple fasciné par la liberté de Scorses ou de Tarantino, tout en l’ancrant dans une pop culture française. Je me souviens d’une anecdote : sur mon premier film, j’avais filmé une scène de baston sur du Eddy Mitchell. Les gens avaient soit adoré soit détesté mais au moins, ça ne laissait pas indifférent. C’est alors que je me suis dit :
On a une pop culture française riche, on a des icônes de cinéma potentielles, il faut juste y aller à fond et assumer, sans tomber ni dans la parodie, ni dans un truc trop lisse ou trop sérieux. C’est comme ça que j’essaye de développer mon univers.
Vous avez gagné l’une des éditions du Nikon Film Festival. Quel impact cette victoire a-t-elle eu sur votre parcours de cinéaste ?
Je viens d’un petit village et je voulais faire du cinéma. Mes parents n’étaient pas très chauds, ils m’ont dit « va plutôt faire une fac de droit ». J’y suis allé, j’ai tenu cinq ans. J’ai terminé en criminologie à faire des autopsies et j’ai fini par admettre que ce n’était pas ce que je voulais faire.
Alors je suis venu à Paris, mais je n’avais aucun réseau. Je me suis dit que pour être un tout petit peu remarqué, il fallait que je fasse des concours. Donc j’ai tenté le Nikon Film Festival, que j’ai perdu une première fois. Je me suis réinscrit l’année suivante en me disant « Cette fois, fais vraiment ce que tu as envie de faire« . J’ai présenté un film complètement barré avec des poissons qui parlent et j’ai eu la chance de gagner le prix.
Ça m’a donné une forme de confiance, mais aussi l’envie de continuer à prendre des risques, à creuser mon univers, le construire et le défendre. Ça m’a plus aidé psychologiquement que professionnellement. Il n’y a pas de producteurs qui sont venus me dire « on a vu ton petit festival du film de Nikon », mais ça a été une étape majeure de ma construction.
Vous n’avez donc pas fait de formation de cinéma. Comment avez-vous appris à maîtriser l’aspect technique ?
J’ai appris tout seul. Je me souviens que tout est parti de l’enfance. J’ai commencé à utiliser le caméscope de mon père. Je bricolais, je me débrouillais pour comprendre comment ça marchait : par exemple, pour rajouter de la musique, je mettais une cassette dans la télé en filmant à côté. s
J’ai fait 150 courts métrages qui sont tous très, très nuls. Mais ça me permettait d’apprendre, d’essayer. Mais ça me permettait d’apprendre. Comme dit Orelsan, « Si tu veux faire un film, t’as juste besoin d’un truc qui filme »
Je faisais des films de guerre dans les vignes, des trucs de tueries, c’était vraiment n’importe quoi. Mais c’était l’occasion de faire, et c’est ça qui est important. Jusqu’à aujourd’hui, j’essaye de garder cette énergie dans mes films. Comme dit Orelsan, « Si tu veux faire un film t’as juste besoin d’un truc qui filme« . Il y a plein d’autres choses autour, mais la réalité c’est que tu peux faire un truc bien avec peu de personnes, tant que tu as envie de le faire.
Et si le film que vous alliez voir ce soir était une bouse ? Chaque semaine, Kalindi Ramphul vous offre son avis sur LE film à voir (ou pas) dans l’émission Le seul avis qui compte.




![[D’amour et d’eau fraîche] Image de une • Horizontale [D’amour et d’eau fraîche] Image de une • Horizontale](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/10/damour-et-deau-fraiche-image-de-une-horizontale-1-300x300.jpg?resize=135,187&key=4672f93d)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/05/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-05-22t164945311-768x432.jpg?resize=300,350&key=638f1da8)


![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-28t150710132-768x432.jpg?resize=300,350&key=0dbf06ef)

![[Image de une] Horizontale (26) [Image de une] Horizontale (26)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/image-de-une-horizontale-26-768x432.jpg?resize=300,350&key=3f4065eb)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-15t163147788-768x432.jpg?resize=300,350&key=c0e2a724)
![[Image de une] Horizontale (24) [Image de une] Horizontale (24)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/image-de-une-horizontale-24-768x432.jpg?resize=300,350&key=bd0cfdc3)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-16t173042478-768x432.jpg?resize=300,350&key=e6ae1102)









![Copie de [Image de une] Horizontale (84) Copie de [Image de une] Horizontale (84)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/12/copie-de-image-de-une-horizontale-84-768x432.jpg?resize=300,350&key=30319f9e)



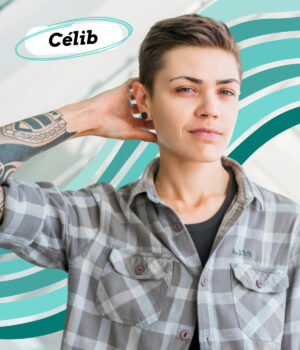







Les Commentaires