Pour comprendre ce qu’il s’est passé le 13 novembre 2015 à Paris
Pour suivre l’avancée des infos en direct
Je cherche mes proches, je veux aider
- Pour déclarer une disparition ou chercher quelqu’un, la plateforme du gouvernement
- Le mot-clé #RechercheParis
- Le Safety Check pour signaler à vos proches que vous êtes en sécurité
- Pour les dons de sang, à priori les hôpitaux sont blindés pour l’instant, à voir dans la semaine
Vendredi 13 novembre 2015, dans la nuit, sept attaques ont frappé Paris et le Stade de France à Saint-Denis.
« Vendredi soir ? Non, je ne sors pas, je bosse samedi, faut que je sois en forme… » Sur le moment, c’était un texto banal. Aujourd’hui, je crois que je m’en souviendrai éternellement.
Ce vendredi 13 novembre au soir, donc, je suis dans mon appart à Paris, les placards sont vides et j’envisage d’aller acheter à manger dehors. Juste avant de sortir, un peu par réflexe, j’ouvre Twitter. En haut de mon fil, un copain journaliste vient de faire plusieurs retweets. Je lis en diagonale, sans véritable intérêt. Jusqu’à cette publication :
Mon cerveau se fige. Des faits divers, des coups de feu… on en voit passer tous les jours dans les fils d’actu. Ce soir-là, sans savoir pourquoi, j’ai tout de suite le sentiment qu’il ne s’agit pas d’un « fait divers ». C’est inexplicable, impalpable. Il n’est pas encore 21h30, et déjà, les muscles se raidissent, une petite alarme dans ma tête envoie son message pernicieux : « Et si ?» Le « et si » qui n’ose pas dire la suite de son histoire.
Le premier réflexe, c’est l’alerte. Il n’est pas encore 22h lorsque j’envoie un premier texto. Twitter commence à citer des lieux. Le restaurant le Petit Cambodge, la rue de Charonne, la salle de concert du Bataclan : autant de lieux et de quartiers que mes proches et moi fréquentons, autant de lieux dont le nom résonne familièrement et déjà très loin. Statistiquement, comme tou•te•s les habitant•e•s de Paris, nous avons plus d’une chance de connaître quelqu’un sur place. C’est déjà irréel. Le premier récepteur de mon message s’étonne de ma sollicitude. Sa réponse à mon explication tient en trois mots.
Des fusillades. Plusieurs. Il y a eu des explosions au Stade de France, aussi. Avant les coups de feu.
L’alerte encore. Une publication Facebook pour prévenir les membres de la rédac. Les sites d’actu commencent à s’activer, mais la soirée est déjà devenue un immense brouillon d’inquiétude. Une autre connaissance, elle aussi journaliste, est partie en urgence au bureau. On ne comprend rien. Que s’est-il passé ? Où ? Que se passe-t-il encore, à l’heure où on écrit ? Les premiers échanges sont épars. Prévenir.
Maman, c’est moi. Je crois qu’il y a des fusillades dans Paris.
J’ai peur.
On se colle sur les chaînes d’information en continu, une fenêtre Twitter ouverte dans le coin de l’écran. Ça défile sans cesse. Trois attaques, puis d’autres. Les images. Les gens qui rapportent les coups de feu. Les journalistes sur le pont. On s’écrit, on s’écrit, on se compte.
Je ne sais plus à quel moment exact s’est lancé le hashtag #PorteOuverte sur Twitter. Des gens demandent un hébergement pour eux ou pour leurs proches. Ceux qui sont au chaud à l’intérieur leur envoient des adresses. C’est le mieux qu’on puisse faire. Ça n’a pas de sens. On leur dit de faire attention s’ils localisent leur domicile. Les réseaux sociaux sont à la fois le théâtre du pire et le plus grand message d’espoir.
Et nous, on est coincés derrière notre écran. On ne peut rien faire, sauf ça.
Les messages Facebook, les textos, les appels, pleuvent les uns après les autres. Le 7 janvier dernier, les marques d’inquiétude avaient mis du temps à arriver. Aujourd’hui, mes proches ont réagi plus vite que jamais. Pas une minute sans que le téléphone vibre ou ne sonne, sans qu’une notification de message clignote sur Facebook. Le plus atroce, c’est le sentiment de déjà-vu. On ne s’habitue pas, jamais. Il est 23h passées. Je reçois un message d’une ex-coloc. Le 9 janvier dernier, elle était dans notre ancien appartement, à Porte de Vincennes.
Dur d’entendre les journalistes faire remarquer que les quartiers des fusillades sont géographiquement proches des anciens locaux de Charlie Hebdo. De les entendre constater que les terroristes montrent qu’ils peuvent frapper deux fois au même endroit. Que leur méthode d’action est du jamais-vu. Que s’en prendre à des citoyen•ne•s sans signification symbolique est un acte de guerre.
Je veux savoir, on le veut tous. Il y a cette amie qui a été bouclée dans un restau à République. Ce pote qui prenait un verre à 500 mètres du Bataclan. Celle qui ne peut plus rentrer chez elle. Cette autre encore, cloîtrée dans un bar aux Halles dont ils baissent les grilles.
Réponds. Tiens-moi au courant. Fais attention à toi.
Le reste ne compte plus.
François Hollande passe à la télévision. Il n’est pas minuit. Il a l’air très mal. On l’est tou•te•s. Il annonce la fermeture des frontières.
Vers minuit et demi. On suit, impuissant derrière nos fenêtres LCD, l’assaut au Bataclan. Ils ont eu le bon goût de demander aux médias de reculer. Le mot « guerre » est partout, on l’entend, on le lit. C’est absurde. C’est si loin.
Minuit 45 sur Facebook. Les photos de profil sont passées au noir. Les statuts qui rassurent les proches ou demandent des informations.
Une heure du matin. Facebook a enclenché son « Safety Check », une case verte à cocher pour signaler qu’on est en sécurité. On coche, on coche, sans hésitation.
Fuir les images. D’iTélé, je n’ai plus que le son depuis longtemps. 1h15. À l’écran, on parle d’une centaine de morts au Bataclan. C’est à peine imaginable. Aux Halles, je ne sais pas ce qu’il se passe. Les premiers témoignages arrivent.
Les heures qui suivent. On s’écrit. On se serre tant qu’on peut dans nos bras virtuels. Des amis d’amis d’amis sont morts. Des amis d’amis ont pris des balles. C’est surréaliste. Pendant ce temps, sur Twitter, des gens postent les photos de leurs proches disparus et demandent des nouvelles. Ça retweete. Les visages s’impriment sur ma rétine. Je lis frénétiquement les réponses à ces tweets. J’espère. J’espère que personne ne leur annonce le pire.
Est-ce qu’on doit aller se coucher ? Est-ce que c’est seulement possible de fermer l’oeil, là ?
Il est 4h30, et je reçois enfin le dernier texto attendu. Difficile d’aller dormir malgré tout. J’ai les paupières surgonflées et pas assez de mots pour décrire les flots de larme qu’elles ont versé toute la soirée. Le ballet des infos continue sur Twitter, iTélé est toujours en boucle. Je bascule sur Europe 1. Sur Facebook, les gens sont partis ou partent se coucher. Pourtant, je ne suis pas seule. Sur Twitter, sur Facebook, dans les bars, dans les apparts aux portes ouvertes, derrière l’écran, les yeux collés à la télévision, nous sommes des millions.
Il n’est pas 9 heures du matin, samedi 14 novembre 2015, lorsque j’entame ce texte. Les infos défilent toujours. On compte les morts. Il paraît qu’il faut rester chez nous. Je regarde les infos sans les voir. Je ne sais pas quoi faire, en fait. Alors je ne peux que taper. La rédac m’a dit que je n’avais pas à travailler. C’est pour sortir tout ça, pour que ça ne reste pas à l’intérieur à pourrir d’angoisse. Pour vous dire aussi que vous n’êtes pas seul•e•s.
Si vous me lisez, qu’on se connaisse ou non, sachez le, je vous aime. Je vous serre dans mes bras. Je vous souhaite beaucoup de courage, quel que soit l’endroit d’où vous avez vécu cette nuit. Encore plus de courage pour encaisser les éventuelles nouvelles. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous aime mille fois. Nous sommes toujours là.

À lire aussi : Charlie Hebdo et l’émotion collective — Je veux comprendre

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-07T114455.874 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-07T114455.874](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-07t114455874-300x300.jpg?resize=135,187&key=783601b2)






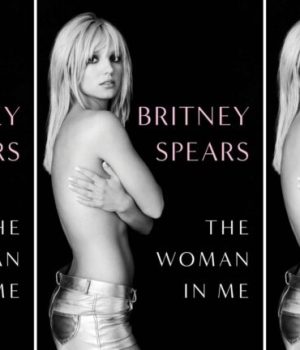









![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-12T103045.066 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-12T103045.066](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/12/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-12-12t103045066-768x432.jpg?resize=300,350&key=93ef36ef)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-10T145633.472 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-10T145633.472](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/12/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-12-10t145633472-768x432.jpg?resize=300,350&key=2403676d)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-25T111624.319 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-25T111624.319](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-25t111624319-768x432.jpg?resize=300,350&key=d78cc3b4)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-28t150710132-768x432.jpg?resize=300,350&key=0dbf06ef)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-20T111708.991 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-20T111708.991](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-20t111708991-768x432.jpg?resize=300,350&key=a2a91e2d)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-15t163147788-768x432.jpg?resize=300,350&key=c0e2a724)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-13T154058.525 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-13T154058.525](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-13t154058525-768x432.jpg?resize=300,350&key=5e3885bf)
![[Image de une] Horizontale (24) [Image de une] Horizontale (24)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/image-de-une-horizontale-24-768x432.jpg?resize=300,350&key=bd0cfdc3)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T170053.120 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T170053.120](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-30t170053120-768x432.jpg?resize=300,350&key=9979862d)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T164414.844 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T164414.844](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-30t164414844-768x432.jpg?resize=300,350&key=f42d86d3)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T115104.723 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T115104.723](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-30t115104723-768x432.jpg?resize=300,350&key=351be990)





Les Commentaires