Je dois vous dire un truc : j’adore les films catastrophes. Les blockbusters et les autres : les films un peu bancals, un peu farfelus, les trucs de tornades, d’orages, d’épidémies, d’invasions…
Pour assouvir cet amour un peu honteux, ce week-end, je suis allée voir The Bay – pour celle et ceux qui n’en ont pas entendu parler, Barry Levinson nous a pondu un film type « found footage », dans lequel de petits organismes venus des profondeurs marines se faufilent dans les corps humains et se mettent à nous bouffer de l’intérieur.
BON, dit comme ça, ça n’a l’air ni folichon, ni très profond, mais j’vous jure, c’est bien foutu. C’est même tellement bien foutu que j’aurais préféré ne pas l’avoir vu et que j’ai fait à peu près cette tête-là tout au long du film.
En bref (ma vie de traumatisée cinématographique ne nous intéressant pas franchement), cette semaine est l’occasion de causer ensemble d’épidémie, ou plutôt de peur, d’angoisse collective de l’épidémie : pourquoi a-t-on collectivement peur des épidémies de maladies ? Que reflètent ces angoisses collectives ?
La peur du risque d’épidémie
Dans une interview pour Cerveau & Psycho, le psychiatre Bruno Verrecchia rappelle les trois conditions identifiées par Lassègue et Falret pour qu’une psychose collective apparaisse :
- la vraisemblance (le risque est objectivement possible – par exemple, la propagation du H1N1 n’est pas invraisemblable)
- des faits passés similaires (dans le cas des virus grippaux, nous pouvons nous remémorer l’exemple de la grippe espagnole, particulièrement meurtrière)
- un rapport avec des peurs ou espoirs concernant l’avenir.
Au-delà de ces considérations, l’une des premières questions qui peut venir à l’esprit lorsque l’on parle de ce sujet, c’est celle de l’objectif et du subjectif : pourquoi sommes-nous spécialement effrayés par le risque-là alors que nous sommes chaque jour à la merci de risques statistiquement plus « dangereux » ?
Pourquoi nombre d’entre nous paniquent un peu en mangeant un steak ou un concombre douteux alors que presque personne ne s’enflamme lorsque l’on cause surconsommation de cigarettes, d’alcool et de risques routiers ?

Que l’on s’entende bien : craindre parfois l’épidémie, ce n’est pas complètement irrationnel — certaines épidémies ont bien décimé une bonne partie de la population (peste, grippe espagnole…).
Mais aujourd’hui, si l’on s’en tient aux statistiques, nous aurions bien plus de chances de mourir d’autre chose : nous fumons, nous buvons, nous avons parfois des conduites à risque (conduire en état d’ébriété, pour n’en citer qu’une)…
Le truc, c’est que ces risques-là font partie de notre quotidien, ils sont fréquents – lorsque nous en parlons, nous minimisons ces risques, ou nous dégainons tout un tas de « bonnes raisons » (« il faut bien mourir de quelque chose, hé »), ou encore nous ne nous sentons pas concernés.
Dans un article pour Sciences Humaines, Patrick Peretti-Watel, chercheur en sociologie, explique que finalement, le risque est « un objet de représentation, davantage que de perception ». En d’autres termes, ce qui crée l’angoisse, ce n’est pas forcément ce que nous percevons… mais plutôt la façon dont nous nous représentons le risque.

C’est d’ailleurs pour cette raison que nos représentations du risque sont aussi liées à notre identité culturelle et aux rapports sociaux que nous expérimentons – les enquêtes montrent par exemple que la perception du risque est plus prononcée dans les milieux les plus modestes (ce qui aurait du sens : ce sont les populations les plus vulnérables, qui exprimeraient par ce biais la conscience de leur vulnérabilité). Il existe donc un décalage entre le sentiment d’insécurité et son niveau réel.
Et en l’occurrence, le risque du concombre tueur nous foutrait bien plus les chocottes que les risques « du quotidien ». D’autant plus que certaines choses peuvent alimenter cette peur (un battage médiatique, des compagnies de sécurité qui insistent sur le risque pour vendre leurs produits) (oui, comme dans Revenge).
La responsabilité de l’épidémie
Les populations ont toujours connu ces peurs, même si elles ont changé de nature selon les époques.
Mais les épidémies auraient changé de style : auparavant vécues comme des catastrophes naturelles, attribuées à des volontés divines, elles seraient de nos jours devenues presque politiques.

Aujourd’hui, les causes de l’épidémie sont souvent liées à l’humain, au développement et progrès technologique. En ce sens, l’épidémie suscite le scandale… Alors même que le monde moderne est censé préserver notre bien-être et prévenir les risques, c’est lui qui est à l’origine du mal !
L’épidémie est alors perçue comme une pathologie de la société (la faute à la surindustrialisation, à l’absence de préoccupation écologique, à l’inconscience de la population…).
C’est plus ou moins ce qu’explique Ulrich Beck dans sa Société du risque (1986) : la « société du risque », venue remplacer la « société industrielle » produit elle-même un danger qui n’existait pas dans le passé.
De ce fait, la société se tourne alors vers l’État, pas nécessairement pour désigner un coupable, mais pour apporter une solution et garantir que ces épidémies ne se reproduisent pas.

Que reflètent ces angoisses collectives ?
Des peurs collectives peuvent refléter un tas de choses sur les sociétés. Dans Epidémies et contagions. L’imaginaire du mal en Occident, G. Fabre explique ainsi que les angoisses collectives d’épidémies peuvent révéler des fractures, des conflits qui marquent la société à un instant T.
Par exemple, jusqu’au 19ème siècle, les classes populaires et la bourgeoisie avaient deux explications différentes de la maladie : le peuple considérait que la bourgeoisie propageait le mal et se mettait à l’écart pour se débarrasser d’eux, tandis que les bourgeois voyaient les classes populaires comme les vecteurs du mal (du fait d’une hygiène et de mœurs douteuses).
Ici, la peur du risque maintient les rapports sociaux, mais elle peut aussi les remettre en cause — ce qui aurait été le cas lors de la crise de la vache folle, où le libéralisme était attaqué et vu comme responsable de la maladie.

Les angoisses sont également endormies ou réveillées par un climat, un contexte spécifique. Aujourd’hui, l’amour ne dure plus, le marché de l’emploi est pourri, la politique n’inspire plus confiance, nous avons une conscience du risque et sommes « impuissants »…
Selon Claudine Burton-Jeangros, tout cela crée un climat anxiogène permanent quant à l’avenir : que va-t-on devenir ? Nos esprits cristallisent alors cette anxiété sur un évènement particulier – dans notre cas, celui de la possibilité d’une épidémie.
Et cette angoisse du groupe fait finalement naître une pression envers les responsables potentiels de l’épidémie, ou en tout cas celles et ceux qui seront chargé-e-s de régler la situation : quelles solutions nous proposez-vous ?
Tout compte fait, l’analyse des phénomènes d’angoisses collectives repose sur deux questions essentielles : celle de la temporalité (quand a-t-on peur et quand n’a-t-on pas peur ?) et celle des acteurs (qui a peur et de quoi ?). Et puisque la peur fait partie intégrante du fonctionnement de nos sociétés, nous devons apprendre à « l’apprivoiser » et à vivre à ses côtés.
Pour aller plus loin :
- Un dossier sur la peur, de l’Université de Genève
- Grippe aviaire et psychose collective
- Le poids de l’imaginaire
- L’article de Patrick Perreti-Watel
Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2023-11-09T141247.411 Copie de [Image de une] Horizontale – 2023-11-09T141247.411](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2023-11-09t141247411-300x300.jpg?resize=135,187&key=c497e46e)






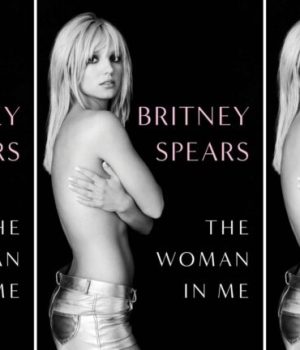









![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-12T103045.066 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-12T103045.066](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/12/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-12-12t103045066-768x432.jpg?resize=300,350&key=93ef36ef)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-10T145633.472 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-12-10T145633.472](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/12/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-12-10t145633472-768x432.jpg?resize=300,350&key=2403676d)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-25T111624.319 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-25T111624.319](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-25t111624319-768x432.jpg?resize=300,350&key=d78cc3b4)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-28t150710132-768x432.jpg?resize=300,350&key=0dbf06ef)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-20T111708.991 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-20T111708.991](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-20t111708991-768x432.jpg?resize=300,350&key=a2a91e2d)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-15t163147788-768x432.jpg?resize=300,350&key=c0e2a724)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-13T154058.525 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-13T154058.525](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-13t154058525-768x432.jpg?resize=300,350&key=5e3885bf)
![[Image de une] Horizontale (24) [Image de une] Horizontale (24)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/image-de-une-horizontale-24-768x432.jpg?resize=300,350&key=bd0cfdc3)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T170053.120 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T170053.120](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-30t170053120-768x432.jpg?resize=300,350&key=9979862d)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T164414.844 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T164414.844](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-30t164414844-768x432.jpg?resize=300,350&key=f42d86d3)
![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T115104.723 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-30T115104.723](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-30t115104723-768x432.jpg?resize=300,350&key=351be990)





Les Commentaires
Cette saleté s'accroche à un poisson qui passait au mauvais endroit au mauvais moment, lui grignote peu à peu la langue pour finalement prendre la place de celle-ci et vivre tranquilou-bilou dans la bouche du poisson ! Comme ça il y trouve son compte : il mange en même temps que son hôte ^^